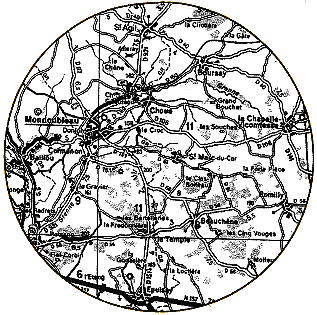![]()
N° 5 - 1998
LES CONFINS OCCIDENTAUX
DU DÔME DE FRÉTEVAL
|
|
|
La retombée à l'ouest du dôme de FRÉTEVAL a été cartographiée jusqu'au nord de la vallée
de la Grenne, ainsi que l'extrémité de la grande faille de FONTAINE-RAOUL qui marque le
flanc du nord du dôme depuis la vallée du Loir. Une structure anticlinale nouvelle de direction sud-ouest nord-est a été mise en évidence au sud-est de MONDOUBLEAU. |
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
La présente étude prolonge et termine celle présentée dans le n°
2-95 de la chronique
(pp. 8-25). Le périmètre concerné se situe entre les communes de DROUÉ au nord et LA
CHAPELLE-VICOMTESSE à l'est; la vallée de la Grenne et la ville de MONDOUBLEAU à
l'ouest; les villages de BEAUCHESNE et ROMILLY au sud.
A l'intérieur de ce périmètre,
les sources sont relativement peu nombreuses, comparées à la zone située plus à l'est
vers la vallée du Loir.
D'un point de vue historique, une seule est bien connue et citée
dans les monographies locales : c'est la fontaine de Guériteau (commune de CHOUE) située
sur la rive droite de la Grenne. D'après M. CARTRAUD, une chapelle a été construite en
ce lieu en 1238. On en voit encore les ruines actuellement. C'était un lieu de
pèlerinage réputé pour l'eau miraculeuse de sa source (la fontaine qui "guérit tout").
Encore actuellement, des gens viennent prélever l'eau dans des bouteilles ou des
récipients divers malgré sa qualité chimique et biologique plus que douteuse (d'après la
D.D. A.S.S.). Le miracle est qu'elle ne rend pas malade!
Les communes concernées par cette étude sont :
- DROUÉ
- LACHAPELLE-VICOMTESSE - ROMILLY
- BOURSAY
- SAINT-AGIL
- MONDOUBLEAU
- CHOUE
- CORMENON
- BEAUCHESNE - LE TEMPLE
- SARGÉ-SUR-BRAVE
La grande culture céréalière, qui a remplacé l'ancien bocage percheron, occupe les 3/4 de la surface. Les bois sont peu étendus et dispersés. L'agglomération la plus importante est MONDOUBLEAU. L'activité industrielle est principalement représentée par l'agro-alimentaire et par une usine de plastiques sur la commune de CORMENON.
II - GÉOLOGIE DES TERRAINS AFFLEURANTS
2.1. Lithologie - Stratigraphie
La séquence stratigraphique est celle décrite dans le n° 2-95 de la chronique, pp. 13 et
14. Cependant on observe une certaine évolution des faciès vers l'ouest, ainsi que
d'importantes variations d'épaisseurs. Ces variations de faciès et d'épaisseurs sont
observables dans les nombreux forages hydrauliques existant dans le secteur d'étude
(cf. figure n° 2).
De bas en haut, on observe :
a) Au Cénomanien supérieur
Reposant sur une assise de marnes noires paraissant constituer un horizon continu (marnes
de BOUFFRY à l'est), les sables du Perche montrent une réduction d'épaisseur vers l'ouest
passant de 35 mètres à BOUFFRY à 8 mètres seulement à BOURSAY. Au-delà de BOURSAY, vers
SAINT-AGIL, ils s'épaississent de nouveau. Ils affleurent fréquemment dans la vallée de la
Grenne où ils ont été et sont encore exploités dans de nombreuses carrières.
Les
meilleures coupes que nous avons pu observer se situent à LA MALLARDIÈRE, au sud-est de
CORMENON et dans l'ancienne carrière de LA MUTTE au nord-est de SARGÉ-SUR-BRAVE.
La formation débute au sommet par un banc massif de grès rouge foncé. L'épaisseur de ce
banc est très variable, passant de 1 mètre (ou moins) à 17 mètres à LA MUTTE. Il s'agit
d'un grès grossier à moyen, à éléments roulés de quartz, de silex et de jaspe ferrifère.
On note quelques lits conglomératiques à microconglomératiques. Le ciment est siliceux,
ferrugineux. La stratification est le plus souvent oblique avec des différences
angulaires entre 10° et 30°. Lorsque ce banc de grès est découpé par l'érosion, notamment
sur les flancs de vallée, il constitue un excellent repère géomorphologique. Il est connu
dans la région sous le nom de "roussard" et est le matériau principal dans de nombreux
édifices historiques dont certains remontent au haut Moyen-âge.
Au-dessous se développe
une épaisse séquence de sables roux, orangés ou jaunâtres, également en stratification
oblique. La granulométrie et la nature des éléments y sont similaires à
celles du grès
"roussard". Ils sont exploités dans la région sous le nom de "sables du Perche". Leur
base n'a pas été observée en affleurement.
Au-dessus du grès "roussard", on trouve un
niveau de marnes gris-verdâtre, sableuses, micacées à débris coquillers. Elles
n'apparaissent que très rarement à l'affleurement, la plupart dû temps sous forme de
débris mélangés dans des colluvions de Pente. D'après les forages, leur épaisseur varie
de 5 à 10 mètres. Elles sont absentes dans le secteur du dôme de FRÉTEVAL sensu stricto.
b) Au Turonien
La craie turonienne, d'après les forages, est soit absente soit présente sur quelques
mètres seulement d'épaisseur. I1 semble bien que, dans ce secteur, on se trouve sur la
limite de dépôt occidentale des faciès carbonatés (craie et calcaires) du Crétacé
supérieur du Bassin Parisien.
c) A l'Éocène inférieur
Les formations conglomératiques à silex qui bordent la vallée du Loir se retrouvent ici
avec des lithofaciès inchangés : silexites et argiles sableuses, perrons siliceux,
lentilles d'argiles plastiques intermittentes, le tout témoin d'une sédimentation
détritique paracontinentale (dépôts de piedmont et de deltas, dépôts fluviatiles, etc.).
Ces matériaux proviennent du démantèlement des reliefs crétacés (abondance des silex)
mais aussi de formations grésoschiteuses plus anciennes (Paléozoïque armoricain?).
Ces formations formant la surface des plateaux entre les vallées ont une épaisseur
variable suivant leur position topographique. Elle peut atteindre une trentaine de mètres
d'épaisseur (LA CHAPELLE-VICOMTESSE).
d) Formations superficielles quaternaires-actuelles
- Limon des plateaux
- Colluvions de pentes, montrant souvent une ségrégation entre éléments grossiers (silex)
et éléments fins (argile, sable)
- Alluvions de la vallée de la Grenne
2.2. Tectonique
(carte de la figure 3 version allégée - version
détaillée (chargement plus long))
a) Le dôme de FRÉTEVAL
Le bombement topographique de cette structure régionale, dont le point culminant se situe entre BOUFFRY et FONTAINE-RAOUL (+253 m), s'atténue progressivement vers le nord-ouest, vers les bois de SAINT-AGIL dans une zone de plateaux dont l'altitude moyenne oscille autour de +200 mètres.
b) L'anticlinal de CORMENON (fig.
1)
Cette structure est bien visible sur photos aériennes et sur le terrain grâce au bon repère géomorphologique que constitue la barre du grès roussard.
L'axe anticlinal est orienté N35. Les pendages des flancs oscillent autour de 10°. Sa terminaison
périclinale vers le nord-est est particulièrement bien marquée juste à l'est de CORMENON. Le coeur de l'anticlinal est érodé en "boutonnière" jusqu'au niveau moyen des sables du Perche. Un forage implanté sur la zone axiale (LA MALLARDIÈRE) indique que le toit des marnes sur lesquelles reposent les sables du Perche se situe à17 mètres sous la surface topographique. Cette structure, pourtant bien visible, ne paraît pas avoir attiré l'attention des auteurs de la Carte Géologique officielle.
c) Les failles
Le parcours anguleux de la vallée de la Grenne paraît déterminé par des couloirs de failles suivant 3 directions
:
- entre LA CHAPELLE-VICOMTESSE et BOURSAY, la direction est N120, c'est-àdire parallèle à l'axe du dôme de FRÉTEVAL la bordant au nord,
- entre BOURSAY et MONDOUBLEAU, la direction est N70,
- entre MONDOUBLEAU et SARGÉ-SUR-BRAVE, la direction est N35, c'est-à-dire parallèle à l'axe de l'anticlinal de CORMENON la bordant à l'est.
Également suivant une direction N35, deux autres failles affectent le flanc oriental du même anticlinal. Leur regard est vers l'ouest, avec un rejet assez important (10 à 20 mètres ?). Cependant elles ne sont visibles en géomorphologie que sur une courte distance;
du fait du masque que constituent les limons de plateau en dehors des lignes d'érosion.
Signalons également la terminaison vers le nord-ouest de la grande faille de FONTAINE-RAOUL qui disparaît à 1 kilomètre au sud de DROUÉ.
3.1. Formations aquifères exploitées ou affleurantes
(cf. fig. 2)
- Les sables du Maine
âge Cénomanien moyen
Cette formation d'une vingtaine de mètres d'épaisseur n'affleure pas dans le secteur d'étude. L'aquifère est donc en situation de nappe captive à ce niveau géologique. Il est exploité pour eau potable par forage
à BOURSAY, MONDOUBLEAU, SAINT-MARC-DUCOR et BEAUCHESNE. Son aire d'alimentation se situe vers l'ouest en direction du MANS. Son toit est scellé par une couche imperméable de marnes noires (marnes de BOUFFRY) dont l'épaisseur apparaît à peu près constante dans le secteur d'étude = 12-13 mètres.
-Les sables du Perche
âge Cénomanien supérieur
Cette formation affleure à flanc de coteau tout au long de la vallée de la Grenne entre BOURSAY et
SARGÉ-SUR-BRAVE ainsi que dans la "Boutonnière" de l'anticlinal de CORMENON. Son épaisseur varie de 35 mètres à BOUFFRY à 8 mètres à BOURSAY. C'est le principal aquifère exploité pour eau potable et pour irrigation dans le secteur d'étude. Il est séparé de la surface par la couverture assez perméable en moyenne des silexites de l'Éocène inférieur et par quelques lambeaux rémanents de craie turonnienne. Les eaux pluviales percolent presque partout depuis la surface des plateaux jusqu'aux sables du Perche qui se trouvent donc ici en situation de nappe libre. Ils sont par conséquent très vulnérables aux pollutions de surface. La direction générale d'écoulement de la nappe dans les sables du Perche est variable suivant les endroits : elle est vers l'est aux environs de DROUÉ, sur le flanc nord du dôme de FRÉTEVAL. A l'est de l'axe de CORMENON, elle est vers le
sud-est. A l'ouest de cet axe, elle est sud-ouest, c'est-à-dire plus ou moins parallèle à la vallée de la Grenne. Le réseau des failles est ici peu développé et ne paraît pas jouer un rôle important de drainage, dans des terrains meubles où les déformations ne sont cassantes qu'au niveau du grès roussard et des perrons siliceux de (Éocène
inférieur).
- Conglomérats à silex et perrons siliceux fracturés
Ils sont aquifères lorsqu'ils
reposent sur des "planchers d'argile plastique" qui arrêtent localement la percolation d'eaux pluviales. La ressource est très limitée : ils alimentent quelques puits de fermes de faible débit ainsi que des abreuvoirs à bétail.
3.2. Sources et émergences
répertoriées au cours de l'étude
(cf. carte de la figure 3 version
allégée - version détaillée
(chargement plus long))
a) Émergences de l'aquifère du Cénomanien supérieur
sables du Perche et grès roussard
- Fontaine de Guériteau (commune de CHOUE) Altitude : NGF + 195 m Description dans ce numéro à la page 27
-Source du lavoir de BOURSAY (commune de BOURSAY)
Altitude : NGF + 140 m ? (Description dans ce numéro).
b) Émergences du Turonien
calcaires crayeux
- Source du Boeuf Blanc (commune de DROUÉ) Altitude: NGF + 150 m Débit 20 1/s : captage et bassin de décantation
Contrôle tectonique : couloir des grandes failles de la vallée de l'Egvonne de direction N120-N145. Le captage est dans les alluvions de l'Egvonne, mais l'aquifère est très probablement la craie fracturée du Turonien.
c) Émergences de l'Éocène
inférieur
De débit très faible et le plus souvent non captées et diffuses, elles correspondent à de petits aquifères dans les silexites, sans connexion ni entre eux ni avec les eaux profondes du Turonien ou du Cénomanien.
Nous citerons :
- Dans la commune de LA
CHAPELLE-VICOMTESSE
Les Plaines
Le Bois de la Pagerie
- Dans la commune de
CHOUE
Le Grand Bouchet
- Dans la commune de CORMENON
Le Petit Gaulay
Le Bois d'Assise
- Dans la commune de
SAINT-MARC-DU-COR
La Fontaine au Pot
- Carte géologique au 1/50.000 : feuilles de CLOYES et SAINT-CALAIS
- Chronique des Sources et Fontaines n° 2-95, pp. 11-25
- Bulletin Soc. Arch. Vendômois 1968
- M. CARTRAUD : Fontaines sacrées et fontaines saintes en Vendômois