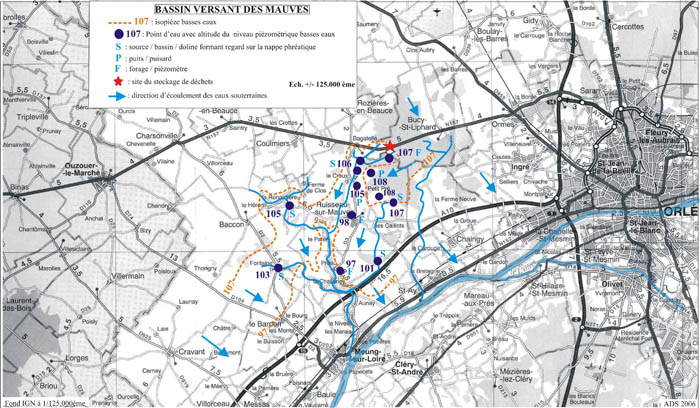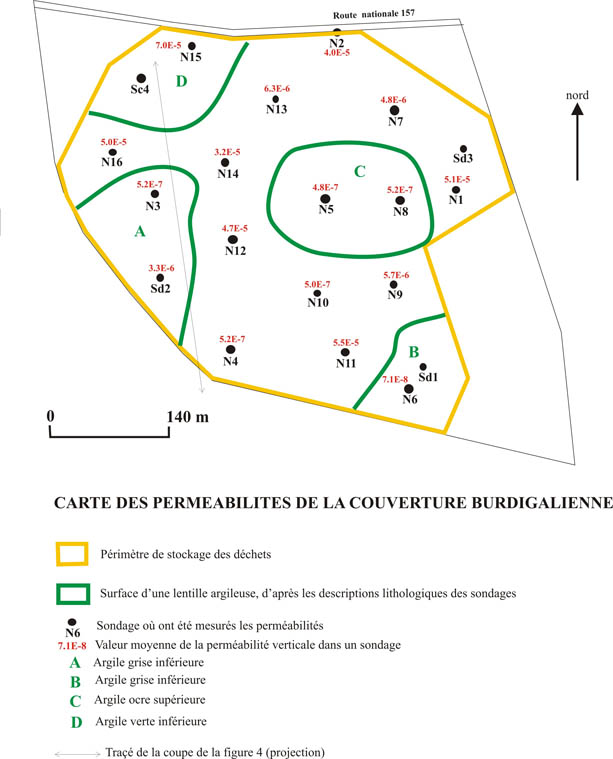![]()
N° 13 - 2007
LE SYSTEME KARSTIQUE DE LA MAUVE DE MONTPIPEAU (LOIRET)
Etude de vulnérabilité des eaux souterraines superficielles
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |
|
|
- Le bassin versant des Mauves : hydrographie
- Contexte hydrogéologique régional
- Description du système karstique de la Mauve de Montpipeau
- Profil hydrodynamique de la Mauve de Montpipeau
- Lithologie et perméabilité de la couverture burdigalienne à l’aplomb du site
- Vulnérabilité du système karstique et évaluation du risque potentiel créé par le projet de stockage de déchets en tête de ce réseau
|
|
Cette étude nous a été demandée par la Municipalité de Bucy-Saint Liphard sur le territoire de laquelle se situe
un projet de stockage de déchets d’une capacité de 100.000 tonnes/an.
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique ouverte en mai 2006.
Figures
- Figure 1 : Carte du bassin versant des Mauves
- Figure 2 : Carte du réseau karstique de la Mauve de Montpipeau
- Figure 3 : Profil longitudinal de la Mauve de Montpipeau
- Figure 4 : Coupe schématique des terrains à l’aplomb du stockage de déchets
- Figure 5 : Carte des perméabilités de la couverture burdigalienne
Documents consultés
- Cartes géologiques à 1/50.000 : feuilles de Patay XXI-19 et Beaugency XXI-20
- Aquifères et eaux souterraines en France. Tome I – Editions BRGM (2006)
- Pomerol B. (1998) : Etude géologique et hydrogéologique – Projet de création d’un centre de stockage de déchets urbains.
- ANTEA (2002) : Actualisation de l’étude hydrogéologique du site de Bucy-St Liphard.
- DIREN/BRGM (2002) : Nappe de Beauce. Piézométrie en hautes eaux. Carte générale.
- SETRAD (2006) : Dossier de demande de permission d’exploiter. Etude d’impact
|
|
1 - Le bassin versant des Mauves : hydrographie (figure 1)
Il draine la bordure méridionale du plateau beauceron en direction de la Loire qu’il atteint en aval de
Meung/Loire.
Sa surface est d’environ 150 km2.
Le point amont le plus élevé du bassin est à la cote NGF +112m, aux étangs d’Escure et de l’Ermitage (amont de la
Mauve de Montpipeau). Le point le plus bas, à sa jonction avec le Val de Loire est à la cote NGF +87m.
Il comprend trois cours d’eau principaux qui confluent au même point à 3 km environ en amont du centre de
l’agglomération de Meung :
- A l’ouest, la Mauve de Fontaine, à régime permanent
- Au centre la Mauve de la Détourbe, à régime permanent
- A l’est, la Mauve de Dourdaigne, à régime intermittent
La Mauve de Montpipeau, à régime intermittent, est un affluent de rive gauche de la Mauve de la Détourbe qu’elle rejoint à 1,5 km en aval de Huisseau/Mauve.
2 - Contexte hydrogéologique régional
Le bassin des Mauves est presque entièrement alimenté par l’aquifère karstique des calcaires de Beauce, d’âge
aquitanien, sauf à son extrémité nord-est (Mauves de Montpipeau et de Dourdaigne) où il reçoit les eaux des petits
aquifères perchés des sables burdigaliens (sables et argiles d’Orléans).
C’est le principal exutoire naturel vers la Loire de la nappe phréatique de la Beauce.
La carte piézométrique régionale “ hautes eaux ”, éditée en mars 2002 par le BRGM et la DIREN montre un gradient
piézométrique décroissant régulièrement vers le sud-est, indiquant ainsi une direction d’écoulement de la nappe
phréatique à peu près perpendiculaire au cours de la Loire.
Au droit du bassin des Mauves, les courbes isopièzes marquent à peine une légère déflexion, ce qui paraît à priori
anormal étant donné l’importance du débit total à la sortie de Meung/Loire. Ceci est dû à la rareté des points de
mesures pris en compte pour l’établissement de la carte piézométrique, dans l’emprise même du bassin des Mauves.
C’est pourquoi nous avons entrepris une prospection des sources et points d’eau susceptibles d’être des émergences
de la nappe de Beauce et donc de donner des indications sur sa piézométrie.
Cette recherche s’est effectuée en août et septembre 2006, c’est-à-dire en période de basses eaux.
Les données altimétriques que nous avons récoltées ne peuvent pas être corrélées directement avec celles de la carte
générale BRGM-DIREN qui, elles, ont été récoltées pendant la période des hautes eaux de 2002.
Cependant, les variations de niveau enregistrées année par année de 2001 à 2006 ont été faibles. Nos résultats
peuvent néanmoins être comparés en terme de valeurs relatives avec le tracé des courbes isopièzes de la carte
BRGM-DIREN :
On constate que, même en période de basses eaux, les courbes isopièzes +97m et+107m dessinent en fait des
indentations très marquées suivant les axes principaux d’écoulement, indiquant ainsi un fort soutirage souterrain de
la nappe phréatique en direction de la Loire, dans le secteur des Mauves (cf.figure 1).
En période pluvieuse, avec une remontée des eaux de la nappe de l’ordre du mètre, le soutirage doit être encore plus
important et devrait se traduire par des indentations des courbes isopièzes encore plus marquées qu’en période
sèche, ce qui n’apparaît pas sur la carte BRGM-DIREN.
3 - Description du système karstique de la Mauve de Montpipeau
Suite à une première reconnaissance sur le terrain, il nous a paru nécessaire d’effectuer une analyse
géomorphologique détaillée du secteur, le projet de stockage de déchets se situant manifestement aux sources de la
Mauve de Montpipeau.
Pour cela nous avons procédé à un traitement informatique de photos satellites et aériennes numériques prises en
période estivale.
Nos observations sont les suivantes :
3.1. Le bassin hydrographique de la Mauve de
Montpipeau apparaît circonscrit à l’intérieur d’une bande de terrains relativement plus humides que les sols
du plateau environnant : cela se traduit sur image satellite par des teintes de sols différentes sur les parcelles
en culture, des taches de végétation particulières dans les zones de friches et des groupements différenciés
d’arbres dans les parties boisées.
Topographiquement, cette bande correspond à un fond de vallée sèche très faiblement marqué, la différence de niveau
n’étant que de quelques mètres avec le plateau environnant et les versants ayant des angles de pente pratiquement
indiscernables lorsqu’on est sur le terrain. Large de 1 kilomètre en moyenne, elle s’allonge sur 5 kilomètres depuis
le Bois d’Escure au nord jusqu’à la vallée de la Détourbe qu’elle rejoint entre les hameaux du Pater et du Préau.
Sa partie amont, au nord, se referme sur une large dépression au lieu-dit “ bassin des Sources ”, laquelle collecte
les eaux de deux réseaux secondaires afférents issus des sables de la couverture burdigalienne : le premier prend
naissance à l’étang d’Escure et rejoint la dépression selon un tracé rectiligne orienté N50E ; le second prend
naissance dans le marais de L’Ermitage et rejoint la dépression selon un tracé rectiligne orienté N62E.
C’est sur ce dernier qu’est situé le périmètre du projet de stockage de déchets.
3.2. Cette morphostructure négative à fond
plat, aux sols légèrement tourbeux, est typique en milieu calcaire d’un réseau plus ou moins anastomosé de
conduits souterrains où l’eau et l’air circulent librement entre la surface et le niveau piézométrique de la nappe
phréatique. Sous le niveau piézométrique, seule l’eau remplit les cavités (zone saturée ou noyée). Les dissolutions
karstiques par les eaux de surface à Ph acide créent ces conduits à partir d’un réseau de microfissures affectant la
masse calcaire. Leur action diminuent avec la profondeur, notamment sous le niveau pièzomètrique. En définitive, le
dénivelé topographique que donne cette vallée sèche à fond plat n’est pas dû au creusement d’un cours d’eau en
surface mais à un affaissement localisé engendré par les dissolutions du calcaire sous la surface.
Cette morphologie karstique est typique des bordures du plateau calcaire beauceron : citons plus à l’ouest le réseau
de la Cisse entre le dôme de Marchenoir et la Loire, les réseaux de l’Aigre et de la Conie en rive gauche du Loir.
3.3. Dans le cas de la Mauve de Montpipeau , on peut observer sur le fond plat de la vallée sèche les phénomènes karstiques suivants :
3.3.1. Lit vif de surface
En amont, il apparaît brusquement au sud du chemin sur digue dit “ Allée d’Ingré ”, sous forme d’un canal naturel à
sec montrant un surcreusement actif de deux mètres environ probablement dû à une érosion en période de hautes eaux.
Sa direction générale est vers le sud-ouest et son tracé suit étroitement la bordure occidentale de la vallée sèche.
Il conflue avec le cours d’eau pérenne de la Mauve de la Détourbe au lieu-dit Le Ponceau à l’amont du hameau du
Pater.
On notera qu’en amont du point où apparait le phénomène de surcreusement de ce canal, la vallée sèche ne présente
aucune trace d’érosion de surface.
3.3.2. Indices de circulations d’eaux souterraines
La présence de nombreux entonnoirs jalonnant le lit vif est la manifestation d’une circulation d’eaux
souterraines sous-jacente à celui-ci.
D’autre part, le traitement informatique de la photo aérienne révèle à l’est du lit vif des linéations affectant
les sols cultivés. Elles sont invisibles sur le terrain. Elles pourraient correspondre à un ancien collecteur d’eaux
souterraines qui aurait fonctionné dans la partie orientale de la vallée sèche avant de se déplacer vers l’ouest
sous le lit vif actuel . En période de très hautes eaux il n’est pas impossible que ces conduits fossiles soit
réactivés. En tout cas ils peuvent expliquer la largeur relativement importante de la vallée sèche. (cf. les flèches
bleues en pointillé sur la carte de la figure 2).
3.3.3. Indices de dissolution karstique
Ce sont les dolines, encore appelées localement “ mardelles ” ou “ gouffres ”, ou bien des dépressions
topographiques fermées au fond desquelles croit une végétation humide et des rosellières, indiquant la proximité de
la nappe phréatique. Nous en avons inventorié un certain nombre sur le terrain (figure 2) :
- au sud et à l’ouest du Bois d’Escure, le long de l’Allée d’Ingré,
- au sud du carrefour des routes N157 et D3 (Lieu-dit Bagatelle),
- à l’est du lieu-dit La Machine,
- au sud-est du lieu-dit La Maison Neuve,
- au sud-est du lieu-dit Le Chatellier,
- à l’est de la ferme de l’Alleu,
- au sud de Huisseau/Mauve.
Certaines de ces dolines se remplissent d’eau et peuvent même déborder en période pluvieuse, d’après les riverains, indiquant ainsi une remontée de la nappe phréatique.
3.3.4. Points d’eau permanents en période de basses
eaux
Ce sont soit des dolines naturelles dont le fond est noyé en permanence, soit plus fréquemment des bassins creusés
artificiellement à partir de ces dolines pour des abreuvoirs ou pour la pisciculture, soit des puisards ou des puits
à usage d’irrigation.
Ils constituent des regards permettant de mesurer le niveau piézométrique de la nappe phréatique en période de
basses eaux.
Nous en avons examiné 5 sur le terrain :
- Au lieu-dit Bassin des Sources entre le Parc de Montpipeau et le Bois d’Escure : il s’agit d’un bassin à margelle cimentée, creusé au fond d’une dépression topographique peu marquée (usage piscicole ?). Le niveau de l’eau était à la cote NGF+106m.
- A une trentaine de mètres au sud de la digue de l’Allée d’Ingré : bassin aménagé et creusé dans le lit vif de la Mauve. Le niveau de l’eau était à la cote NGF+106m.
- A l’est du lieu-dit La Machine : dans une dépression dont le fond est occupé par une rosellière, deux puisards à la même altitude. Le niveau de l’eau était à la cote NGF+108m.
- Au lieu-dit Les Genièvres : puits d’irrigation de jardin. Le niveau de l’eau était à la cote NGF+105m.
3.4. Forages hydrauliques
- Forage AEP de Huisseau/Mauve : Cet ouvrage capte l’eau potable dans l’aquifère des calcaires aquitaniens. Il est exploité par le syndicat intercommunal de Gemigny et alimente entre autres la commune de Huisseau. Fin septembre 2006, le niveau statique de la nappe était à la cote NGF+98m. En phase de pompage, le niveau dynamique était à la cote NGF+95.5.
- Piézomètre du Préau (à 5 km au sud de Huisseau, sur la rive gauche de la Mauve de la Détourbe) : ouvrage de surveillance du niveau piézométrique de la nappe de Beauce. Celui-ci était à la cote NGF+97.4 en période de basses eaux en 2001.
- 5 piézomètres implantés sur le site du stockage de déchets : le niveau piézométrique du Pz2 situé sur le point d’évacuation des eaux de ruissellement du projet, dans l’axe d’écoulement de surface était à la cote NGF+107m en juin 2001.
Toutes ces mesures ainsi que celles citées au paragraphe 3.3.4. ont permis de tracer les courbes isopièzes de la carte de la figure 1.
4 - Profil hydrodynamique de la Mauve de Montpipeau
Il est représenté graphiquement par la figure 3.
Il se divise en 4 segments qui sont de l’amont vers l’aval :
4.1. De l’étang de l’Hermitage au Bassin des
Sources
Ce segment qui traverse en diagonale le site du projet de stockage de déchets est un réseau karstique secondaire,
afférent au réseau principal.
- Longueur : 1700 mètres
- Gradient topographique : 0.35 %
- Gradient piézométrique : 0.06 %
- Direction d’écoulement : Az 258°, soit une différence angulaire de 123° avec la direction d’écoulement régionale de la nappe phréatique.
En amont, une partie des eaux de ruissellement coule à la surface des sables burdigaliens, une autre partie
s’infiltre dans ces sables et pénètre dans les calcaires aquitaniens sous-jacents.
En aval, la couverture burdigalienne disparaît et les calcaires aquitaniens affleurent sous un mince recouvrement de
sols sablonneux colluvionnaires mélangés à des cailloutis calcaires.
4.2. Du Bassin des Sources au lieu-dit Les Genièvres
- Longueur : 1200 mètres.
- Gradient topographique : 0.08 %
- Gradient piézométrique : 0.08 %
- Direction d’écoulement : Az 180°, soit une différence angulaire de 45° avec la direction d’écoulement régionale de la nappe phréatique.
Les calcaires aquitaniens affleurent sur toute la longueur du segment sous des sols tourbeux limoneux à
cailloutis calcaires.
On notera que les gradients topographiques et piézométriques forment le même angle très faible par rapport à
l’horizontale et que le niveau de la nappe phréatique se situe à peine à 1 à 1.5 mètre sous la surface.
4.3. Du lieu-dit Les Genièvres au forage AEP de Huisseau
- Longueur : 1700 mètres
- Gradient topographique : 0.18 %
- Gradient piézométrique : 0.23 %
- Direction d’écoulement : Az 195°, soit une différence angulaire de 60° avec la direction d’écoulement régionale.
Les calcaires aquitaniens affleurent sur toute la longueur du segment sous les même sols qu’en 4.2.
A partir des Genièvres on observe à la surface des sols cultivés des traces d’écoulements souterrains distincts du
lit vif de surface et circulant parallèlement à 500 mètres à l’est de celui-ci (cf. figure 2). Elles passent en
limite de l’agglomération de Huisseau puis rejoignent le lit de la Mauve de la Détourbe en aval du Pater.
Une autre trace d’écoulement paraît rejoindre plus à l’est la partie amont de la Mauve de Dourdaigne, entre la
ferme du Petit Pré et la ferme du Grand Chêne où se situe un point d’eau permanent (cf. figure 2).
4.4. Du forage AEP de Huisseau à la Mauve de la Détourbe
- Longueur : 1500 mètres
- Gradient topographique : 0.40 %
- Gradient piézométrique : 0.06 %
- Direction d’écoulement : Az 215°, soit une différence angulaire de 80° avec la direction d’écoulement régionale.
Les calcaires aquitaniens affleurent également sur toute la longueur de ce segment sous les mêmes sols que
précédemment.
On notera l’augmentation notable du gradient topographique à l’approche du confluent avec la Mauve de la Détourbe.
Il est probable que cela provient du fait que cette dernière, qui est un cours d’eau pérenne de surface, surcreuse
plus rapidement son lit que la Mauve de Montpipeau, cours d’eau à régime de surface intermittent.
PPar contre, cela n’influence pas la nappe phréatique, dont le gradient piézométrique qui redevient très faible.
On constate que :
- Seul, le premier kilomètre du réseau karstique à partir de l’aire de stockage des déchets est recouvert par la formation sableuse du Burdigalien. Au delà, vers l’aval, les calcaires aquitaniens dans lesquels se développe ce réseau sont partout en affleurement sous les sols superficiels. Ils sont donc très vulnérables à toute pollution issue de la surface.
- Les eaux souterraines y circulent dans des conduits de dissolution créés à partir de fractures pré-existantes dont certaines peuvent être visibles sur l’image satellite (cf. figure 2). Ces eaux se répartissent verticalement entre une zone non saturée (air + eau) en relation avec l’air atmosphérique et une zone saturée (zone noyée) limitée vers le haut par le niveau piézométrique, lequel ne se trouve qu’à 1 ou 2 mètres sous la surface dans le segment du bassin des sources au lieu-dit Les Genièvres (cf.§ 4.2.). La zone saturée s’y trouve donc directement exposée aux risques de pollution du fait de sa proximité de la surface.
- Le gradient piézométrique est pratiquement nul entre le bassin des sources et le point d’eau situé sous la digue du chemin d’Ingré. Ce fait nous amène à penser que les apports en provenance du réseau amont sur lequel se situe l’aire de stockage pourraient avoir tendance à se concentrer dans les conduits karstiques de ce segment durant les périodes sèches. Ces apports peuvent être de différentes sortes : micro-particules minérales solides, gels, émulsions de corps gras, solutions aqueuses. Durant les périodes pluvieuses, le système souterrain éventuellement engorgé antérieurement par ces apports se met en charge et déborde en surface dans le lit vif de la Mauve à partir de la digue du chemin d’Ingré. Une partie des concentrés éventuels de produits polluants se trouveraient alors entraînés rapidement par l’eau de surface vers le confluent avec la Mauve de la Détourbe. Une autre partie serait entraînée plus lentement dans le réseau karstique souterrain en direction de l’agglomération de Huisseau et de son forage AEP. La vitesse d’écoulement peut d’ailleurs augmenter dans la zone d’appel de cet ouvrage, lors des périodes de pompage.
- D’autre part, certaines traces visibles sur l’image satellite laisseraient penser à une liaison souterraine possible en période de hautes eaux avec la Mauve de Dourdaigne, comme indiqué sur la carte de la figure 2.
5 - Lithologie et perméabilité de la couverture burdigalienne à l’aplomb du site
Le site choisi pour le projet de stockage de déchets se trouve sur l’extrême limite vers l’ouest des formations
sableuses du Burdigalien (sables de l’Orléanais).
Cette formation qui couvre au nord de la Loire l’ensemble de la forêt d’Orléans est l’équivalent stratigraphique des
sables et argiles de la Sologne au sud.
A l’aplomb du site, leur épaisseur varie de 4 à 10 mètres (cf. figure 4).
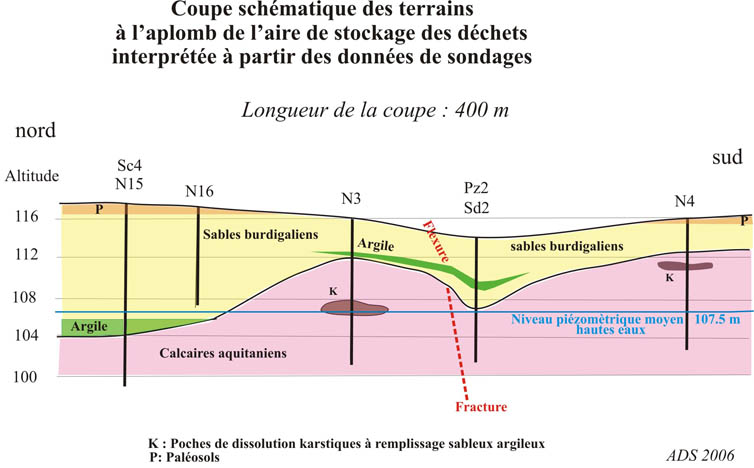
Figure 4
Ce sont des sédiments détritiques d’origine fluvio-deltaïque en provenance du sud qui se sont déposés ici sur la
surface érodée et karstifiée des calcaires lacustres aquitaniens. Sur leur limite occidentale, leur épaisseur varie
en fonction des reliefs calcaires sous-jacents comme le montre la coupe schématique de la figure 4.
Leur mode de sédimentation est extrêmement confus suivant une stratification discontinue de niveaux lenticulaires et
de chenaux entrelacés. Les sondages effectués par le pétitionnaire à la maille de 150 mètres sont rarement
corrélables mais les faciès sableux y apparaissent nettement dominants par rapport aux faciès franchement argileux.
Cependant, à notre connaissance, et sauf erreur, aucune détermination micropétrographique ni aucune mesure
granulométrique ne semble avoir été réalisée sur les échantillons provenant de ces sondages, ce qui rend hasardeuses
les définitions des logs de sondage faites probablement uniquement à l’œil nu ou à la loupe ( ? ) : de nombreux
niveaux indiqués comme “ argile ” pourraient n’être que des sables fins à matrice argileuse.
Deux campagnes successives de mesures de perméabilité ont été réalisées :
- La première, réalisée en 1998, a utilisé une procédure sélective selon la nature des terrains : les mesures
étaient effectuées par niveaux de nature apparemment différente, d’épaisseurs variables, sans continuité latérale
d’un sondage à l’autre. La valeur moyenne obtenue de la perméabilité des passages argileux, non pondérée par les
épaisseurs sur l’ensemble des mesures effectuées, était inférieure à 1x10-10 m/s, la finalité de cette sélection
étant de démontrer que l’ensemble du soubassement du site avait une perméabilité réglementaire inférieure à 1x10-9
m/s.
Il est probable que les services administratifs préfectoraux n’aient pas été vraiment convaincus des résultats obtenus par cette méthode ! - La deuxième campagne, réalisée en 2002 par un bureau d’études indépendant, portait sur 17 sondages répartis à
une maille régulière de 150 mètres. Elle a été menée cette fois selon une procédure rationnelle qui permettait une
estimation statistique raisonnable de la perméabilité du soubassement du site.
Parmi les documents consultés, nous n’avons pas eu connaissance des conclusions du bureau d’études sur la perméabilité des terrains concernés. Nous avons donc procédé à une compilation des résultats bruts des mesures présentés dans le tableau 1 de leur rapport intitulé “ Tableau de synthèse des résultats des tests de perméabilité ” :
Les valeurs moyennes verticales obtenues sont reportées sur la carte de la figure 5.
Les zones entourées de vert sont censées représenter les niveaux définis a priori comme “ argile ” dans les logs de sondage.
La moyenne générale par passes verticales régulières de 2 mètres s’établit à :
5.4 x 10-6 m/s
Dans les niveaux supposés argileux on peut distinguer :- lentille A : 2 x 10-7 m/s sur 1.5 m. d’épaisseur
- lentille B : 5 x 10-7 m/s sur 1.75 m. d’épaisseur
- lentille C : 7.6 x 10-5 m/s sur 2 m. d’épaisseur
- lentille D : 7.1 x 10-8 m/s sur 2.5 m. d’épaisseur.
Au vu de ces résultats on constate que :
- Les lentilles considérées comme argileuses, outre leur discontinuité spatiale, ont des perméabilités à peine inférieures à la perméabilité de l’ensemble.
- La perméabilité de l’ensemble du soubassement du site est nettement supérieure à la valeur réglementaire de 1 x 10-9 m/s qui est en fait la perméabilité des argiles vraies. D’un point de vue strictement pétrographique, la perméabilité d’ensemble mesurée ici est bien connue pour correspondre à des sables quartzeux non granoclassés, à matrice argileuse pauvre, ayant une porosité moyenne assez élevée, considérés comme perméables et aquifères. Les nombreuses sources qui apparaissent aux alentours dans ces sables, notamment dans la forêt de Bucy, en sont le témoignage.
Il apparaît évident que ces mesures démontrent l’absence de toute barrière imperméable naturelle entre la masse
de déchets et l’aquifère des calcaires aquitaniens sous-jacents.
Le pétitionnaire a alors imaginé de créer une barrière artificielle par une extraction sélective des parties les
plus argileuses et en les recompactant pour former une couche imperméable de 5 m d’épaisseur. Il a donc procédé sur
le site à des prélèvements d’échantillons argileux qui ont subi des tests de compactage en laboratoire lesquels se
sont révélés pour lui positifs sur le plan de la perméabilité.
Sur le terrain, cette procédure paraît irréalisable pour les raisons suivantes :
- Le volume d’argile vraie dans l’ensemble de la formation burdigalienne est localement trop réduit pour fournir une couche imperméable de 5 mètres d’épaisseur sur une surface de 16 hectares environ. Il serait alors nécessaire d’importer une grande quantité de matériaux argileux d’autres chantiers, ce qui paraît peu rentable.
- La perméabilité de matériaux compactés en masse par des engins de chantier ne peut en aucun cas être comparée à la perméabilité d’échantillons de ces mêmes matériaux testés en éprouvettes dans un laboratoire. Il faut également prendre en compte la possibilité à long terme de décompactages gravitaires dûs au tassement du soubassement naturel sous le poids des matériaux artificiellement accumulés.
- L’extraction de matériaux est en fait une opération de décompactage. Décompacter des couches géologiques qui se sont tassées depuis 20 millions d’années pour les recompacter ensuite est un non-sens qui changerait peu leur perméabilité, même en les sélectionnant.
- La sélection à vue, in situ, des passées les plus argileuses est une vue de l’esprit, pratiquement impossible à réaliser avec des engins de chantier, étant donné l’imbrication inextricable des faciès sableux avec les rares faciès d’argiles franches du Burdigalien.
- Le pétitionnaire prétend ainsi qu’il va créer une barrière passive imperméable en accord avec la réglementation. En admettant qu’il y arrive, il aura créé une barrière artificielle qui, aux yeux du législateur, est une barrière active. Or, dans l’étude d’impact faisant partie de son dossier de demande d’exploiter, la procédure mentionnée ci-dessus y est présentée comme “ barrière de perméabilité passive ”, ce qui est parfaitement inexact car le terme de barrière de perméabilité passive tel qu’il est défini dans le préambule de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 s’applique exclusivement au terrain naturel non remanié.
6 - Vulnérabilité du système karstique et évaluation du risque potentiel créé par le projet de stockage de déchets en tête de ce réseau
A partir des faits d’observation exposés ci-dessus on peut estimer que la vulnérabilité du karst de la Mauve de Montpipeau et des eaux souterraines et de surface dont il est le collecteur est d’un niveau très élevé, principalement pour les raisons suivantes :
- La faible profondeur (1 à 4 mètres) de l’interface entre la zone non saturée et la zone noyée (niveau piézométrique) sur toute la longueur du profil hydrodynamique.
- L’absence de toute couverture imperméable, Burdigalien compris, au-dessus du réseau karstique.
Cette vulnérabilité concerne évidemment le captage d’eau potable de Huisseau, situé dans la partie médiane du réseau karstique.
Le risque potentiel créé par une activité hautement polluante telle qu’un stockage de déchets ultimes de 1.000.000 tonnes et plus à l’amont du réseau karstique est évidemment extrêmement élevé, surtout au vu des résultats des études effectuées sur le site par le pétitionnaire lui-même : a) proximité de la nappe de Beauce l’obligeant à concevoir un stockage en élévation ; b) absence de barrière passive imperméable qu’il pense pouvoir compenser par une reprise des matériaux sur place et leur compactage, ce qui est un non-sens étant donné la pauvreté en argile de la couverture burdigalienne. De toute façon une telle mesure palliative serait inadéquate sur le plan réglementaire car cela reviendrait à détourner les objectifs de l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 qui prévoit la mise en place d’une barrière active (artificielle) pour renforcer la barrière passive (naturelle) à la condition qu’elle existe et non pas d’en tenir lieu et place lorsqu’elle est absente comme c’est le cas ici. Sinon pourquoi ne pas implanter des centres de stockages de déchets n’importe où, sans tenir compte des conditions du sous-sol ? !
D’autre part, ce risque potentiel, inhérent à toute action d’accumulations de déchets, est ici aggravé par des
erreurs techniques de conception de l’aire de stockage.
Ces erreurs, d’après l’ingénieur J.L. Posté, ancien responsable de centres de stockage de déchets, sont les
suivantes :
“ …Le projet consiste en fait en un énorme casier de 110.000 m2 et de plus d’un million de tonnes de déchets. Car
les diguettes qui sépare les alvéoles n’ont que 2 ou 3 mètres de hauteur alors que les déchets s’empilent sur une
hauteur de 10 à 27 mètres de haut. Autant dire que les lixiviats, les gaz, les risques d’incendie vont se propager
d’une alvéole à l’autre…
…Le projet prévoit clairement d’entasser des déchets sur plus de 20 mètres de hauteur, sans aucune retenue. Où
voit-on que ces matériaux sont stables ? Le compacteur qui risquerait de s’aventurer à du trou basculera dans le
vide. Incroyable ? C’est pourtant ce que montrent les plans en cours d’exploitation qui sont dans le dossier ! Les
déchets sont censés tenir sans s’appuyer sur une digue, en attente de réalisation des alvéoles suivantes, sur un
front de 300 mètres. Non seulement les déchets accumulés s’écrouleront, mais le compacteur ne pourra pas s’approcher
du vide et les déchets ne seront pas compactés correctement en limite d’exploitation provisoire. Il faut croire que
l’exploitant a transcrit ce qu’il fait quand il enfouit des déchets dans une ancienne carrière, et qu’il remplit la
cavité par couches successives bien compactées. Il ne s’est pas aperçu qu’il travaillait en élévation….
……( à propos de la couverture du stockage) Le dossier parle d’un mètre d’argile…D’où proviennent les 110.000 m3
d’argile nécessaire ? Au contraire le dossier prévoit que l’eau de pluie continuera à s’infiltrer à travers la
couverture finale pour une hauteur moyenne de 25 mm par an. Sur une surface de 11 hectares, soit 2800 m3 d’eau par
an, plus celle qui s’infiltrera par les digues extérieures non étanches. La production de lixiviats n’a donc aucune
raison de s’arrêter. Mais l’exploitant ne sera plus là pour les traiter. Ils finiront par s’accumuler et par
déborder… ”
Les remarques ci-dessus nous amènent au commentaire suivant :
a) Le risque de pollution accidentelle de la Mauve par le projet tel qu’il est conçu est bien réel du fait de l’instabilité des talus induisant des possibilités d’effondrement de la masse des déchets, auquel s’ajoute le risque de déchirure de la géomembrane par les engins de chantier.
b) Le risque de pollution diffuse par les eaux de ruissellement est permanent pendant la durée de l’exploitation. Il demeurera après la fin de l’exploitation. Il est aggravé en période sèche car il est prévu d’arroser les tas avec les lixiviats pour prévenir les risques d’incendie.