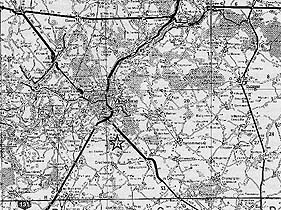![]()
N° 10 - 2004
VULNERABILITE DES EAUX
DU BASSIN VERSANT DE RIVE GAUCHE
DE L’HEUZEE
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |
|
|
|
1. HYDROGRAPHIE (eaux de surface) |
2. GEOLOGIE
2.1. Séquence stratigraphique
Les terrains présents dans le secteur d’étude s’étagent entre le sommet du plateau et le fond de la vallée de l’Heuzée, du plus récent au plus ancien :
- Calcaires lacustres de Beauce : épaisseur =
11 mètres
Formation de calcaires tendres, fortement attaqués par l’érosion
karstique (cavités de dissolution). Ils sont normalement aquifères (nappe de
Beauce) mais, du fait de leur situation ici en bordure de plateau, les eaux
pluviales les traversent librement, sans rétention, puis s’infiltrent
directement dans les formations sous-jacentes.
- Silexites de l’Eocène inférieur :
épaisseur = 16 mètres
Formation continentale de conglomérats de silex à matrice
argilo-sableuse tendre ou siliceuse dure à certains niveaux
(" perrons "). Elle peut être aquifère localement,
notamment à la base des " perrons " siliceux dans les
zones fracturées. Localement aquifère donc, l’ensemble est perméable de
façon irrégulière.
- Formation marine de la craie (Sénonien-Turonien)
Calcaires crayeux et calcaires tuffacés attaqués
également par l’érosion karstique. Dans le bassin versant concerné, ils n’affleurent
qu’en bas de pente dans la vallée de l’Heuzée sous une couverture
superficielle de colluvions de pente (éboulis) provenant essentiellement des
silexites de l’Eocène inférieur. Ils sont également recouverts en fond de
vallée par les alluvions de l’Heuzée.
Cette formation contient la nappe phréatique du Turonien
qui constitue une ressource importante à l’échelle régionale, tant pour l’alimentation
en eau potable que pour des usages agricoles ou industriels.
2.2. Tectonique
La carte géologique (feuille de Selommes à 1/50.000) n’indique
ici aucun accident tectonique tel que plis ou failles.
Cependant nous avons procédé à une analyse
géomorphologique détaillée sur le bassin de l’Heuzée, par traitement d’image
de satellite et traitement d’image de photos aériennes numériques.
Il ressort de ce travail que le bassin versant de rive gauche
de l’Heuzée apparaît traversé par un faisceau de fractures orientées
sud-ouest nord-est (N20E à N70E). Ces fractures affectent les strates de roches
dures soit les calcaires de Beauce et les " perrons " de l’Eocène
inférieur. Nous les avons reportées sur la carte topographique à 1/50.000
ci-jointe.
Les raisons pour lesquelles ces fractures ne sont pas
indiquées sur la carte géologique officielle sont d’abord leur amplitude
très faible (rejet nul ou d’ordre métrique) et ensuite le fait que les
procédures de traitement d’image utilisées actuellement en cartographie
géologique sont plus récentes que cette carte éditée en 1983.
Bien que d’amplitude faible, le réseau de fractures
détecté est néanmoins suffisamment marqué pour jouer un rôle de drainage
important dans l’écoulement des eaux souterraines entre le plateau et le fond
de la vallée de l’Heuzée.
3. CONSEQUENCES HYDROGEOLOGIQUES
La nappe phréatique du Turonien apparaît très vulnérable
dans le bassin versant de rive gauche de l’Heuzée pour la raison
suivante : le niveau piézométrique se situe autour de la cote NGF +100
mètres. Il affleure en fond de vallée où il donne une ligne de sources entre
le Bois du Coudray et le Bois de Villemalin.
La nappe du Turonien est donc sans couverture de protection
imperméable contre des pollutions venues du plateau, à la fois par les eaux
de surface des ruisseaux permanents et intermittents et par les eaux
souterraines infiltrées dans le réseau des fractures affectant le bassin
versant concerné. Ce réseau de fractures multiplie le risque de pollution de
la nappe.
A son confluent avec le Loir, la vallée de l’Heuzée est
remblayée par des alluvions reposant directement sur la craie du Turonien, sans
écran intermédiaire imperméable.
Des pollutions éventuelles en provenance du bassin de l’Heuzée
risqueraient donc d’altérer la qualité des eaux de la nappe du Turonien dans
la vallée du Loir à hauteur d’Areines et de Saint Ouen où elles sont
captées pour l’alimentation en eau potable d’une partie de l’agglomération
vendômoise.
Une activité de compostage de déchets variés (boues d’épuration,
déchets ménagers, déchets d’abattoirs, fumiers, etc.) serait productrice d’effluents
liquides organiques hautement toxiques. Les risques d’infiltration dans le
sol, soit diffus soit accidentels, sont importants quelles que soient les
précautions prises.
On peut constater sur la carte ci-jointe que les deux sites
alternatifs proposés pour cette activité sont tous les deux situés dans la
partie amont du réseau fracturé qui affecte le bassin versant de rive gauche
de l’Heuzée. Si l’un des deux est choisi pour l’installation de
compostage, le risque de pollution du cours inférieur de l’Heuzée et de la
vallée du Loir à hauteur d’Areines est à son maximum.
P.B.
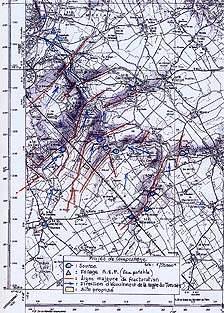
cliquer sur l'image pour l'agrandir