![]()
N° 9 - 2003
L'ÉROSION KARSTIQUE
Pierre de Bretizel
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf
Le chargement peut être assez long
si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit.
Il se fera sur une autre fenêtre
pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement
 |
Elle résulte de la dissolution lente par les eaux météoriques des roches carbonatées (calcaires, dolomies, cipolins)
d'une part et des roches évaporitiques (gypse, anhydrite, sel gemme) d'autre part. La dissolution des
roches carbonatées sous forme de bicarbonate a lieu grâce aux infiltrations d'eaux pluviales chargées d'acides
humiques par leur passage au travers des sols suivant la formule : |
Les résidus insolubles (principalement minéraux argileux et oxydes de fer) s'accumulent sous forme d'argile rouge dite de décalcification (syn. Terra Rossa).
Le modelé karstique est le résultat de cette érosion chimique,
laquelle peut être accentuée par une érosion mécanique due à l'action des eaux courantes désagrégeant les roches plus
ou moins intensément suivant leur cohésion et la vitesse d'écoulement.
L'érosion karstique s'exerce en surface
comme en profondeur :
En surface
Les figures caractéristiques du modelé karstique sont les suivantes
:
|
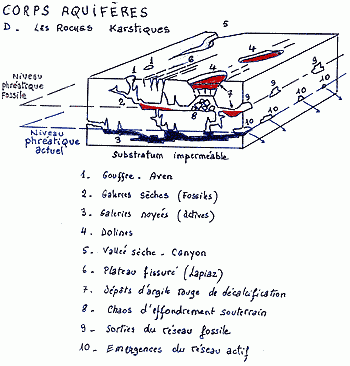 |
- Avens (synonyme : gouffre)
Cavités verticales atteignant la surface. Tantôt étroits, creusés à partir d'une faille ou d'une fracture, tantôt larges et circulaires résultant de l'effondrement de la voûte d'une salle souterraine (exemple : le gouffre de PADIRAC). - Grottes
Cavités horizontales débouchant à la surface au flanc des vallées entaillant les plateaux calcaires. Lorsqu'un cours d'eau en sort, on parle d'exsurgence active. Lorsqu'elles sont sèches, il s'agit d'exsurgences fossiles correspondant à un ancien niveau d'écoulement. - Pertes (synonyme : embut)
Point où un cours d'eau de surface disparaît dans le sol. En aval, le lit de la rivière apparaît à sec en période d'étiage. En période de hautes eaux, la rivière peut couler en aval de la perte mais son débit est inférieur au débit en amont de la perte. - Résurgence
Point où un cours d'eau réapparaît en surface en aval d'une perte.
Le milieu
souterrain
Il est souvent pénétrable par l'homme : c'est le domaine de la spéléologie, discipline à la fois
sportive et scientifique qui s'applique aux seuls massifs calcaires. Les massifs gypseux, attaqués par l'érosion
karstique, ne sont pas pénétrables car la dissolution très rapide entraîne immédiatement des effondrements et des
tassements.
Les spéléologues emploient des termes spécifiques dont les plus courants sont définis ci-après :
- Puits
Cavité verticale ne pouvant être franchie qu'à l'aide d'un matériel de descente et de remontée : pitons, cordes, descendeurs, remonteurs, treuils, échelles souples. Un puits résulte de l'érosion d'une fracture ou d'une fissure verticale. Il est souvent évasé vers la base. On admet que certains ont pu être creusés par dissolution chimique de bas en haut, couplée ou non à une érosion mécanique des eaux venues du haut. - Galerie fossile
Cavité horizontale sèche ou ne comportant que des laisses d'eau résiduelles. Les galeries fossiles sont fréquemment partiellement remblayées par de l'argile rouge de décalcification. - Galerie active
Cavité horizontale où s'écoule un cours d'eau. Galeries fossiles et actives résultent généralement de l'érosion de joints interstrates. Leur tracé est souvent très capricieux du fait de leur intersection avec des fractures de directions variables. Lorsque le niveau de l'eau atteint le plafond et que la progression n'est plus possible qu'en plongée, on a une galerie « noyée » ou « siphon ».
Lorsque plusieurs cours d'eau souterrains confluent pour former un seul conduit, on a un collecteur. - Méandre
Galerie très étroite et très haute, à tracé sinueux. Le fond de ce type de cavité se termine en sifflet et est donc impraticable. Dans un méandre, on progresse en opposition en prenant appui sur les deux parois. Un méandre est induit par une fracture verticale. - Laminoir
Galerie horizontale très basse ne permettant la progression que par reptation. Le laminoir est induit par un joint interstrate. - Chatière
Passage très étroit ne se franchissant qu'en forçant le corps, un bras en avant pour effacer les épaules. - Toboggan
Galerie à pente très inclinée obligeant à utiliser les techniques de l'escalade. - Concrétions
Les eaux percolant à travers les calcaires fissurés se chargent peu à peu en bicarbonate de calcium. Ce bicarbonate, au contact de l'air des cavités souterraines, précipite en carbonate de calcium sous forme cristalline orthorhombique : c'est l'aragonite qui a la même composition chimique (C03 Ca) que la calcite qui, elle, est rhomboédrique. L'agrégation progressive des cristaux d'aragonite construit les différentes formes de concrétions : stalactites, stalagmites, planchers stalagmitiques, cascades stalagmitiques, draperies, gours, etc.
Dans certains cas, le concrétionnement est tel qu'il finit par colmater les conduits souterrains. On peut également observer des concrétions de gypse (S04 Ca2 H20) lorsque les eaux souterraines traversent des niveaux gypseux à l'intérieur des calcaires.
Réseaux
A l'intérieur d'une
formation calcaire ou d'un massif calcaire soumis à l'érosion karstique, toutes les cavités créées par la dissolution
carbonatée, aidée ou non par une érosion mécanique, sont organisées en un réseau où circulent ou ont circulé les eaux
souterrains. Un réseau souterrain est un réseau hydrographique au même titre qu'un réseau hydrographique de surface
avec des affluents primaires, secondaires, etc. qui rejoignent un collecteur principal dont le débit représente la
totalité de l'eau souterraine drainée dans le massif. Dans les réseaux souterrains, la vitesse de transfert est du
même ordre que la vitesse d'écoulement des eaux de surface. Elle est fonction de la différence d'altitude entre les
points d'engouffrement et l'exutoire ou les exutoires.
Les réseaux souterrains peuvent atteindre des dimensions
considérables. Citons quelques chiffres d'après une statistique datant de 1997
- Le plus long réseau du monde est
le « Mammoth cave system » aux Etats Unis. Il atteint 564 kilomètres de développement de galeries pénétrables.
- En France, le plus long réseau est celui de la « Coume d'Hyouernedo » en Haute Garonne avec 95 kilomètres.
- Les plus grandes dénivellations explorées par les spéléologues se situent évidemment dans des massifs
montagneux. La plus grande profondeur explorée dans le monde est en France, en Haute Savoie : c'est le réseau Jean
Bernard à -1.602 mètres, suivi de près par le Lamprechstofen Verlorenen Weg Schacht près de Salzbourg en Autriche où
la cote -1.537 mètres a été atteinte. De nouvelles explorations sont en cours qui permettront peut-être de dépasser
ces records.