![]()
N° 9 - 2003
VULNERABILITE DES AQUIFÈRES
ENTRE LES BASSINS VERSANTS DU LOIR ET DE LA SARTHE
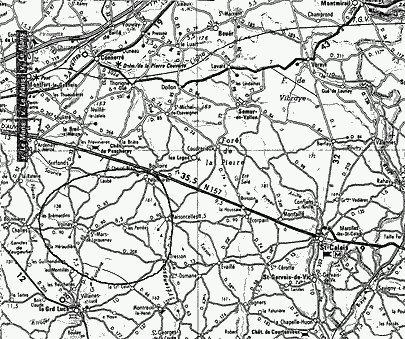 |
Le secteur géographique de cette étude se situe au sud-ouest de BOULOIRE (Sarthe).
C'est à la demande d'une association riveraine de protection de l'environnement que nous avons entrepris d'étendre
vers l'ouest la collecte des données hydrogéologiques acquises dans le Perche méridional et la vallée du Loir entre
CHATEAUDUN et MONTOIRE (cf. Chronique des Sources et Fontaines n° 2-3-4-5-6).
|
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
La zone d'étude est localisée sur les confins occidentaux du « plateau calaisien » entaillé
au nord par les affluents de la Sarthe et au sud par les affluents du Loir. Elle s'inscrit dans un triangle formé par
les agglomérations de BOULOIRE au nord, TRESSON au sud et VOLNAY à l'ouest.
Trois cours d'eau permanents prennent
naissance dans la zone d'étude
- la Hune au nord (bassin de la Sarthe),
- la Veuve au sud (bassin du Loir),
- l'Etangsort à l'est (bassin du Loir).
La ligne de partage des eaux de surface entre les bassins
hydrographiques de la Sarthe et du Loir traverse la zone d'étude dans sa partie médiane suivant une direction générale
sud-ouest nord-est.
Des bois de résineux et feuillus occupent les sols à part égale avec des prés bocagers et
quelques cultures.
|
|
On retrouve ici la même séquence lithologique que dans le Perche méridional, à
savoir (de haut en bas) :
- Sables argileux à silex (Eocène inférieur) comprenant de minces horizons différenciés
lenticulaires de grès conglomératique et d'argile plastique. Cette formation qui occupe la surface du plateau est
perméable dans son ensemble du fait du pourcentage élevé d'éléments détritiques (> 50%). Son épaisseur, très variable,
est inférieure à20 mètres (18 mètres au forage du Réservoir, 5 mètres au forage de la Baronnière, 19 mètres au forage
de la Hubinière).
- Craie et calcaires crayeux à silex parfois sableux ou micacés (Turonien) : l'épaisseur de cette
formation atteint 26 mètres dans les forages du Réservoir et de la Baronnière. Vers le nord-est, son épaisseur n'est
plus que de 8 mètres au forage de la Hubinière. La base de la craie turonienne présente un faciès un peu plus marneux.
- Sables du Perche (Cénomanien supérieur) : sables roux ferrugineux à litage oblique, comprenant des bancs de grès
à ciment calcaire ou siliceux. Leur épaisseur est de 6 mètres au forage du Réservoir, 5 mètres au forage de la
Baronnière et 10 mètres au forage de la Hubinière.
- Marnes de Bouffry (Cénomanien moyen) : marnes noires micacées,
glauconieuses. Leur épaisseur est de 8 mètres aux forages du Réservoir et de la Baronnière et de 10 mètres au forage
de la Hubinière.
- Sables du Maine (Cénomanien moyen) : arénite calcareuse et quartzeuse généralement à
granulométrie grossière, glauconieuse, micacée. Son épaisseur est de 26 mètres au forage du Réservoir, de 45 mètres au
forage de la Baronnière et de 22 mètres au forage de la Hubinière.
- Marnes de Ballon (Cénomanien inférieur) :
marnes silteuses, parfois sableuses, de couleur gris-verdâtre. Elles ont été traversées sur 40 mètres au forage du
Réservoir, sur 4 mètres au forage de la Baronnière et sur 53 mètres au forage de la Hubinière.
|
|
OBSERVATIONS TECTONIQUES
(figure 1 et2 )
| D'après la notice de la carte géologique (BOULOIRE 1/50.000), de
grandes failles régionales se développent au nord-ouest de la zone d'étude : il s'agit du «
Hörst » du Jalais de
direction sud-ouest nord-est, prolongé par le dôme de Parigné. Cette structure est recoupée par la faille du Narais
(dans la vallée du même nom) de direction N160E. Outre ces failles importantes, les formations compétentes (niveaux gréseux de l'Eocène et craie turonienne) sont traversées par des réseaux de fractures majeures de direction N160E-180E, N20E et N90E. Nous avons procédé à une analyse géomorphologique détaillée des photos aériennes et nous avons effectivement retrouvé ces lignes de fractures qui apparaissent bien développées dans la zone d'étude. Nous avons pu suivre ainsi le prolongement de la faille du Narais jusqu'à VOLNAY et au nord-est de CORBUON où elle franchit la limite entre les sous-bassins versants de la Hune et de la Veuve. L'analyse géomorphologique révèle également des phénomènes d'érosion karstique de la craie turonienne sous la couverture éocène, particulièrement marqués dans les parties les plus hautes du plateau et notamment dans le secteur des bois de CORBUON et des « Sapins des Pauvres ». Il s'agit de vallées sèches plus ou moins parallèles à la fracturation observée et de faibles dépressions hémicycloïdes sur le rebord du plateau. La carte géologique au 1/50.000 montre dans un cartouche annexe un schéma structural basé sur les courbes isohypses (courbes de même altitude) du mur (base) de la craie. Nous avons complété et localement précisé ce schéma à partir des données de forages exécutés postérieurement à la publication de la carte. Le schéma structural ainsi complété est présenté sur la figure 3 ci-jointe. |
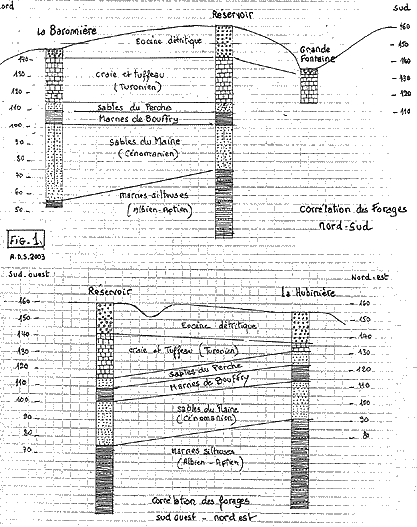 |
I1 montre l'existence d'un sillon tectonique important prolongeant au sud-est le synclinal du Narais et la faille du même nom jusqu'à la partie haute de la vallée de la Veuve. La ligne de partage entre les bassins versants de la Sarthe (la Hune et le Narais) et du Loir (la Veuve) apparaît donc traversée par une structure synclinale longue de 15 à20 kilomètres de direction nord-ouest sud-est et s'approfondissant vers le nord-ouest.

Fig 2 - Cliquer sur la carte pour l'agrandir
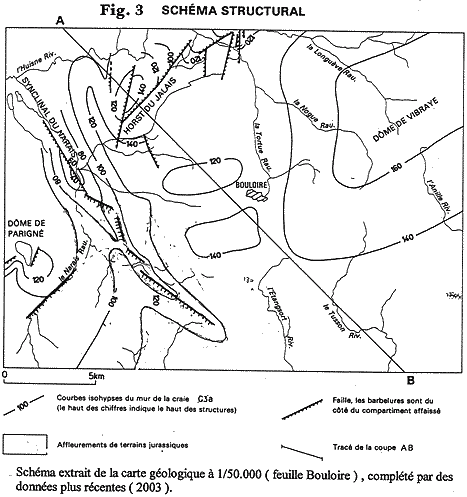
|
|
CONFIGURATION HYDROGEOLOGIQUE DE LA ZONE D'ÉTUDE
Formations aquifères
Ce sont les mêmes que celles connues
plus à l'est dans le Perche méridional et la haute vallée du Loir. Depuis la surface du plateau, on trouve
successivement en allant vers le bas :
- a) Couverture perméable des sables à silex de l'Eocène. Elle recouvre partout la surface du plateau. Elle peut être localement aquifère là où des lentilles argileuses retiennent les eaux pluviales : des sources ou émergences à faible débit apparaissent alors, sans relation avec les aquifères profonds. C'est le cas ici de part et d'autre de la cote NGF + 150 mètres, au sud du bois des «Sapins des Pauvres » (la Grande Fontaine, la Pointe). Cette couverture éocène est découpée par l'érosion sur les flancs des vallées entaillant le plateau où elle est remplacée par des colluvions de pente également perméables.
- b) Le fond des vallées principales est remblayé par des alluvions aquifères, reliés ou non aux aquifères profonds. C'est le cas de la vallée du Narais et de son affluent la Hune.
- c) Craie et calcaires turoniens
- Aquifère de type fissural karstique à coefficient d'emmagasinement (S) et à perméabilité (K) élevée, particulièrement dans les couloirs de failles et de fractures.
S = 10-5 à 10-3 m3 K = 10-3 à 0,5 m/s - d) Sables du Perche (Cénomanien supérieur)
- Epaisseur : 5 à 10 mètres.
- Aquifère de type matriciel ou matriciel-fissural dans les niveaux gréseux.
- Coefficient d'emmagasinement (S) et perméabilité (K) variables suivant les niveaux, plus élevés dans les couloirs de failles et de fractures.
S=10-4à10-3m3 K = 10-6 à 10-3 m/s - e) Marnes de Bouffry (Cénomanien moyen)
- Epaisseur : 9 mètres.
- Formation semi-imperméable (K = 10-8 m/s) séparant l'aquifère des sables du Perche de l'aquifère des sables du Maine. Cependant, dans les couloirs de failles ou de fractures, sa perméabilité K peut augmenter suffisamment pour faire communiquer les deux aquifères. - f) Sables du Maine (Cénomanien moyen)
- Epaisseur : de 22 à 45 mètres.
- Aquifère de même type que les sables du Perche avec des paramètres K et S variables suivant les niveaux. - g) Marnes de Ballon (Cénomanien inférieur)
Epaisse formation imperméable séparant les aquifères du Cénomanien des aquifères sous-jacents de l'Albien-Aptien (non atteints par forage dans la zone d'étude).
Structures drainantes (figure 2)
Ce sont en général les lignes de failles et de fractures
décrites ci-dessus (cf. Observations tectoniques). Mais la structure majeure qui apparaît comme le principal
collecteur régional est le synclinal crétacé du Narais et la faille qui l'accompagne entre le bois des « Sapins des
Pauvres » au sud-est et SAINT MARS LA BRIERE au nord-ouest. L'axe de ce synclinal plonge vers le nord-ouest.
L'écoulement des eaux souterraines se ferait donc du sud-est (limite des bassins versants de la Hune et de la Veuve)
vers le nord-ouest (confluent du Narais et de l'Huisne). I1 collecterait les eaux drainées par les couloirs de
fracturations sécants (de direction moyenne sud-ouest nord-est) affectant le bassin versant de la Hune et du Narais.
Piézométrie (fig.4)
Dans 23 puits et forages situés dans la zone d'étude, on a pu connaître les profondeurs
des niveaux statiques piézométriques, d'où on a pu déduire les variations altimétriques NGF de la surface piézométrique.
La figure 4 est une carte en courbes isohypses (courbes d'égale altitude). Elle représente les variations de la
surface de la nappe phréatique des aquifères de la craie et des sables du Perche.
Cette nappe phréatique est en
situation de nappe libre dont les exutoires naturels connus sont la source de la Hune (ancien captage) à +125 mètres
et la source de la Veuve (captage A.E.P. en service) à +130 mètres.
Les courbes isohypses dessinent une anomalie
positive très nette culminant à +145 mètres au-dessus de la piézométrie moyenne du plateau calaisien à l'est, qui est
à plus ou moins 125 mètres.
Cette anomalie forme une crête piézométrique qui suit la limite entre les bassins de la
Hune et de la Veuve dans le secteur du bois des « Sapins des Pauvres ». La cote topographique de ce bois étant autour
de NGF +160 mètres, la surface de la nappe phréatique n'est ici qu'à 15 mètres sous la surface topographique.
L'axe de cette crête piézométrique détermine le sens d'écoulement des eaux souterraines, une partie dirigée vers
le bassin de la Veuve, l'autre partie dirigée vers le bassin de la Hune.
La présence de vallées sèches induites
par des dissolutions karstiques dans la craie turonienne sous le recouvrement éocène indique la présence de drains
souterrains dans la craie.
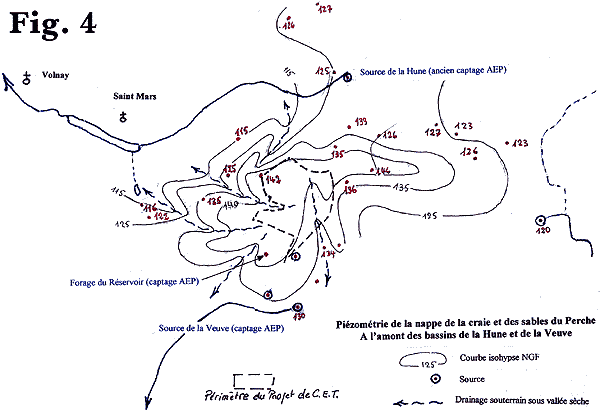
|
|
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Dans la zone d'étude telle que définie au paragraphe 1, la vulnérabilité sur le
plan qualitatif des eaux souterraines et de surface atteint son maximum sur le secteur boisé de CORBUON et des
« Sapins des Pauvres » pour les raisons suivantes :
- Les eaux de surface
Le secteur est situé sur la ligne de
partage des eaux entre les bassins de la Sarthe et du Loir. Les cours d'eau directement concernés sont la Hune et le
Narain au nord et la Veuve au sud. Les écoulements de surface sont susceptibles, à partir d'une source de pollution à
l'amont, de transporter des agents polluants sous forme de gels organiques, de micro-organismes pathogènes et de
solutions de métaux lourds, en direction des agglomérations de SAINT MARS DE LOCQUENAY, VOLNAY, SAINT MARS LA BRIERE
au nord-ouest et LE GRAND LUCE au sud.
En général, on observe que les solutions de métaux lourds, même très diluées
en amont, ont tendance à précipiter et à se reconcentrer en certains points dans les dépôts alluvionnaires actuels des
fonds de vallée. En période de crue, ces points ont tendance à se rediluer puis à se reconcentrer plus loin en aval,
ainsi de suite sur des distances plurikilométriques. L'exploitation d'eau minérale "Cristaline", située en aval à 12
kilomètres du bois des "Sapins des Pauvres" sur les alluvions du Narain, pourrait à long terme être concernée par une
pollution alluvionnaire, au niveau des têtes de captage, en cas d'émission importante d'agents polluants en amont.
- Les eaux souterraines
- a) La carte piézométrique montre que la nappe phréatique du Turonien - Cénomanien supérieur ne se trouve qu'à 15 mètres sous la surface des "Sapins des Pauvres". La mise en place d'un centre d'enfouissement de déchets nécessitant une ou plusieurs excavations, le fond de ces excavations se trouverait dangereusement proche du niveau piézométrique.
- b) La nappe phréatique du Turonien - Cénomanien est une nappe libre, non protégée des infiltrations superficielles par un écran imperméable continu.
- c) L'axe synclinal
crétacé du Narais atteint le plateau où est situé le bois des "Sapins des Pauvres". Cette structure est le collecteur
de drainage principal des eaux souterraines issues des aquifères de la craie turonienne et des sables du Perche.
Les sables du Maine sous-jacents sont en principe en situation de nappe captive protégée sous la couche imperméable des marnes de Bouffry (Cénomanien moyen). Cependant la faille majeure qui suit l'axe synclinal du Narais jusque vers SAINT MARS LA BRIERE est susceptible de rompre localement cet écran imperméable et de mettre en communication la nappe profonde des sables du Maine avec les nappes libres supérieures de la craie et des sables du Perche. Si c'est le cas, l'exploitation d'eau minérale "Cristaline", qui exploite la nappe des sables du Maine sur le trajet de cette faille, pourrait à long terme être confrontée à des risques de pollution latérale au niveau du captage,
s'ajoutant aux risques de pollution de surface par les alluvions comme nous le signalons plus haut, ceci en cas d'émissions importantes d'agents polluants en amont. - d) Comme l'indique la notice de la carte géologique au
1/50.000, la fracturation est importante au niveau des couches compétentes de l'Eocène et de la craie du Turonien.
Notre étude géomorphologique sur photos aériennes le confirme avec en plus des figures de dissolutions karstiques au
niveau de la craie turonienne, se manifestant sous forme de vallées sèches de part et d'autre de la limite de bassin
entre la Hune et la Veuve.
Ces vallées sèches indiquent des écoulements souterrains vers les deux bassins à partir de la crête topographique des bois de CORBUON et des « Sapins des Pauvres ».
La fracturation à laquelle s'ajoute la dissolution karstique de la craie induit un coefficient d'emmagasinement et une perméabilité avec des valeurs élevées d'où une transmissivité et une vitesse de transfert importante, empêchant la filtration des agents polluants. - e) Trois captages A.E.P. sont situés dans le secteur sensible proche de la crête piézométrique. Il s'agit de la
source captée de la Veuve (captage actuel dans le Turonien), de la source de la Hune (captage ancien dans le Turonien)
et du forage du Réservoir (captage au Cénomanien). Ces trois captages sont situés à l'intérieur d'un cercle de 1.500
mètres de rayon, centré sur le bois des « Sapins des Pauvres » (figure 4).
Ces trois captages A.E.P.pourraient être inscrits à l'intérieur d'un Périmètre de Sécurité Rapprochée qui couvrirait la zone de vulnérabilité maximale des eaux de surface et des eaux souterraines .
Aucun projet industriel à haut risque de pollution tel qu'un centre d'enfouissement de déchets ne serait autorisé à s'implanter à l'intérieur de ce périmètre.