![]()
N° 7 - 2001
LES SOURCES DU NORD SANCERROIS
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf
Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit.
Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement
| Cette étude est la continuation vers le sud de celle
intitulée "Les sources du Pays de Beaulieu en Haut Berry" parue dans
la Chronique des Sources et Fontaines n° 3-1996.
Comme celle-ci, elle est basée sur un traitement d'images numériques de photos aériennes et satellitaires, appuyées par des reconnaissances de terrain. Des données tectoniques nouvelles, principalement un réseau de failles accompagnant le grand accident nord-sud de SANCERRE, ont été mises en évidence, en relation avec un grand nombre de sources et d'émergences d'eaux souterraines.
CADRE GÉOLOGIQUE Stratigraphie - Lithologie |
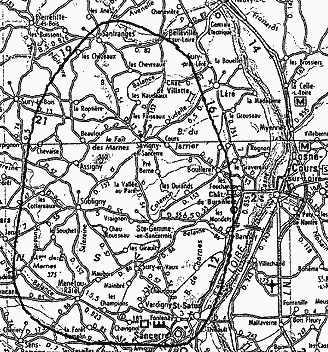 |
En descendant vers le sud, entre SANTRANGES et SANCERRE, on observe successivement les terrains suivants (de haut en bas dans l'ordre stratigraphique)
| a) Cénomanien (c2) | |||||||
|
|||||||
| b) Albien (c1) | |||||||
|
|||||||
| c) Barrémien (n4) | |||||||
|
|||||||
| d) Hauterivien (h3) | |||||||
|
|||||||
| e) Portlandien (j9) | |||||||
|
|||||||
| f) Kimméridgien (j8) | |||||||
|
La succession stratigraphique énumérée ci-dessus n'est
visible en affleurements que sur le compartiment haut (c'est-à-dire à l'ouest)
de la grande faille régionale de SANCERRE.
Sur le compartiment bas, c'est-à-dire à l'est vers le Val
de Loire, ces terrains sont généralement recouverts par les cailloutis à
silex de l'Éocène inférieur(es) et les limons des plateaux (LP).
Tectonique (voir la carte
ci-jointe)
L'analyse géomorphologique par traitement d'image numérique
a apporté les données suivantes :
| - Le tracé de la grande faille de SANCERRE apparaît
correctement représenté sur la carte géologique au 1/50.000 (feuille Léré)
: au nord de SAVIGNY EN SANCERRE, sa direction moyenne est N145E; au sud de
cette localité, elle s'infléchit à N170E jusqu'à SAINT GEMME puis à N5E à la hauteur de SANCERRE. Son regard est vers l'est. Sur le compartiment bas affleurent les terrains éocènes; sur le compartiment haut c'est l'Albien. Selon des rapports pétroliers, son rejet serait de 270 mètres à SANCERRE et se réduirait vers le nord à 165 mètres près de SANTRANGES. Un gradin intermédiaire dessine une morphostructure entre SANTRANGES et SAVIGNY EN SANCERRE (non représenté sur la carte géologique au 1/50.000). |
|
| - Le compartiment haut (à l'ouest de la grande faille) apparaît parcouru par un réseau de linéations géomorphologiques correspondant à des failles et des fractures de distension. Ce réseau dessine un fuseau dont la pointe nord se situe à SANTRANGES et la pointe sud entre MENETOURATEL et SANCERRE. Son extension latérale maximum est au sud-ouest d'ASSIGNY. Ce réseau est probablement un "fuseau de distension" induit par le changement de direction de la grande faille de SANCERRE. Il perturbe le pendage régional du jurassique et du crétacé en créant des gradins de faible amplitude descendant vers l'ouest. |
HYDROGÉOLOGIE
Le secteur d'étude si situe à cheval sur la ligne de
partage des eaux entre le Val de Loire à l'est, le bassin de la Sauldre à
l'ouest et le sous-bassin de la rivière de "Notre Heure" au
nord-ouest, qui rejoint la Loire à la hauteur de GIEN.
L'inventaire de 37 groupes de sources (voir tableau)
et leur localisation dans la séquence stratigraphique allant du Cénomanien au
Kimméridgien permet de définir plusieurs niveaux aquifères
| 1. Craie marneuse du Cénomanien : Médiocre aquifère de type fissural : 5 sources dans des couloirs de faille mettent probablement cet horizon en communication avec des aquifères sous-jacents. | |
| 2. Sables de la Puisa de l'Albien supérieur : Excellent aquifère de type homogène intergranulaire : 14 sources et groupes de sources y ont été répertoriés dans les environs de SANTRANGES, d'ASSIGNY et de SUBLIGNY. Elles sont généralement situées le long de couloirs de failles affectant les parties indurées de la formation ou dans des alignements de flexures dans les parties meubles. Ces sources apparaissent toutes au contact des argiles de Myennes sous-jacentes qui jouent le rôle de plancher imperméable. En dehors des couloirs de faille, on peut en déduire qu'une première nappe phréatique "perchée" occupé les sables de la Puisaye épais de 30 mètres, au dessus de l'horizon des argiles de Myennes, entre +180 mètres et 325 mètres d'altitude. | |
| 3. Sables verts de l'Albien inférieur et sables du Barrémien : Excellent aquifère de type homogène intergranulaire, situé sous le toit imperméable des argiles de Myennes : 2 groupes de sources y ont été inventoriés au sud de SANTRANGES, dans la zone fracturée et flexurée de la grande faille de SANCERRE. 2 sources isolées apparaissent également de part et d'autre d'une faille au sud de SUBLIGNY. L'absence d'écran imperméable à sa base rend cet aquifère solidaire des aquifères jurassiques sous-jacents. | |
| 4. Calcaires et
calcaires marneux du Jurassique supérieur :
Aquifères de type fissural karstique : les eaux souterraines y circulent et
sont stockées dans les réseaux excavés par l'érosion karstique
préférentiellement le long et dans les couloirs fracturés. Quatorze groupes de sources y ont été inventoriés dans la zone d'affleurements jurassiques qui. bordent à l'ouest la grande faille de SANCERRE au sud de SAVIGNY EN SANCERRE, ainsi que dans les "boutonnières" d'érosion apparaissant à MENETOU-RATEL et dans la partie amont de la vallée de la Salereine au sud de SUBLIGNY. |
Indices piézométriques
Les sources sont des exutoires ponctuels des eaux
souterraines. Elles apparaissent par action de l'érosion par les eaux de
surface qui fait affleurer les roches aquifères drainées ou non par des
fractures, des flexures ou des failles.
La cote d'altitude des points où apparaissent les sources est donc une indication du niveau piézométrique
local.
Dans le secteur étudié ici, on doit considérer deux
niveaux piézométriques distincts : l'un correspond aux formations aquifères
situées au-dessus des argiles de Myennes de l'Albien. Comme nous l'avons vu
plus haut, il témoigne de la présence d'une "nappe perchée" assez
étendue.
L'autre correspond aux formations situées au-dessous des
argiles de Myennes et concerne principalement les aquifères karstiques profonds
du jurassique supérieur dont la zone saturée pourrait atteindre 700 mètres
d'épaisseur jusqu'aux argiles du Toarcien (Lias).
Les cotes d'altitude données dans le tableau sont donc les indices de deux niveaux piézométriques superposés :
| - Le niveau piézométrique supérieur qui est celui de la "nappe perchée" varie de +220 mètres à +325 mètres du nord vers le sud. | |
| - Le niveau piézométrique inférieur qui marque la (mite entre zone libre et zone saturée dans les aquifères profonds du jurassique varie de +225 mètres à +260 mètres. Ce niveau piézométrique apparaît fortement rabattu le long du "couloir" de la grande faille de SANCERRE : son altitude n'y dépasse pas +190 mètres. Un tel rabattement est l'indice d'un fort drainage des eaux souterraines le long de la grande faille 0 |