![]()
N° 7 - 2001
OBSERVATIONS HYDROGÉOLOGIQUES
DANS LA RÉGION DU FAOUËT (MORBIHAN)
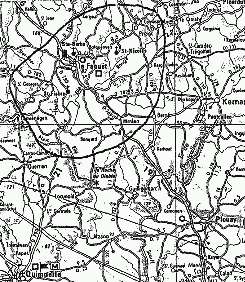 |
C'est à la demande de trois associations riveraines que nous avons effectué cette étude elle concerne deux projets de porcheries industrielles avec épandage des lisiers et un projet de réaménagement routier. Dans le secteur concerné, on observe un grand nombre de sources attestant la présence en profondeur de systèmes aquifères libres. Suivant notre procédure habituelle de traitement d'image numérique et contrôles sur le terrain, on a pu mettre en évidence deux types de structures aquifères : un réseau nord-sud de failles distensives récentes et des zones de cisaillement anciennes allongées ouest-est avec des décollements des épontes peut-être contemporaines de la fracturation nord-sud. Les sources jalonnent ces structures dont la présence signifie des ressources en eau potable très vulnérables.
|
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
I - NOTE HYDROGÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE SUR LE SECTEUR MESLAN-PRIZIAC (MORBIHAN)
Le secteur d'étude se situe sur la partie moyenne du bassin de l'Ellé et de
son affluent l'Aër. Les communes concernées sont MESLAN, PRIZIAC et LE
FAOUËT.
L'objet de l'étude est l'évaluation des risques de
pollution des eaux souterraines et des sources par l'épandage de lisiers
provenant de deux projets d'élevage industriel de porcs aux lieux-dits LE
GUELLEC et LICHOUËT
1. ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE
Les données antérieures locales sont rares et peu
utilisables en hydrogéologie. Nous avons donc procédé à une analyse
géomorphologique du secteur pour repérer les principales structures
tectoniques. Cette analyse est basée sur l'interprétation de photos aériennes par traitement
informatique d'images numérisées. Elle a été suivie par un contrôle sur le
terrain.
L'ensemble des données recueillies reste très fragmentaire
à ce stade de reconnaissance, mais permet néanmoins de formuler un premier
diagnostic sur la vulnérabilité des eaux souterraines dans l'emprise du
projet.
Les données sont figurées sur la carte jointe au rapport.
1.1. Formations lithologiques
Deux formations principales constituent le soubassement du
secteur
| a) un granite à 2 micas, massif, | |
| b) une séquence métamorphique, localement schistosée comprenant des gneiss et des migmatites. |
La composition chimique et minéralogique de ces deux
formations est similaire : elle donne des sols acides, sablonneux sur les
hauteurs, argilosableux et tourbeux dans les creux. Cette ségrégation est due
au ruissellement des eaux pluviales.
Sous la couche des sols on observe une désagrégation de la
roche sur quelques mètres, qui a également pour cause l'action des eaux
pluviales.
1.2. Structures tectoniques
On observe deux phases de déformation
| a) Une phase ancienne de cisaillements orientés sud- ouest nord-est, qui affectent uniquement les gneiss en
créant des "couloirs" schisteux (shear-zones) où les minéraux
constituants de la roche primitive sont broyés et réalignés en feuillets. Au stade actuel de nos recherches, nous avons repéré trois de ces shear-zones : entre LE Î?AOUËT et le sud de PRIZIAC, au sud de la chapelle de SAINT GUÉNOLÉ et au nord de MESLAN entre la vallée de l'Ellé et KERGROAZ. Les shear-zones n'affectent pas le granite. Il apparaît donc probable que la mise en place de ce dernier soit postérieure à la phase compressive ayant créé les shear-zones dans les gneiss. |
|
| b) Une phase tardive de fracturation affectant à la fois le
granite et les gneiss. Les failles et fractures de cette phase sont orientées
nord-ouest sud-est. Elles recoupent orthogonalement les anciennes shear-zones
ainsi que le limites entre granite et gneiss. Cette phase distensive paraît avoir disloqué préférentiellement les contacts entre shear-zones et gneiss sains avec, localement, formation de filons de quartz provenant d'une circulation précoce d'eaux thermales souterraines. Les filons de quartz sont eux-mêmes disloqués par une fracturation encore plus tardive. |
2. CONSÉQUENCES HYDROGÉOLOGIQUES
Les granites et gneiss sont normalement des roches massives
imperméables. Les dislocations et fracturations décrites ci-dessus les
transforment localement en réservoirs aquifères souterrains.
Le réseau des shear-zones disloquées et des failles
récentes induit le piégeage des eaux pluviales et leur stockage dans des
"couloirs" de fracturation.
La présence de ces systèmes aquifères profonds est
démontrée par la multiplicité des sources et émergences diffuses que l'on
peut observer dans le secteur d'étude.
Sur la carte ci-jointe, une vingtaine de ces sources ont
été indiquées, mais il est probable qu'il en existe un plus grand nombre.
(Nous entendons par source le point où un aquifère souterrain rencontre la
surface du fait, de (érosion des reliefs.)
La source indique ici la cote d'altitude du niveau
piézométrique, c'est-à-dire le niveau d'équilibre entre l'eau souterraine
contenue dans les fissures noyées (zone saturée) et l'air atmosphérique
contenu dans les parties fissurées proches de la surface (zone de pénétration
des eaux pluviales).
Le niveau piézométrique varie en fonction des soutirages en
fond de vallée par les cours d'eau collecteurs et en fonction des drainages par
les "couloirs" de failles.
Dans le secteur d'étude, aucun écran imperméable (sauf
points isolés en fond de vallon) ne s'interpose entre la surface du sol et le
niveau piézométrique : les eaux pluviales percolent librement d'abord à
travers les sols superficiels, puis dans la couche rocheuse altérée pour s'infiltrer
finalement dans le réseau des fractures et des failles de la roche saine.
Il en résulte une vulnérabilité importante des eaux
souterraines aux agents polluants liquides venus de la surface.
3. CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES PARTICULIÈRES DES AIRES D'ÉPANDAGE
3.1. Le Gellec
| - Rive orientale de l'Ellé. | |
| - Eaux de surface : écoulements directs dans l'Ellé vers l'ouest et vers le nord. | |
| - Eaux souterraines : deux lignes de sources, l'une dans la partie ouest de l'aire à la cote +75 mètres, l'autre dans la partie centrale à la cote +115 mètres. On note également la présence d'au moins deux forages captants, l'un à BOURRIEC débitant 7,5 m3/h, l'autre à KERVRAN débitant 7 m3/h. | |
| - Structures drainantes deux grandes failles. L'une suit la vallée de l'Ellé avec une direction N10E, l'autre au nord-est de l'aire avec une direction N140E. Deux shear-zones traversent l'aire d'ouest en est suivant une direction N80E. |
3.2. Rozanpouillot
| - Vallée affluente du versant sud de l'Aër. | |
| - Eaux de surface : écoulements confluents vers le nord. | |
| - Eaux souterraines : une source à LE GARVIC à la cote +90 mètres. | |
| - Structures drainantes : une grande faille de direction N160E dans la partie centrale. |
3.3. Pistiagon - Zinzec
| - Sous-bassin du versant sud de l'Aër : ruisseau de KERVAZO. | |
| - Eaux de surface : écoulements vers le sud dans la partie amont du sous-bassin puis s'infléchissant vers l'ouest en aval. Sur la limite nord-ouest, écoulements directs vers l'Aër. | |
| - Eaux souterraines : deux lignes de sources. L'une dans la partie nord de l'aire (entre la chapelle de POULRAN à la cote +140 mètres et RESTINOIS), l'autre dans la partie est (entre PISTIAGON et ZINZEC à la cote +110 mètres). | |
| - Structures drainantes : une shear-zone orientée N80E traverse toute l'aire. Elle interfère avec un réseau de failles méridiennes orientées N160E. La ligne de sources au nord paraît déterminée par la limite schistosée (?) entre un massif granitique au nord et les gneiss au sud. L'autre groupe de sources est probablement déterminé par un couloir de fractures méridiennes. |
3.4. Lichouët
| - Rive orientale de l'Ellé. | |
| - Eaux de surface : deux ruisseaux se déversant directement dans l'Ellé. Un ruisseau au sud-est se déversant dans l'Aër. | |
| - Eaux souterraines : une ligne de source à la cote +145 mètres. | |
| - Structures drainantes : une shear-zone de direction N80E traverse la moitié sud de l'aire. Elle interfère avec deux grandes failles orientées N160E qui traversent au nord la vallée de l'Ellé. |
3.5. Botqueven
| - Ligne de partage des eaux entre la vallée de l'Ellé et le sous-bassin versant nord de l'Aër. Cette aire est contiguë au sud avec l'aire de LICHOUËT | |
| - Eaux de surface : vallon s'écoulant vers le sud en direction de l'Aër. A l'extrémité nord, un ruisseau se déverse directement dans l'Ellé. | |
| - Eaux souterraines : une source en amont à la cote +135 mètres et un groupe de sources dans une zone de confluence à la partie sud de l'aire, à la cote +85 mètres. | |
| - Structures drainantes : une grande faille orientée N160E traverse l'aire en allongement. Au nord, elle recoupe la vallée de l'Ellé à l'aplomb d'un captage A.E.P. Au sud, elle interfère avec une shear-zone orientée N70-80E. Le groupe de sources de la cote +85 mètres se situe près du point d'interférence. |
4. CONCLUSION
Les cinq aires d'épandage de lisiers décrites ci-dessus
sont regroupées dans un territoire de 21 km2, s'étendant entre la vallée de
l'Ellé et le sous-bassin versant de son affluent l'Aër.
L'environnement hydrologique et géologique est identique
pour ces cinq aires qui, par la nature même des effluents liquides qui y seront déversés, présentent un risque de pollution organique
important (azote organique, bactéries, virus filtrants) pour les eaux de
surface comme pour les eaux souterraines.
Ce risque est déterminé par les facteurs suivants :
| - Un réseau hydrographique de surface dense, fortement encaissé, avec sur les flancs de vallée des dénivelés d'une trentaine de mètres en moyenne avec des pieds de pente supérieurs à 10% entraînant un écoulement rapide des eaux de surface. | |
| - L'absence presque totale de couche imperméable entre la surface du sol et la surface rocheuse du soubassement granitique et gneissique. | |
| - La présence d'eaux souterraines attestée par de nombreuses lignes de sources et d'émergences diffuses réparties sur tout le territoire. | |
| - La nature fissurale des aquifères souterrains due à une fracturation tardive très marquée et omniprésente, entraînant un drainage rapide des eaux souterraines le long des couloirs de failles. Les groupes de sources les plus élevés sont situés au nord-est du territoire vers 140-150 mètr es d'altitude. Les plus bas se situent au sud-ouest, le long de la vallée de l'Ellé, vers 70 - 80 mètres d'altitude. |
La distance entre les sources les plus basses (sous LE
GUELLEC) et les plus hautes (ligne BOTQUENVEN-ZINZEC) est de 5 km environ. Les
sources étant les indicateurs du niveau piézométrique, on peut en déduire la
présence dans l'emprise du secteur d'un gradient piézométrique dirigé vers le sud-ouest de 1,4%, signifiant
un écoulement général des eaux souterraines dans cette direction. Le risque
de pollution du bassin de l'Ellé par les eaux de surface se trouve donc
augmenté par l'émergence en fond de vallée des eaux souterraines.
Le temps qui nous était imparti étant extrêmement court,
nous n'avons pu effectuer un relevé exhaustif des sources et des affleurements
rocheux, ce qui nous aurait permis entre autres de dresser la carte
piézométrique du secteur d'étude.
Néanmoins les quelques éléments que nous avons pu réunir
sont suffisants pour attester la présence d'une ressource en eau souterraine
d'une part et sa vulnérabilité aux agents contaminateurs contenus dans les
lisiers liquides d'autre part.
La mauvaise qualité des eaux de surface dans les captages
A.E.P. actuels du Morbihan et des départements voisins devrait inciter à
préserver pour le futur les ressources en eaux souterraines là où elles n'ont
pas encore été atteintes par les pollutions.
II - NOTE HYDROGEOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE SUR LE SECTEUR OUEST DE PRIZIAC - MORBIHAN (Étude complémentaire)
Cette étude est une extension vers le nord de celle intitulée Note hydrogéologique préliminaire sur le secteur MESLAN-PRIZIAC (Les Amis des Sources - octobre 2000).
Il s'agit d'une analyse géomorphologique du secteur pour repérer les principales structures tectoniques aquifères. La méthode est basée sur l'interprétation de photos aériennes par traitement informatique d'images numérisées. Elle complète une compilation des données géologiques existantes suivie d'un contrôle sur le terrain.
1. LITHOLOGIE
La nature géologique du soubassement est la même que celle
décrite dans l'étude principale, à savoir
| - un granite à 2 micas, massif, | |
| - une séquence métamorphique, localement schistosée, comprenant des gneiss et des migmatites. |
Les limites entre le granite d'une part et les gneiss et migmatites d'autre part sont généralement floues et progressives, l'ensemble ne se différenciant en fait que par divers stades de granitisation.
2. LES STRUCTURES TECTONIQUES
Elles sont repérées par photo-interprétation (voir carte
ci-jointe)
| - Deux lignes de shear-zones (zones de cisaillement) orientées N70E, l'une allant du FAOUËT à PRIZIAC, l'autre au sud de LICHOUËT entre l'Ellé et l'Aër. | |
| - Cinq "couloirs" de failles de distension recoupant la vallée de l'Ellé entre le FAOUËT et KER ANNA, suivant une direction générale N150E. |
3. CONSÉQUENCES HYDROGÉOLOGIQUES
Elles sont les mêmes ici que celles exposées dans l'étude
principale citée ci-dessus.
4. CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES PARTICULIÈRES DES AIRES D'ÉPANDAGE
4.1. Lichouët
| - Rive orientale de l'Ellé. | |
| - Eaux de surface : deux ruisseaux se déversant directement dans l'Ellé au droit de l'agglomération du FAOUËT, en limite nord et sud de la zone d'épandage. A l'ouest, déversement direct de l'épandage dans l'Ellé. | |
| - Eaux souterraines : une ligne de sources, dont celle de la Chapelle Saint Guénolé, suit la cote +145 mètres dans l'emprise de l'aire d'épandage. | |
| - Structures drainantes : une shear-zone de direction N80E dans la partie sud de l'aire concernée. Elle interfère avec deux grandes failles orientées N160E qui traversent au nord la vallée de l'Ellé. |
4.2. Poulmarc'h Crémenec
| - Ligne de partage des eaux entre la vallée de l'Ellé et le sous-bassin versant nord de l'Aër. | |
| - Eaux de surface : deux groupes de ruisseaux. L'un draine la localité de POULMARC'H avant de se jeter dans l'Ellé au droit du captage A.E.P. de BARRÉGAN. Le second draine la localité de CRÉMENEC avant de rejoindre l'Aër à la hauteur du STÉROU. | |
| - Eaux souterraines : émergences donnant naissance aux ruisseaux cités ci-dessus. Une source à l'ouest de CRÉMENEC. | |
| - Structures drainantes : un grand "couloir" de failles de direction N160E borde les aires d'épandage à l'est. Il franchit la limite des bassins versants de l'Ellé et de l'Aër à la KROEZER MAOUT. Vers le nord, il franchit l'Ellé à KERHOAT. Vers le sud, il franchit l'Aër au STÉROU. |
4.3. Treuscoat
| - Sous-bassin versant nord de l'Aër, près de sa limite amont. | |
| - Eaux de surface : partie amont du ruisseau de CRÉMENEC, en rive gauche | |
| - Eaux souterraines : émergences du ruisseau ci-dessus à la cote +160 mètres. | |
| - Structures drainantes : la bordure ouest de l'aire d'épandage suit le grand "couloir de failles" de direction N160E décrit ci-dessus. |
4.4. Quilvien
| - Sous-bassin versant nord de l'Aër. | |
| - Eaux de surface : ruisseau affluent de rive gauche du ruisseau de CRÉMENEC. | |
| - Eaux souterraines : ligne d'émergences donnant naissance au ruisseau ci-dessus à la cote +164 mètres. | |
| - Structures drainantes : une grande faille de direction N160E traverse la zone d'épandage du nord au sud. Vers le nord, elle se raccorde probablement à celle qui franchit l'Ellé à KER ANNA. |
4.5. Carnal Braz
| - Bassin versant de l'Ellé | |
| - Eaux de surface : deux ruisseaux se déversant directement bordent au nord et au sud l'aire d'épandage. Celle-ci par ailleurs est contiguë vers l'aval avec le cours de l'Ellé. | |
| - Eaux souterraines : lignes d'émergences donnant naissance aux deux ruisseaux ci-dessus à la cote +140 mètres. | |
| - Structures drainantes : non observées dans ou à proximité de l'aire d'épandage. |
4.6. Kergoat - Chapelle Saint -Yves
| - Bassin versant de l'Ellé. | |
| - Eaux de surface : deux ruisseaux, l'un au nord se jette dans l'Ellé au moulin de KERGOAT, l'autre au sud se jette dans l'Ellé sous COSPEREC BIHAN. | |
| - Eaux souterraines : une source à la chapelle Saint Yves. Elle fait partie d'une ligne d'émergences à la cote +170 mètres qui donne naissance aux deux ruisseaux ci-dessus. | |
| - Structures drainantes : le ruisseau issu de la source de la chapelle Saint Yves coïncide dans sa partie aval avec le prolongement nord du grand "couloir de failles" décrit plus haut à POULMARC'H - CRÉMENEC (4.2.) : il franchit la vallée de l'Ellé à KERHOAT avec une direction N150E. |
5. CONCLUSION
Les six aires d'épandage de lisiers, décrites ci-dessus, se
répartissent sur un territoire de 20 km, situé à cheval sur la ligne de
partage des eaux entre le bassin de l'Ellé et le bassin de l'Aër.
L'environnement hydrogéologique et hydrologique est
identique pour ces six aires qui, par la nature même des effluent liquides qui
y seront déversés, présentent un risque de pollution organique important
(azote organique, bactéries, virus filtrants) et chimique (nitrates, nitrites)
pour les eaux de surface comme pour les eaux souterraines.
Ce risque est déterminé par les facteurs suivants
| - Un réseau hydrographique de surface dense, fortement
encaissé, avec sur les flancs de vallée des dénivelés d'une trentaine de
mètres en moyenne avec des pieds de pente supérieurs à 10% entraînant un
écoulement rapide des eaux de surface. Le haut des pentes où le ruissellement est plus lent comporte presque partout des zones de tourbières (sous les lignes de sources et d'émergences ou les fonds de talwegs) riches en acide tannique ferrifère. Des apports massifs de nitrates entraînent la formation de nitrites beaucoup plus toxiques par réaction sur le fer contenu dans l'acide tannique. |
|
| - L'absence générale (sauf sous les tourbières) de couche imperméable entre les granites et gneiss altérés de surface et le soubassement de roche saine. | |
| - La présence d'eaux souterraines, attestée par de nombreuses lignes d'émergences et de sources réparties en fonction des structures tectoniques sur tout le territoire. | |
| - La nature fissurale des aquifères souterrains, due à une fracturation tardive bien marquée et omniprésente, entraînant un drainage rapide des eaux souterraines le long des couloirs de failles. |
A ce propos, le flanc est de la vallée de l'Ellé montre un
gradient piézométrique particulièrement fort entre les sources proches de la
ligne de partage des eaux Ellé-Aër et le fond de la vallée principale; soit
une dénivelée de 30 mètres environ sur un kilomètre, ce qui correspond à
une pente moyenne , de 3%.
Il y a donc un risque généralisé de pollution du cours de
l'Ellé par les eaux de surface et par les eaux souterraines drainées par les
failles.
Le captage A.E.P. de BARRÉGAN (captage en rivière) est
particulièrement menacé par le projet d'épandage de POULMARC'H. Ce dernier
est en effet situé à l'amont d'un groupe de ruisseaux qui se rejoignent pour
se jeter dans l'Ellé au droit des installations de captage.
Signalons qu'un périmètre de protection rapprochée a été
proposé sur avis de l'hydrogéologue agréé (20/07/99).
Nous mettons en garde sur le fait que ce périmètre est
beaucoup trop étroit, car il n'englobe pas les parties amont du réseau hydrographique où sont justement situés
les projets d'épandage. Ce qui s'explique mal car la distance entre le cours de
l'Ellé et la limite amont de ses affluents de rive gauche est ici très
réduite (< 1 km).
Nous pensons que l'aire d'épandage de POULMARC'H menace
directement le captage de BARRÉGAN. L'aire de CARNAL BRAZ, située à 500 mètres plus en amont,
au bord même de l'Ellé, représente également une menace directe pour ce
captage.
Les autres aires sont dangereuses pour le réseau des eaux de
surface comme pour les eaux souterraines dans l'emprise des drainages
souterrains par faille.
Citons plus particulièrement le cas de l'aire de LICHOUËT :
elle est pratiquement contiguë avec le cours de l'Ellé au droit de
l'agglomération du FAOUËT, mais de plus elle est bordée le long de sa limite
sud par une "shear-zone" fracturée où la circulation des eaux
souterraines a entraîné une imprégnation des parties schistosées par de la limonite
et de l'hématite[Fe2 03 H20 F20(OH)].
L'interaction entre ces oxydes de fer et des nitrates provenant des lisiers de
LICHOUËT aurait pour conséquence la formation de nitrites hautement toxiques.
L'effet drainant de la "shear zone" entraînerait cette pollution
chimique (et microbiologique) directement dans l'Ellé au droit du FAOUËT.
III - IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT ROUTIER DE LA R. D .782 KERJULIEN-LE FAOÜET (MORBIHAN)
Cette étude est une extension vers l'ouest de celle
intitulée "Note hydrogéologique préliminaire sur le secteur
MESLAN-PRIZIAC" (Les Amis des Sources - octobre 2000).
Il s'agit d'une analyse géomorphologique du secteur pour
repérer les principales structures tectoniques aquifères. La méthode est
basée sur l'interprétation de photos aériennes par traitement informatique
d'images numérisées. Elle complète une compilation des données géologiques
existantes suivie d'un contrôle sur le terrain.
La nature géologique du soubassement est la même que celle
décrite dans l'étude principale, à savoir
| - un granite à 2 micas, massif, | |
| - une séquence métamorphique, localement schistosée, comprenant des gneiss et des migmatites. |
Les limites entre le granite d'une part et les gneiss et
migmatites d'autre part sont généralement floues et progressives, l'ensemble
ne se différenciant en fait que par divers stades de granitisation.
Les structures tectoniques repérées par photo-interprétation sont :
| a) une zone de cisaillement ouest-est formant une bande
étroite qui suit plus ou moins le tracé modifié de la R.D. 782 entre KERJULIEN à l'ouest
et le MOULIN BADEN à l'est. Cette zone de cisaillement montre plusieurs phases de déformation : une phase de compression primitive schistosant les gneiss par laminage; une phase distensive ancienne colmatée par des filons de quartz parallèles à l'axe de la structure; une phase distensive récente refracturant l'ensemble de la structure : parties schistosées et filons de quartz. |
|
| b) des failles et fractures subméridiennes, probablement contemporaines de la deuxième phase distensive, qui recoupent la zone de cisaillement: |
| - entre LEURIER-CROAJOU et BOURGEAL, | |
| - à VETVEUR, | |
| - à l'est de QUILLIOU, le long de la vallée de l'Inam, | |
| - à KERROUSSEAU, | |
| - à SAINT FIACRE, | |
| - au MOULIN BERZEN, dans la vallée de l'Ellé. |
CONSÉQUENCES HYDROGÉOLOGIQUES
Elles sont les mêmes que celles exposées
dans l'étude principale.
Les dislocations tardives de la zone de cisaillement (shear
zone) et des failles récentes induisent le piégeage des eaux pluviales dans
les parties profondes du soubassement granitique et gneissique et leur stockage
dans des "couloirs" de fracturation. Ces couloirs constituent des
réservoirs souterrains mais également des axes de drainage.
La présence de ces systèmes aquifères profonds est
démontrée par une ligne de sources et d'émergences diffuses qui suit le
"couloir" de la zone de cisaillement :
| - au sud de LEURIER-CROAZOU, | |
| - à VETVEUR, | |
| - tout le long du ruisseau de QUILLIOU entre cette localité et son confluent avec l'Inam au nord du Moulin BADEN, | |
| - au nord-est de SAINT FIACRE. |
Les circulations d'eaux souterraines sont déterminées par
l'interférence du réseau des failles subméridiennes et de la zone de
cisaillement.
Les altitudes des sources entre LEURIER-CROAZOU et la vallée
de l'Inam à PONTBADEN indiquent un gradient piézométrique important: de +135
mètres à +g0 mètres soit une dénivellée de 55 mètres sur une distance de 3
kilomètres. Un tel rabattement induit une circulation rapide des eaux
souterraines entre les parties hautes du plateau clans la région de KERJULIEN
et le flanc ouest du bassin versant dans la région de l'Inam.
Il convient cependant de remarquer que les structures
faillées décrites ci-dessus sont celles qui ont pu être localisées par
photo-interprétation. Il est probable qu'il en existe d'autres, masquées par
l'altération superficielle des granites et des gneiss.
Ainsi le forage de PENQUER, au sud de la zone de
cisaillement, qui débiterait 60 m3/h à60 mètres de profondeur (information
non vérifiée) pourrait être situé sur une faille importante, invisible sur
photo aérienne.
CONCLUSION
1) Les travaux de réaménagement routier entre KERJULIEN et
le MOULIN BADER concernent un tronçon de 5 kilomètres de longueur.
Ce tronçon suit étroitement une importante structure
aquifère constituée par une zone de cisaillement et des filons quartzeux
fracturés, elle-même recoupée par au moins 3 failles de distension
importantes.
Ce corps aquifère est subaffleurant car des sources et des
émergences diffuses apparaissent tout au long de son parcours.
Il en résulte qu'il est très vulnérable.
Les principaux risques encourus sont :
| - un rabattement local du niveau phréatique dû au captage d'une partie des eaux de ruissellement par les ouvrages de drainage accompagnant la chaussée, ce qui pourrait entraîner le tarissement de certaines sources, | |
| - des pollutions accidentelles de l'eau souterraine dues aux aléas de transports lourds de produits polluants tels qu'hydrocarbures, engrais liquides, produits chimiques toxiques. |
2) Le projet de déviation sud du FAOÜET, qui fait suite
vers l'est au tronçon KERJULIEN-MOULIN BADEN, recoupe au moins 4 grandes
failles de distension de direction nord-ouest sud-est.
Ces failles peuvent constituer des couloirs de drainage des
eaux souterraines provenant du plateau au nord du FAOÜET entre les bassins
versants de l'Ellé et de l'Inam.
Une seule source est répertoriée à 500 mètres au nord-est
de SAINT FIACRE. Elle se situe à l'aplomb d'une zone de cisaillement orientée
sudouest nord-est, observable sur seulement 1 kilomètre de long en
photointerprétation. Le projet de déviation passe à 1 kilomètre au nord de
la source et ne paraît donc pas la menacer directement.
Il recoupe orthogonalement les 4 grandes failles ci-dessus.
Par conséquent, les risques de rabattement du niveau phréatique par les
ouvrages de drainage nous paraissent insignifiants. Par contre, les risques de
pollution accidentelle de l'eau souterraine par la circulation de produits
dangereux sur la déviation est du domaine du possible dû fait de
l'interférence des grandes failles dominantes.