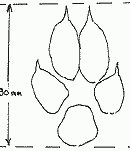![]()
N° 6 - 2000
LES SOURCES DE LA GORDOLASQUE (Mercantour)
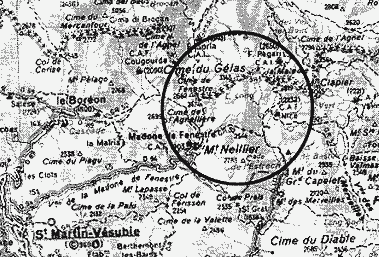
Des observations sur la tectonique récente et les formations paléoglaciaires recueillies depuis plusieurs années, puis reportées sur la carte au 1/25.000, permettent de mieux comprendre l'origine des eaux de la haute vallée de la Gordolasque.
Seules deux sources de roche pérennes ont pu être repérées et étudiées. Elles montrent la part minime que représentent les eaux souterraines dans le débit annuel du torrent principal issu du lac de la Foux.
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
I - LES SOURCES DE LA GORDOLASQUE
La Gordolasque est un affluent de rive gauche de la Vésubie, ellemême
affluent de rive gauche du Var.
Le point le plus haut de son bassin versant se situe à la cime du Gelas
(point culminant de la partie française du massif de l'Argentera Mercantour) à
une altitude de 3.143 mètres. Le point le plus bas de son bassin versant au
confluent avec la Vésubie est à une altitude de 540 mètres. La dénivellation
totale est donc de 2.600 mètres sur une distance à vol d'oiseau de 16
kilomètres, soit une pente moyenne de 16 %. Le régime torrentiel des cours
d'eau du bassin résulte d'une telle pente.
1. Hydrographie de la partie haute du bassin versant
Dans la partie amont du bassin, le cours d'eau principal est le
collecteur
de cinq vallons tributaires qui se déversent dans le lac de la Foux. Ce lac
occupe un replat, la "plaine de la Foux", à l'amont d'un verrou
glaciaire à la cote 2.173 mètres. Il est retenu par un barrage qui a pour
rôle d'écrêter les crues dues à la fonte des neiges et aux orages de
l'été. Les excédents sont évacués par un canal souterrain aboutissant à une conduite
forcée qui alimente en énergie une
centrale électrique située en fond de vallée, à 1,5 km en amont de la
chapelle de SAINT GRAT.
2. Contexte géologique à l'amont du lac de la Foux
La "plaine de la Foux" et les reliefs qui l'entourent ont pour
soubassement rocheux un granite à enclaves amphibolitiques et des anatexites
(gneiss migmatites). Ces formations sont la continuation à l'ouest de failles
décrites dans notre étude sur la région des Merveilles (cf. bibliographie
ci-après). La carte géologique à 1/50.000 (feuille de SAINT MARTIN
VÉSUBIE) est totalement muette en ce qui concerne la tectonique dans ce
secteur.
L'examen stéréoscopique des photos aériennes y montre cependant le
développement d'un réseau de failles et de fractures récentes.
Nous avons procédé à un examen attentif de ces accidents tectoniques
par traitement d'image satellite et par contrôle direct sur le terrain. Leur
cartographie est présentée avec une lettre les identifiant.
(a) Faille du vallon de la Foux
- Extension longitudinale : de la cime de Niré jusqu'au pied sud-est du Mont
Clapier: 2,5 kilomètres
- Signature géomorphologique couloirs rocheux au nord et au sud de la cime
de Niré. Éperon rocheux de la cime Asquasciati (sud du sommet du Mont Clapier)
- Classe: faille normale à regard sud-est
- Estimation du rejet: 120 mètres sous la cime Asquasciati
- Direction: N 24° E entre la cime de Niré et le fond du vallon de la Foux, N 42° E le long de la cime
Asquasciati
- Pendage: 55° vers le sud-est. Mesure sur le terrain
(b) Faille du lac Autier
- Extension longitudinale: du flanc sud du vallon du lac Autier au pas est du
Mont Clapier, puis sur le versant italien longueur supérieure à 3, 5 km. Sur le
versant italien, le prolongement de cette faille est masqué par le glacier du
Clapier.
- Signature géomorphologique : alignement de barres rocheuses sur le flanc
sud du vallon du lac Autier. Couloir rocheux sous la crête est de la tête du
lac Autier. Éperon rocheux de la cime de la Foux.
- Classe: faille normale à regard ouest
- Estimation du rejet: 90 mètres à la cime de la Foux. Direction: N 20° E
-Pendage : 45° ouest, d'après la différence angulaire en direction de la
zone entre la crête du lac Autier et le fond du vallon de Chamineye
(c) Faille du vallon du Mont Clavier
- Extension longitudinale: de la "plaine de la Foux" au point coté
2.695 mètres à l'ouest du Mont Clapier: 1,5 km
- Signature géomorphologique : tracé rectiligne et encaissé du vallon du
Mont Clapier
- Classe : fracture à rejet insignifiant
- Estimation du rejet : ?
- Direction: N 37° E
- Pendage:?
(d) Fermeture nord du graben de Fontanalba
Cette structure est décrite dans "Les failles aquifères du Mont
Bego" - in Riviera Scientifique, oct 1999, p. 60.
Les deux failles bordières du graben se rejoignent sur les pentes nord de
là baisse du Basto, refermant ainsi la structure d'effondrement par un biseau
orienté N 140° E. Ce biseau suit approximativement la zone axiale du grand linéament transalpin Clapier-Merveilles.
(e) Fracture à rejet insignifiant
Allant du vallon du Mont Clapier
au vallon de la Foux.
Sa direction est N 135 °E. Elle recoupe les failles du
vallon du Mont Clapier et du vallon de la Foux. Son pendage est subvertical,
vers le nord.
3. Hydrogéologie des sous-bassins versants en amont du lac de la Foux
Nous avons vu ci-dessus (§ 1) que le lac de la Foux, qui donne naissance au
collecteur principal de la vallée, recevait les eaux de cinq vallons
tributaires.
Nous avons effectué une recherche sur les sources éventuelles qui alimentent les torrents de ces cinq vallons.
De l'est vers l'ouest, voici ce que nous avons observé :
3.1. Vallon du Chamineye
Le cirque amont, très escarpé, est modelé presque uniquement par
l'érosion glaciaire. Les couloirs de roche sont déterminés par des
diaclases profondément crevassées, en partie colmatées par la glace dans
les parties hautes des crêtes. Il en résulte que ces "crevasses"
sont parcourues en permanence par des eaux de fonte qui tombent en cascatelles
successives jusqu'à un petit lac situé au fond du cirque.
Le fond du cirque est remblayé par des éboulis et une moraine résiduelle
d'où sourdent les eaux ruisselant des parois environnantes. Nous n'avons
trouvé aucune émergence issue directement de la roche.
Les eaux du vallon de Chamineye sont donc probablement uniquement des eaux de
surface d'origine nivale et pluviale.
3.2. Vallon de la Foux
Le cirque amont de ce vallon a, comme celui de Chamineye, des parois escarpées avec des dénivelées importantes. Il est soumis comme lui à un
régime d'érosion nival et pluvial. Un ruisseau sourd des dépôts morainiques
occupant le fond du cirque. Ces dépôts de blocs et de cailloutis plus ou moins
fins jouent probablement le rôle de réservoir de rétention, avec une
émergence à son point bas (source de moraine).
Plus en aval, environ 1 km avant le débouché du vallon dans la plaine de
la. Foux (refuge CAF), le ruisseau franchit un ressaut rocheux. A ce point, on
observe une émergence (n° 1 sur la carte) sourdant de la roche en
mélangeant ses eaux à celles du ruisseau. Un plan de faille apparaît bien
visible avec une direction N 40° E et un pendage vers le sud-est de 55 °. Il
s'agit bien de la faille (a) du vallon de la Foux, repérée sur photo satellite
et photo aérienne.
En fait, la source de roche se situe au point d'intersection de cette faille
avec une fracture orientée N 135° E (indiquée (e) sur la carte).
Les eaux souterraines dont elle représente l'exutoire ont probablement pour
origine une bonne partie des eaux nivales et pluviales
infiltrées dans les diaclases des escarpements de la cime Asquasciati sur le
versant sud du mont Clapier mais également de la crête séparant le vallon
de Chamineye du vallon de la Foux Dans les deux cas, la faille (a) joue un rôle
de drainage important.
Remarque: dans le guide d'alpinisme de V. Paschetta (Tende-Gordolasque, itinéraire 117a), une source dite de "la Nymphe" est signalée dans le fond du vallon de la Foux, au pied des barres rocheuses. Elle peut correspondre soit à la source de moraine située au fond du cirque amont soit à la source de roche sortant par la faille (a).
3.3. Vallon du Mont Clapier
C'est une rainure rectiligne entaillant les anatexites qui forment le plateau
incliné du flanc sud-ouest du Mont Clapier. Il est la signature
géomorphologique de la faille (c) décrite au paragraphe 2. Aucun
remblayage morainique n'y apparaît.
A l'intersection de cette faille (c) avec la fracture (e), une source (n° 2
sur la carte) sort directement de la roche dans le plan de faille (c)
. Elle est probablement alimentée souterrainement par les eaux infiltrées du
replat des petits lacs du Clapier situés à 300 mètres au nord et80 mètres
plus haut en altitude.
La fracture (e) joue localement le rôle de drain. Les diaclases mineures
observables sur toute la surface du plateau du flanc sud-ouest du Clapier
infiltrent probablement des eaux pluviales et nivales qui ressortent aussi à
cette source.
3.4. Vallon du lac Long
Le torrent du lac Long est alimenté, comme son nom l'indique, par les eaux
du lac Long. Ce lac est encaissé dans un vaste cirque d'origine glaciaire dont
les parois sont les escarpements du flanc sud-est du Mont Gelas, culminant à
3.143 mètres, ainsi que la crête de la Malédie au nord-est, culminant à
3.059 mètres.
Des reliques de terrasses morainiques s'étagent épisodiquement sur les
flancs du cirque ainsi que de longs couloirs d'éboulis descendant jusqu'au
niveau du lac (2.566 mètres).
Nos observations n'ont pu y déceler aucune source de roche.
Le lac et son déversoir ne sont donc alimentés que par les eaux de
surface résultant de la fonte des neiges et des pluies d'été.
4. Commentaire
En conclusion, seules deux sources issues d'eaux souterraines sont à
l'origine de la Gordolasque. On peut estimer que plus des 9/10 du débit
annuel du collecteur issu du lac de la Foux proviennent du ruissellement de
surface avec deux pointes climatiques par an: la fonte des neiges (avril-mai)
et les orages d'été (juillet-août).
II - LA SOURCE DU TORRENT DE LA GORDOLASQUE (Parc National du Mercantour)
Compte rendu de la sortie des 25 et 26 août
Par Antoine Richard, collégien au Collège Saint François de Salles à
Chambéry, classe de 4ème
1. La vallée de la Gordolasque entre SAINT GRAT et le refuge du C.A.F. de Nice
SAINT GRAT se trouve en montagne, dans le parc national du Mercantour. Nous
sommes partis de SAINT GRAT pour le refuge du C.AF de Nice le mercredi 25 août
à gh00. Nous étions une dizaine pour cette exploration. Au fur et à mesure de
notre progression, les forêts diminuaient fortement. Après une demi-heure de
marche, nous pouvions distinguer des gneiss avec des lignes de minéraux courbes
et tortillées. Avant le "mur des italiens", qui date de la seconde
guerre mondiale et était autrefois l'ancienne frontière entre la France et
l'Italie, nous ne pouvions distinguer que de la verdure, des éboulis et des
sources. Le relief est dû aux glaciers avec une vallée en forme de U qui date
du quaternaire.
Après le "mur des italiens" (2.030 mètres), se dressent de part
et d'autre du sentier la cime de la Roche Garbière à l'est et le mont Neiglier
à l'ouest. Nous pouvions aussi apercevoir l'ancien verrou du glacier et le
torrent qui en sort. De nombreux éboulis dominaient nettement notre parcours.
Comme le parc national du Mercantour est un site protégé, il n'y avait aucun
alpage.
Après deux heures de marche, un barrage se dressait devant nous et le lac de
la Foux derrière celui-ci. L' eau du lac provient des montagnes avoisinantes.
Près du lac, nous avons pu apercevoir des papillons de la famille des hérébas (on ne trouve ces papillons qu'au-dessus de 1.200 mètres). En
montagne, on peut trouver du gneiss fracturé autour du granite. Sur certains
gneiss, on pouvait voir du mica noir (biotite) et du mica blanc (muscovite).
Après trois heures de marche, nous sommes arrivés au refuge de Nice qui est
à 2.232 mètres d'altitude. Le relief depuis SAINT GRAT jusqu'au refuge est du
type glaciaire : on peut voir les marques de l'érosion glaciaire. Un peu plus
loin, nous avons pu découvrir après le barrage une source non indiquée sur
la carte. Durant cette partie de la promenade, nous avons eu un ciel bleu et
clair.
2. Le vallon de la Foux : "la source de la Nymphe"
Nous sommes partis du refuge vers 14h00 pour le vallon de la Foux qui se
trouve à l'est du refuge. Le temps était nuageux et frais. Après une
demi-heure de marche, nous avons pu apercevoir un troupeau de chamois, quelques
marmottes et des grenouilles. Nous avons pu voir sur le sol des gentianes
jaunes, des fougères, des sphaignes et des rhododendrons; dans le cirque de la
Foux, de nombreuses failles et des marques de glaciers. Sur la roche, on pouvait
voir du mica noir (biotite) et du mica blanc (muscovite). La forme du relief est
du type glaciaire. Dans tout le vallon de la Foux on peut distinguer des
éboulis.
Nous avons découvert une source, "la Nymphe". A la source de la
Nymphe, nous avons pu observer une faille de direction N65° avec une
inclinaison de 55° sud. L'altitude était de 2.350 mètres.
Des bouquetins et des chèvres ont été vus au sommet du vallon de la Foux.
3. Le vallon de Chamineye
Le lendemain matin vers gh00, nous sommes partis voir si une source ne se
trouvait pas au vallon de Chamineye. Après une heure et demie de marche, nous
avons pu voir un névé près du lac de Niré et nous avons entendu quelques
grenouilles. Nous avons observé une faille au deuxième lac du vallon de
Chamineye avec une direction N143°, faille à pendage 60° vers l'ouest avec
des remplissages de calcite et des cannelures. Nous avons aussi vu de l'acide
tanique dans les deux lacs du vallon entourés par des conglomérats et une
moraine glaciaire. On a aussi observé des filonnets de quartz et de chlorite
dans le granite. Arrivés à un troisième lac, Pierre de Bretizel nous a
affirmé qu'aucune source ne se trouvait dans le vallon de Chamineye.
Au retour, toujours dans le vallon, nous avons pu voir des traces de loups et
louveteaux dans une mare asséchée.