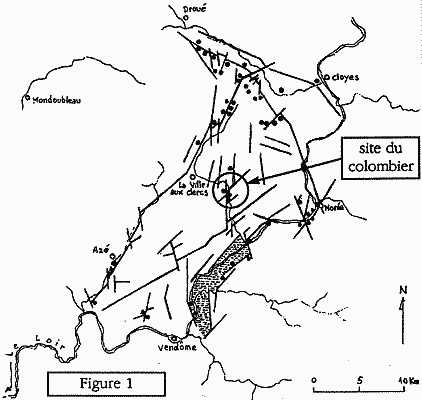![]()
N° 4 - 1997
VULNÉRABILITÉ DES AQUIFÈRES DU CÉNOMANIEN ET DU TURONIEN
DANS LE BASSIN VERSANT DU GRATTELOUP (Perche Vendômois)
par REIG (Recherches et Études Industrielles en Géosciences)
Rapport N° 97.184. Pierre de Bretizel, Dominique Lemaire et Olivier Montenat.
 |
L'existence d'un réseau de failles distensives et l'absence d'une couverture imperméable rendent extrêmement vulnérable à des activités à haut risque de pollution la nappe phréatique dans le bassin versant du Gratteloup, affluent du Loir, au nord de Vendôme. The presence of a open faulting network and the lack of a waterproof overlap make groundwaters higher vulnerable to pollutions within the Gratteloup bassin, tributary of the Loir river (north of vendome). |
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
C' est à partir des observations et de la cartographie géologique faites dans la vallée du Loir par les Amis des ,Sources en 1995 et 1996 qu'à été réalisée par le bureau d'études REIG le travail présenté ici.
Nous le publions "in extenso" pour montrer aux lecteurs de notre chronique, à titre d'exemple, ce que peut être une étude des risques de pollution des eaux souterraines dans un cas précis de stockage de déchets.
Nous tenons également à montrer que les résultats de recherches menées par notre association peuvent servir de base à une expertise technique, dans le cadre d'une enquête publique.
Nous remercions l'association GRATTELOUP NATURE de bien vouloir nous autoriser à publier ce texte.
Cette étude hydrogéologique fait partie d'un programme de recherche régional couvrant le dôme de Fréteval (entre la Braye et le Loir) à l'ouest et le dôme de Marchenoir à l'Est, qui a débuté en 1995 et se poursuit actuellement.
Les données initiales ont été principalement la carte géologique au 1/50.OOOe et sa notice, ainsi que les fiches du Service Géologique Régional. Elles se sont révélées très vite insuffisantes, du fait de l'échelle de la carte bien sûr, mais également du fait de lacunes et d'imprécisions concernant principalement les structures tectoniques et la lithostratigraphie de la couverture post-crétacée.
Nous avons donc entrepris de réaliser une cartographie structurale au 1/25.000e en utilisant principalement l'analyse géomorphologique, appuyée par les photographies aériennes et de nombreux contrôles sur le terrain.
Plusieurs sites ont été étudiés en plus grand détail avec des profils géophysiques (électriques), des profils de trous à la tarière, des analyses pétrographiques, des analyses pédologiques et botaniques.
Sur le bassin, versant du Gratteloup deux sites ont fait l'objet de ces recherches détaillées : le site de stockage et de traitement de déchets du Colombier et le site d'épandage de lisier de
Beauvoir.
Le Gratteloup est un affluent de rive droite du Loir au nord de Vendôme. Son bassin hydrographique draine la majeure partie du flanc sud du dôme de Fréteval. I1 couvre une surface de 72 km2 environ. La dénivellation entre la crête sommitale (NGF, 255 m) de fontaine Raoul et le confluent avec le Loir est de 168 m sur une longueur rectiligne de 14 km, soit une pente moyenne de 1,2 %.
La forêt (feuillus et résineux) couvre la plus grande partie de la moitié amont du bassin. La grande culture céréalière domine la moitié aval.
Les agglomérations sont, de l'amont vers l'aval, Fontaine-Raoul, Chauvigny-du-Perche, La Ville-aux-Clercs, Busloup et Pezou. L'activité industrielle y est représentée par des entreprises de petite taille peu polluantes en général.
1. Lithologie - Stratigraphie.
Les formations sédimentaires qui affleurent dans le bassin s'étagent du Cénomanien supérieur à l'Éocène inférieur. La séquence est la suivante, de bas en haut :
a) Sables du Perche: Cénomanien supérieur.
Sables fins à grossiers, légèrement micacés, de couleur ocre à rouge foncé, avec quelques niveaux indurés (cimentation siliceuse) formant des bancs de grès durs rouge foncé à brun foncé.
Ils affleurent principalement le long du cours principal du Gratteloup en amont de la
Ville-aux-Clercs.
Leur épaisseur est supérieure à 60 m.
b) Formation de la "craie": Crétacé supérieur (Turonien).
Elle affleure rarement, généralement à flanc de coteau. La partie supérieure est constituée de calcaire crayeux à silex, assez dur, passant à la partie inférieure à des faciès plus marneux. Son épaisseur est de 45 m à l'aval du bassin (Monthenry). Elle disparaît totalement vers l'amont au nord de la Ville-aux-Clercs. Elle réapparaît à la bordure amont du bassin (Fontaine-Raoul) où son épaisseur atteint 25 m.
Cette disposition dans la partie médiane du bassin marque la présence d'un paléo-relief ayant été érodé à la période Éocène inférieur. Les produits de cette érosion, notamment les silex forment les conglomérats éocènes recouvrant la craie.
c) Conglomérats à silex : Éocène inférieur.
Ils sont formés d'éléments siliceux cassés, un peu émoussés, emballés dans une matrice
argilo-sableuse.
Dans la partie supérieure, à certains niveaux, la matrice est franchement siliceuse, formant des bancs très durs (perrons) qui arment le rebord des plateaux et se marquant bien en géomorphologie. I1 est possible que cette silicification épigénétique soit la marque d'une nappe phréatique fossile ayant noyé les conglomérats antérieurement à la mise en place du réseau hydrographique actuel.
Localement, on observe la présence de lentilles d'argile plastique, d'épaisseur métrique, de faible extension latérale (quelques centaines de m2). Il s'agit probablement de "flaques" argileuses où dispersées dans les sédiments détritiques grossiers. Elles rappellent les faciès du Sparnacien présents dans l'est du bassin de Paris. Cette formation conglomératique affleure pratiquement partout, sauf dans les vallées. Son épaisseur varie irrégulièrement de 20 à 30 m.
d) Formations superficielles récentes (Quaternaire à actuel).
- Alluvions du Gratteloup.
- Colluvions de pente : silex et sables argileux provenant de l'Éocène.
- Limons des plateaux.
2. Tectonique.
|
|
Les cartes géologiques (feuilles de Cloyes et de
Selommes) n'apportent que peu d'informations tectoniques sur ce secteur. Cependant un examen géomorphologique détaillé, effectué en 1995 et 1996, à partir des photographies aériennes, a permis de mettre en évidence un réseau de grandes fractures affectant la région (voir figure ci-dessous). * Direction N 35-40 E |
* Direction N 55 E
- Faille de Busloup. Elle s'allonge entre Saint-Hilaire-LaGravelle au nord et le Loir à l'aval de Villiers où elle interfère avec la faille du Boulon. Sa longueur est de 25 km. Le regard est vers le sud-est avec un rejet faible.
- Faille des Mussets. Elle recoupe la vallée du Gratteloup à 2 km au nord de la faille de Busloup. Rejet faible vers le sud-est.
- Faille de Fontaine. Elle paraît infléchir le cours du Loir au nord-est de Pezou. Rejet faible vers le sud-est.
- Fossé tectonique de SaintFirrnin-des-Prés. Situé dans la vallée du Loir, en amont de Vendôme, il résulte du jeu d'un faisceau de failles normales : en rive droite les failles de Moncé et Lisle à regard sudest; en rive gauche, la faille de Chimeray à regard nord-ouest. Le graben (fossé) ainsi constitué, détermine le cours du Loir entre Pezou et Saint-Ouen.
* Direction N 120-145 E
Faille de Fontaine-Raoul et Morée. Elle borde la partie amont du bassin versant du
Gratteloup.
Elle s'aligne sur la crête morphologique du dôme de Frèteval. Sa longueur est de 30 km. Son rejet vers le nord atteint 120 m de dénivelée négative ; c'est l'accident le plus important de la région.
* Direction N160-180E
Les failles appartenant à ce groupe sont généralement des décrochements senestres affectant les directions citées précédemment. Elles sont nombreuses mais d'extension longitudinale réduite. Elles déterminent notamment la direction du cours du Gratteloup entre le nord du Palteau et le confluent avec le Loir.
Des observations effectuées sur les anciennes terrasses fluviatiles de 1a vallée du Loir, dont certaines sont datées d'une manière précise par l'archéologie, montrent que le réseau des failles et fractures décrit ci-dessus a joué (ou rejoué) à une époque très récente : quaternaire (glaciation du Riss). La fracturation est en conséquence encore dans un stade précoce de comblement : son effet de drainage des eaux souterraines est donc primordial.
1. Description des aquifères et de leur couverture.
Les réserves aquifères du bassin se répartissent dans deux formations sédimentaires superposées, décrites dans le chapitre précédent : les sables du Perche du Cénomanien supérieur et la craie du Turonien.
1.1. Les sables du Perche.
Ils constituent la ressource en eau potable principale dans le bassin. Ils sont exploités par forages pour l'alimentation des communes de la Ville-auxClercs, Busloup, Pezou et Lisle. La perméabilité de cet aquifère est intergranulaire. La productivité est moyenne dans l'ensemble, exception faite de certains horizons chargés en argile séparant des couches de sable propre. La qualité biologique est bonne, la qualité chimique également à part quelques valeurs élevées en fer.
1.2. La craie du Turonien.
Dans le bassin, seule la partie inférieure de la formation de la craie est représentée, le reste étant érodé.
Elle disparaît totalement au nord de la Ville-aux-Clercs. Elle est séparée de l'aquifère cénomanien par un niveau de craie marneuse, d'épaisseur variable, en principe imperméable en dehors des zones de failles.
La perméabilité de cet aquifère est de type fissural, karstique.
La productivité est très irrégulière, mais peut parfois être importante (> l00m3/h), dépendant du degré de fracturation et de karstification de la craie.
Dans le bassin, cette ressource est exploitée pour l'irrigation et les usages domestiques.
1.3. La couverture éocène.
Dans le bassin, elle est constituée uniquement par 20 à 30 m de conglomérats argilosableux à silex.
L'argile à silex, d'âge crétacé supérieur, représentée partout sur la carte géologique au 1/50.000e en affleurements sur les flancs des coteaux, ne paraît pas exister en tant qu'unité sédimentaire distincte, entre crétacé et éocène, dans l'emprise du bassin. En effet, au cours de notre travail de cartographie les nombreuses observations que nous avons effectuées par des lignes de trous à la tarière ne montre pas de différenciation perceptible entre le sommet des conglomérats éocènes et le toit de la craie ; les mêmes observations ont été faites sur des déblais de forage.
Malgré une teneur moyenne en argile dans la matrice avoisinant 40 % , l'ensemble de ces conglomérats constituent une couverture poreuse et perméable du fait de leur texture grossière. Leur transmissivité pourrait être comparée globalement à des alluvions anciennes (1.10-4 - 1.10-5 m2/s). Les perrons , niveaux durs développés à la partie supérieure de la formation sont probablement dus à une silicification tardive des conglomérats, sans changement particulier du faciès primitif.
Nous avons vu au chapitre précédent que ces "perrons" sont peut-être les témoins d'une nappe fossile, antérieure au réseau hydrographique actuel.
I1 en reste d'ailleurs quelques témoins actuels représentés par de petits niveaux aquifères qui se situent au-dessus de lentilles d'argile plastique. Ces lentilles font office de plancher imperméable. Leur surface dépasse rarement la dizaine d'hectares et leur épaisseur est de l'ordre du mètre.
Les indicateurs de leur présence sont des sources à flanc de coteau, des puits de ferme peu profonds sur le plateau et des étangs dans la forêt de Fréteval comme ceux de la Verrerie et de La Gaudinière.
La couverture éocène repose directement sur le toit de la craie turonienne dans la partie sud du bassin et directement sur les sables cénomaniens dans la partie nord, là où la craie est totalement érodée.
2. Piézométrie.
Du fait du développement important du réseau des failles, les aquifères du Cénomanien et du Turonien sont en communication ouverte à l'intérieur du bassin.
Il ni y a donc qu'une seule nappe phréatique. Sa surface (niveau piézométrique) est dans l'ensemble inclinée selon un gradient régional, plus ou moins parallèle à la surface topographique et structurale (figure 2), entre l'altitude + 200 m à l'amont et l'altitude + 90 m au niveau du Loir, soit une dénivelée de 110 m.
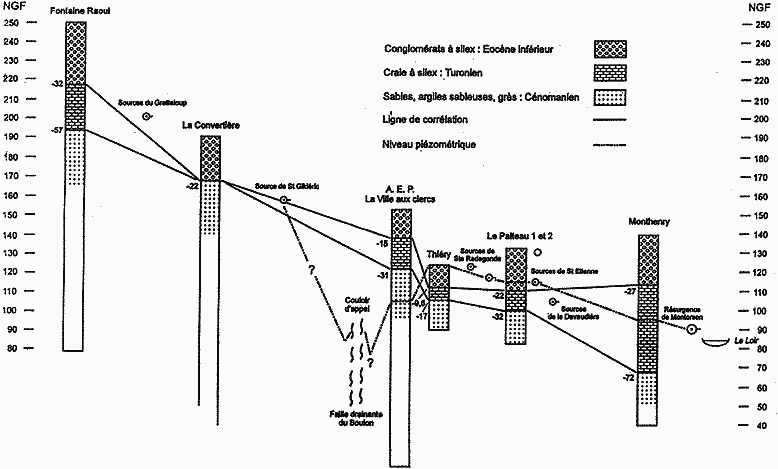
figure n° 2
Dans le détail, ce gradient est fortement perturbé par l'effet de drainage des failles, ce qui entraîne des anomalies d'altitude négatives. Les trois plus importantes anomalies relevées sont situées :
a) Sur la rive gauche du Gratteloup au nord et au Sud de la Ville-aux-Clercs : elle est induite par un couloir de drainage important dû à la grande faille N35-40 observable de Fontaine-Raoul à Azé.
Le captage AEP de la Villeaux-Clercs est probablement dans ce couloir de drainage.
b) Au nord du Colombier elle est induite par un couloir de drainage dû à la faille N55 dite des Mussets observable de l'Essert au sud-ouest du Bois Normand au nord-est.
c) A la hauteur de Busloup elle est induite par un couloirde drainage dû à la faille N 55 dite de Busloup observable depuis Espéreuse au sud-ouest jusqu'au Chène-Vert (Saint-Hilaire) au nord-est.
A ces anomalies dues aux failles drainantes se rajoute dans une moindre mesure un effet dû à la topographie, en amont de Pézou notamment.
Sur la carte de la planche I, les directions d'écoulement des eaux souterraines sont indiquées par des flèches. Les directions sont perpendiculaires aux courbes de niveau piézométriques. Les écoulements se font des parties hautes vers les parties basses.
Les débits et vitesses d'écoulement sont maximaux dans l'axe des couloirs de drainage dues aux failles.
Du fait de la perméabilité de la couverture, la nappe phréatique est libre dans tout le bassin jusqu'au Loir. Pour la même raison, elle 'est alimentée par la surface de presque tout le bassin directement par les eaux fluviatiles et 'les eaux de surface infiltrées.
3. Sources et émergences.
Elles correspondent aux points où affleure la nappe phréatique, généralement dans l'axe de failles drainantes. Elles jouent un rôle de "surverse" climatiques, abondantes en période pluviale où le niveau piézométrique est élevé, intermittentes ou faibles en période sèche quand le niveau piézométrique est bas.
Leur débit peut aussi être influencé lorsque des pompages sollicitent la nappe phréatique : elles peuvent jouer alors le rôle d'indicateur" de niveau.
Dans le bassin du Gratteloup, huit groupes de sources sont inventoriés et décrits dans la "chronique des Sources et Fontaines" n°2-95 et n°3-96 éditée par l'Association "les Amis des Sources" et figurant à l'inventaire de la Société d'Histoire Naturelle du Loir-et-Cher. La plus importante en ce qui concerne le débit est la fontaine de Montorson :cette résurgence est située au niveau du Loir près du confluent du Gratteloup à Pézou. La figure n°3 montre qu'il s'agit du déversoir au point le plus bas des eaux souterraines du bassin. Il est probable qu'elle est également alimentée par les pertes du Gratteloup à Pont l'Ane en aval de Busloup et par la faille N 55 de Fontaine.
Son débit (> 180 m3/h) est important, supérieur à celui du Gratteloup: elle alimente une amorce de rivière qui rejoint le Loir à 300 m au Sud.
La nappe phréatique du bassin versant de Gratteloup est identifiée comme celle du Cénomanien en connexion par fracturation avec celle du Turonien.
La nappe du Cénomanien est considérée comme la plus importante ressource souterraine en eau potable dans l'Ouest du bassin de Paris.
L'étude présentée ici montre que sa vulnérabilité dans le bassin est importante pour les raisons suivantes : elle affleure dans le fond des vallées, donnant naissance à un grand nombre d'émergences.
Un important réseau de failles distensives y modifie la piézométrie régionale en créant des couloirs d'appel par un drainage fort.
C'est une nappe libre à écoulement rapide sans protection de la surface par un recouvrement.
Son recouvrement jusqu'à la surface n'est constitué que par la formation conglomératique de l'Éocène inférieur, qui est, à de rares exceptions près, perméable et poreuse du fait de sa nature et de sa texture.
L'impluvium (surface où s'infiltrent les eaux pluviales alimentant la nappe topographique) correspond à peu près partout à la surface totale du bassin. Il est donc fortement recommandé d'éviter toute activité à haut risque de pollution dans l'ensemble du bassin.
VII - ÉTUDE DE DÉTAIL D'UN SITE D'ACTIVITÉ A HAUT RISQUE DE POLLUTION
Le site de stockage et de traitement de déchets du Colombier (figure 1)
Un examen plus détaillé des conditions de terrain a été réalisé dans l'emprise du projet faisant l'objet de l'enquête publique du 6 janvier 1998.
Dans le cadre de cette enquête, les travaux complémentaires suivants ont été réalisés :
a) Établissement du log géologique détaillé du forage du Palteau n°1 exécuté aux fins d'irrigation. La nappe y est captée dans les sables du Cénomanien.
b) Exécution d'un forage de reconnaissance (Palteau n°2) entre la ferme de Saint-Étienne et la ferme du Colombier. Ce forage a traversé la couverture éocène et atteint la craie du Turonien. Étude granulométrique de la couverture éocène pour déterminer la proportion d'argile contenue dans la matrice du conglomérat.
c) Exécution à flanc de coteau de quatre lignes de trous à la tarière (profondeur 1 mètre , espacement 50 m) entre la ferme du Colombier et le fond de la vallée du Gratteloup. Étude granulométrique des échantillons.
d) Étude géophysique: mesure des résistivité par la méthode Schlumberger : Exécution de quatre profils entre la ferme du Colombier et le fond de la vallée du
Gratteloup.
e) Observations pédologiques et botaniques dans les parties boisées situées entre la ferme du Colombier et le fond de la vallée du
Gratteloup.
f) Inventaire des sources et lignes d'émergences.
1. Données recueillies dans les deux forages du Palteau (figure 3).
Le n°1, dans le fond de la vallée a atteint le toit des sables du Cénomanien à 16 m de profondeur après avoir traversé 10 m seulement de craie
turonienne.
Ce forage est artésien avec une côte piézométrique à + 115 (juillet 1997).
Étant donné le contexte très fracturé de cette partie du bassin on peut considérer que les deux aquifères turonien et cénomanien ne font qu'un: avec une nappe phréatique affleurante, à 1 ou 2 m au-dessus du lit de
Gratteloup.
Le n°2, situé sur le rebord du plateau du Colombier, a traversé 22 mètres de conglomérats éocènes avant d'atteindre la craie turonienne. Le niveau piézométrique est à peu près à la côte + 115 également : il est situé dans les conglomérats à 15 mètres sous la surface. Si on corrèle ce forage avec le forage P21 effectué dans le périmètre prévu pour le stockage des déchets, on constate une baisse de 5 mètres au niveau piézométrique (cote + 110 m). Ce gradient est une anomalie par rapport au gradient piézométrique régional (se reporter à la carte de la planche I). Il est dû probablement à un fort drainage par faille en direction du nord-est, ce qui s'est trouvé confirmé par les mesures de résistivité (voir ci-après) ; ce phénomène semble encore s'accentuer quand on remonte vers la ferme du Colombier où le niveau piézométrique est à + 128,5 m au forage PZ2. L'anomalie constatée affecte donc directement l'ensemble du périmètre de stockage.
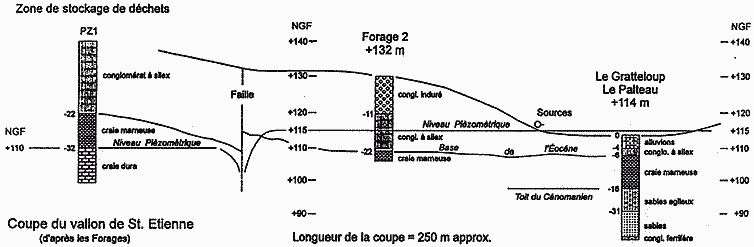
Figure n° 3
2. Étude géophysique: mesures des résistivités.
Six profils électriques ont été réalisés sur la rive droite du Gratte Loup (est de la rivière), afin de préciser la nature du sous-sol, de mettre en évidence des accidents et de déterminer, dans la mesure du possible, le niveau piézométrique de la nappe de la craie.
L'acquisition des données a été réalisée le jeudi 20 novembre 1997, à la suite de plusieurs visites de terrain.
Leur interprétation numérique a été effectuée avec le logiciel ELEC PISE4 du Centre de Recherche Géophysique (CRG) du CNRS de Garchy (Nièvre), après avoir été calés sur les deux forages existants, situés à proximité, le forage du Palteau et le "forage 2".
La succession des terrains rencontrés est la suivante, de haut en bas : conglomérat induré (jusqu'à la cote 121), conglomérat (jusqu'à la cote 110-108, environ), craie (jusqu'à la cote 98), sable argileux et sable (jusqu'à la cote 83).
Ces six profils ont permis de reconstituer cinq coupes géologiques dont deux sont orientées N-S et trois sont de direction
E-W.
Les sondages électriques mettent parfaitement en évidence, sous une fine couche de limon des plateaux, les 2 types de conglomérats.
Le conglomérat induré apparaît comme étant électriquement plus résistant que celui situé au-dessous, qui doit être moins induré et donc susceptible de contenir de petits niveaux aquifères.
Certaines hétérogénéités sont visibles dans cet ensemble conglomératique :
- le conglomérat sous-jacent est absent dans la zone du profil B3-1 (localisation, coupes est et sud) ;
- un conglomérat peu induré est mis en évidence au-dessus du conglomérat induré dans la zone du profil B3-1 (localisation, coupes ouest, centre et nord).
Ces hétérogénéités "électriques" se retrouvent dans la lithologie de cet ensemble qui est beaucoup plus variée que celle décrite dans les deux forages de référence.
Le toit de la craie est parfaitement caractérisé sur chacun des profils que celle-ci soit aquifère ou non (coupes). On distingue, de plus, la craie aquifère de la craie "sèche", ce qui a permis de représenter le niveau piézométrique supposé de la nappe sur les différentes coupes.
Par contre le contraste de résistivité entre la craie et le sable argileux n'est pas suffisamment marqué pour que cette limite ait pu être mise en évidence, c'est pourquoi ces formations ne sont pas individualisées dans les coupes.
La synthèse de ces données permet de supposer l'existence de plusieurs accidents : le premier passe entre les profils Bl-3 et B1-2, le second passe entre les profils B3-2 et B3-1 pour se poursuivre entre les profils B1-2 et B1-1, le troisième passe à proximité du profil B2.
Les tracés supposés des accidents sont dessinés sur la planche 2. Les profils permettent de déterminer des zones de passage ponctuelles d'accidents, ce sont les corrélations entre profils, basés sur la morphostructure régionale qui conduisent à définir des orientations privilégiées.
Les deux premiers (NE-SW et E-W) correspondent à des directions géomorphologiques soulignées par des changements d'orientation du réseau hydrographique ou des perturbations plus aiguës de celui-ci ("ru du Palteau" et Gratte Loup entre les Mussets et la Devaudière, pour le premier; "ru de Nuisance" et incurvation du Gratteloup au nord de la Devaudière).
Le troisième accident a déjà été repéré par l'étude morphostructurale, il s'agit du "ru de Saint-Étienne", de direction
ENE-WSW.
Le fait que certaines parties des coupes soient dénoyées vient confirmer la présence d'accidents qui jouent le rôle de drains naturels.
3. Étude granulométrique.
Elle avait pour but de déterminer la proportion de minéraux argileux (<40 µ.) par rapport à la matrice et aux éléments de silex du conglomérat éocène.
Elle a porté sur un échantillonnage en continu du forage Palteau n° 2 jusqu'au toit de la craie. Elle a porté également sur les échantillons composites de quatre lignes de tarière.
Dans le diagramme de la figure 4 l'évolution verticale de la granulométrie dans le forage montre la présence de "perrons siliceux" vers 4 m, 9 m, 17 m et 20 m ainsi qu'un horizon argileux, d'épaisseur métrique vers 12 m. La moyenne s'établit autour de 40 % de la masse en éléments argileux.
Ces résultats confirment nos propres observations de terrain sur les conglomérats à silex de l'Éocène inférieur. Ils infirment la présence hypothétique d'une formation épaisse d'argile à silex au toit de la craie du Crétacé, telle qu'indiquée sur la carte géologique 1/50.000e (Feuille de
Cloyes).
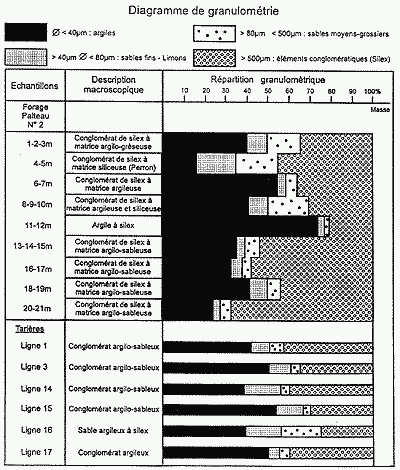
Figure n° 4
4. Observations pédologiques et botaniques.
La présence de parcelles boisées à flanc de coteau entre le périmètre du stockage et la vallée du Gratteloup a permis d'effectuer des observations sur les peuplements forestiers et les sols naturels, considérés comme indicateurs de la nature du sous-sol.
Ces parcelles sont hors de l'emprise des drainages agricoles voisins.
Le peuplement forestier est représenté par un taillis sous futaie de chêne sessile. L'étage arbustif est représenté par le charme, le tremble, le troène, l'acacia
faux robinier, le merisier. L'étage herbacé est représenté principalement par des graminées et de la ronce.
- L'humus est un Mull acide
- L'horizon A est limoneux, brun (horizon organo-minéral)
- L'horizon B est limoneux (horizon d'accumulation type Bt)
- Passage à un horizon argilolimoneux à très forte charge en silex.
Pas de traces d'engorgement permanent ni de concrétions ferrugineuses. Quelques taches rouilles indiquent des engorgements temporaires localisés. Ce sol à filtration rapide est l'indicateur d'un sous-sol perméable.
L'absence de plantes hygrophiles est l'indicateur qu'aucune émergence d'eau souterraine provenant des conglomérats à silex n'apparaît entre le sommet du plateau et le pied du coteau.
On en déduit l'absence d'horizons argileux francs entre le sommet des conglomérats et leur base dans le secteur étudié.
5. Inventaire aux abords du site des sources et lignes d'émergences.
Une ligne continue de sources et d'émergences s'observe en pied de coteau, sur la rive droite du Gratteloup, entre Corbigny et le Moulin des Branloirs. Les plus connues, sur un plan historique et patrimonial, sont celles de Sainte-Radegonde (sanctuaire actuellement restauré) et de Saint-Étienne (ancien lieu de pèlerinage).
Cette zone d'émergence suit la pente de Gratteloup à1 ou 2 m au-dessus du méplat alluvionnaire du ruisseau, entre les côtes altimétriques + 120 et + 110. Outre les sources ponctuelles, elle se manifeste par des peuplements végétaux spécifiques qui ont fait l'objet d'une étude géobotanique, publiée dans la gazette de la Société d'Histoire Naturelle du Loir-et-Cher (n°46, nov. 1997). Selon les données du forage Palteau n°1, elle représente en fait l'affleurement de la nappe phréatique du Cénomanien-Turonien sur cette partie de la vallée du
Gratteloup.
Un tel affleurement sur une longueur de 5 km environ rend évidemment très vulnérable la nappe phréatique aux pollutions potentielles par ruissellement de surface provenant du site de stockage du Colombier, outre les pollutions potentielles par les eaux d'infiltration pénétrant directement dans la couverture des conglomérats éocènes.
6. Évaluation de l'impact du projet sur les eaux souterraines et de surface.
L'ensemble des données recueillies au cours de cette étude détaillée est suffisant pour estimer que le projet de traitement et de stockage de déchets sur le site du Colombier présente un risque important de pollution de la nappe phréatique du Cénomanien-Turonien soit par infiltration soit par ruissellement et écoulement superficiel.
Un tel risque de pollution (organique, biologique, minéral) doit être évalué dans le long terme (à l'échelle séculaire) même après fermeture du site.
I1 est identifié à partir des observations suivantes.
La nappe phréatique du Cénomanien Turonien, situé entre 15 et 20 m sous le périmètre de stockage est en situation de nappe libre, sous une couverture perméable de conglomérats à silex où n'apparaît aucun écran argileux suffisamment épais et étendu pour former une barrière passive naturelle (les observations pédologiques et géobotaniques le confirment).
Les terrains qui forment le soubassement du périmètre de stockage, aquifères et couverture compris, se situent dans une zone de dislocation intense engendrée par un faisceau de failles distensives. Cette dislocation engendre un fort drainage de la nappe phréatique vers le nord-est, révélé par une dépression anormale du niveau piézométrique. Détectée au cours d'un travail de cartographie structurale sur le terrain et par photos aériennes, elle a été prouvée par une campagne de géophysique qui confirme les données de l'analyse morphostructurale ; la présence d'une épaisse formation d'argile à silex recouvrant les aquifères du Turonien et du Cénomanien signalée sur la carte géologique au 1/50 000e est démentie par nos travaux de terrains (tarières et forages) et de laboratoire (analyses granulométriques).
Seule repose sur le Turonien et le Cénomanien une formation résiduelle à silex qui se définit pétrographiquement comme un conglomérat de silex à matrice argilo-sableuse ou siliceuse.
La perméabilité de cette formation d'origine détritique, continentale, comparable à des alluvions anciennes, est telle de par sa texture qu'on ne peut la considérer comme une barrière passive.
A cette perméabilité originale de texture se rajoute une perméabilité en grand, due aux déformations distensives du réseau des failles détectées à l'aplomb du site. En plus du risque de pollution de la nappe phréatique par l'infiltration dans la masse disloquée des conglomérats éocènes de couverture, il faut tenir compte du risque de pollution de la nappe par les eaux de surface, du fait de son affleurement dans la vallée du Gratteloup, à l'aval même du site projeté, comme le signale une ligne de sources et d'émergences de 5 km de long.
En définitive, en tenant compte des conditions hydrogéologiques régionales et locales, particulièrement défavorables ici, il semble étonnant que l'on ait pu choisir ce site pour une activité potentiellement génératrice de fortes pollutions du sous-sol et de la nappe phréatique.
|
Documents consultés
|