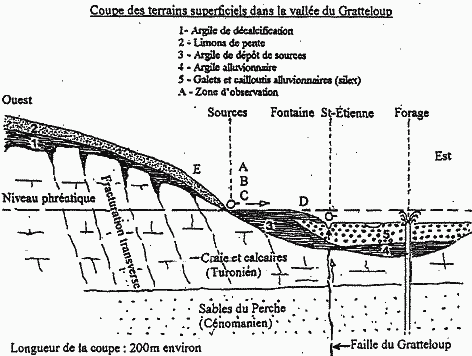![]()
N° 4 - 1997
GÉOBOTANIQUE DE LA FONTAINE SAINT-ÉTIENNE (PERCHE VENDÔMOIS)
E. Cantone, J. Di Rosa, P. de Bretizel
Cet article a été publié en premier dans la "Gazette de la société d'Histoire Naturelle de Loir et Cher' de novembre 1997.
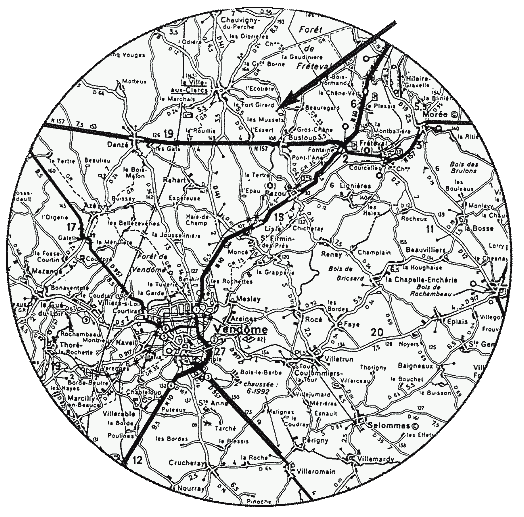 |
Un inventaire botanique sur une zone d'émergence d'une nappe souterraine dans le Turonien calcaire du Vendômois montre une corrélation étroite entre les peuplements végétaux et la nature des sols, eux-mêmes dépendant de la nature du soubassement géologique. In the Vendomois Région a botanical inventory over a groundwater emergence zone throughout turonian limestones has proven an accurate connexion with soils composition these consequently with the bedrock constitution. |
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
La fontaine Saint-Étienne est située dans la vallée du Gratteloup, affluent de rive droite du Loir 15 km environ au nord de Vendôme. Elle est répertoriée et décrite dans l'inventaire des sources de la Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher sous le numéro SHN 41-028-2.
Cette fontaine est l'un des points d'émergence de la nappe du Turonien calcaire et crayeux dans le réseau hydrographique de surface du bassin du Loir. La stratigraphie et la tectonique de cet aquifère ont fait l'objet d'une étude détaillée publiée dans la Chronique des Sources et Fontaines (n°2 et 3).
Le point d'émergence proprement dit se situe en pied de colline, en bordure de la rivière. Il est marqué par un captage très ancien alimentant un petit bassin.
Une ligne de petites sources sauvages jalonne la ligne de pied de colline de part et d'autre de la fontaine proprement dite et leurs eaux sont récupérées par des fossés de drainage. Cette ligne est révélatrice d'un déversement de la nappe phréatique du Turonien calcaire dans la vallée du Gratteloup. Elle est indicatrice de la surface piézométrique de cette nappe, laquelle oscille ici autour de la cote NGF +115 m.
Un forage pour irrigation a été exécuté en avril 1997. Il est situé à 100 m environ au nord de la Fontaine (lieu-dit Le Palteau). Il a traversé successivement :
- 6 m de dépôts alluvionnaires: galets et graviers de silex et argile.
- 10 m de calcaire crayeux et craie pulvérulente.
- 7 m de sables argileux jaunâtres à verdâtres.
- 7 m de sables francs, quartzeux de couleur orangée.
Il s'est arrêté sur un niveau dur de conglomérat siliceux à éléments rougeâtres à 3 m de profondeur.
Les faciès sableux, ferrugineux, rencontrés à partir de 16 m de profondeur appartiennent à la formation aquifère connue sous le nom de "Sables du Perche" d'âge cénomanien.
On observe que la partie supérieure de ces sables est argileuse mais sans constituer un véritable écran imperméable entre la craie turonienne et les sables cénomaniens, contrairement à ce qui se passe plus à l'ouest où un niveau de marnes s'intercale entre les deux. Au vu des échantillons extraits du forage, on peut donc admettre qu'il y a ici collusion entre la nappe turonienne et la nappe cénomanienne sous-jacente.
Les eaux souterraines qui émergent à la fontaine Saint-Étienne et aux sources avoisinantes correspondraient donc ici à la surface piézométrique des deux nappes confondues.
II - OBSERVATIONS PEDOLOGIQUES
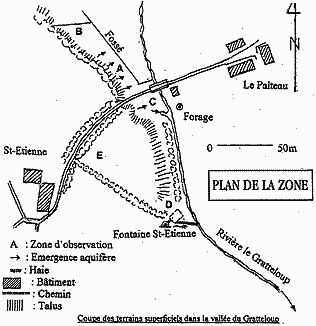 |
Elles ont été effectuées avec une tarière manuelle, sur la rive droite du Gratteloup entre la fontaine Saint-Étienne et la ferme du même nom vers le haut du coteau. Le plan de situation de la figure 1 et la coupe de la figure 2 montrent que cinq types de sol se distinguent dans le secteur étudié. Chacun de ces types de sols se subdivise de haut en bas en : - un horizon organique : humus de prairie (épaisseur centimétrique) - un horizon organo-minéral brun (épaisseur: 20-30 cm). - un horizon de roche altérée et transportée, comprenant des colluvions de pente à la partie supérieure et des alluvions à la partie inférieure (épaisseur: 2 à 6 m). La composition de l'horizon organo-minéral varie avec la nature des roches altérées sur lesquelles il repose. En revanche, on note une dichotomie totale entre l'horizon des roches altérées et le substratum rocheux calcaire traversé par le forage : |
|
b) les sols limoneux de flanc de coteau (zone 2) proviennent du lessivage par les eaux de pluie des limons d'origine éolienne qui recouvrent la surface des plateaux environnants Lorsqu'elles sont en contact avec les argiles alluvionnaires de la zone 4 il n'est pratiquement pas possible de les en distinguer, sauf par le fait qu'elles ne comportent pas de silex. D'autre part elles présentent des traces d'hydromorphie temporaire qui reflètent probablement des variations notables du débit des sources suivant les périodes. |
|
Elles ont été effectuées au cours de la sortie du 15 juin 1997.
Ont été répertoriées et identifiées :
- 17 espèces arbustives et ligneuses
- 14 espèces de graminées
- 70 espèces herbacées diverses
soit au total 101 espèces réparties dans trois types d'environnement :
- haies
- prairies humides
- prairies sèches
L'inventaire est donné dans le tableau ci-joint.
L'évolution des groupes végétaux suit généralement les variations dans la nature des sols :
a) Sur les dépôts argileux de source provenant de l'accumulation de particules argileuses en suspension dans les eaux souterraines à circulation karstique, on observe le développement d'espèces acidoclines telles que l'angélique sauvage, la fougère aigle, la renoncule rampante, la stellaire, la digitale pourpre, la
lampsane.
b) Sur les limons de pente, les groupes végétaux des haies comprennent des espèces ligneuses calcoclines telles que l'érable champêtre, le fusain, le cornouiller sanguin, le troène et l'églantier des chiens. Il est probable que le réseau racinaire de ces espèces atteigne les calcaires sous-jacents.
c) La limite entre les groupes végétaux de milieu humide (zones A B C D) et ceux de milieu sec (zone E) est extrêmement nette. Elle correspond à la courbe de niveau + 116 m qui peut être considérée ici comme représentative du niveau phréatique. Ceci est confirmé par la piézométrie du nouveau forage (artésien) dont le niveau statique est situé à environ 1 m au dessus du sol (cote + 115 m).
|
Participants à la sortie du 15 juin 1997 Société d'Histoire Naturelle de Loir et Cher Association des Amis des Sources |