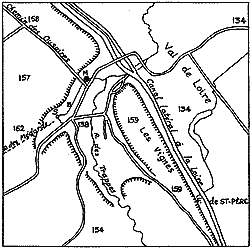![]()
N° 3 - 1996
LE SORDON
UNE SOURCE CHARGEE D'HISTOIRE
Jean CAREL
(Les Amis de BEAULIEU)
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf
Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit.
Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement
UN POLE D'ATTRACTION
Les points d'eau, les sources en particulier, ont attiré les hommes dès les temps les plus
reculés, tout comme les rivières poissonneuses, les forêts riches en cueillette et en gibier ; le premier souci de
l'homme était de survivre.
Le Sordon n'échappe pas à cette règle. Nous ne connaissons pas toute son histoire, mais
le peu que nous savons nous permet de dire qu'il détermine la géographie humaine de ce petit coin de terre.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
|
Le Sordon est une source qui naît à l'Étang, hameau de la commune de Beaulieu, dans le département du Loiret, à 170 km
de Paris, dans le Bassin Parisien à la limite des auréoles tertiaires et secondaires
Notre commune est située au
bord de la Loire, rive gauche. Son nom ne dit rien à personne, d'autant moins qu'il existe vingt quatre Beaulieu en
France. On connaît mieux la commune voisine, Belleville-surLoire, du fait qu'elle possède une centrale nucléaire.
|
Le site du hameau de l'Étang On remarquera la rupture de la ligne du coteau qui
domine le Val de Loire. Ainsi le
val, zone de basses terres (134 m), pénètre dans l'échancrure comme une hernie. |
UN PEU D'ETYMOLOGIE
Le mot Sordon, ici nom propre, fut, au Moyen-Âge, un nom commun désignant une source. Il
apparaît en 1285 dans le dictionnaire de Godefroy, qui se réfère à divers cartulaires (recueil énumérant les droits
temporels d'une communaue-ecdésiastique ; monastère, couvent, chapitre... Les plus anciens cartulaires connus
remontent au Vlle-siècle).
Son radical est très proche de notre verbe sourdre, existant déjà au XIème siècle
avec l'orthographe sordre, dans la chanson de Roland, et, un peu plus tard, sous la forme surdre (Psautier de
Cambridge).
Parler de la source du Sordon serait donc un évident pléonasme.
Le Sordon est vraisemblablement
une résurgence de "la Rivière des Médards". Ce ruisseau, tracé sur toutes les cartes (carte topographique IGN 2421
Gien-Est) est beaucoup plus difficile à découvrir sur le terrain.
Certes, il alimente une mare, jamais tarie. En
amont comme en aval, on ne voit rien, qu'un lit à sec, encombré de végétation, ce qui laisse supposer un sol humide.
L'eau ne coule qu'en de rares périodes, par les hivers pluvieux, ou ,après de grosses pluies d'orage. Et pourtant le
lit de la rivière existe, nettement tracé, imposant souvent, large et profond, avec pont de pierre pour la route
départementale.
Ainsi, presque en ligne droite, on peut suivre ce thalweg des Médards à l'Étang. Et le miracle est
là ; au bout de cette vallée sèche, au pied d'une petite falaise rocheuse, une source jaillit, soulevant le sable,
et s'étalant dans une cuvette ovale, de moins de 6 mètres de long.
QUAND L'IMAGINATION TRAVAILLE...
Pour les
gens simples, une source est un phénomène surnaturel, un don du ciel, ou des enfers, comme un volcan.
Très vite,
les gens de l'Étang ont fait le rapprochement entre la rivière déficiente et la source abondante, mêlant le réel et
l'imaginaire. Ils affirment que le Sordon est insondable, que la perche la plus longue ne touche aucun fond, que tout
objet jeté dans le tourbillon disparaît à jamais. Personne, bien sûr, n'ose y mettre le pied.
On raconte aussi
qu'un canard, tombé par accident dans le puits des Médards, avait reparu, sain et sauf, dans les eaux de la source.
Un autre mystère était l'effondrement du sol le long de cet axe Les Médards-L'Étang. Les plus sceptiques
ricanaient. Les imaginatifs parlaient de souterrains qui avaient cédé ; on n'est pas loin de la forteresse médiévale
d'Assay.
On dut se rendre à l'évidence quand la route goudronnée, bien empierré, cylindrée, solide, s'affaissa à
son tour, puis récidiva plusieurs fois, en dépit des camions de pierres déversées à chaque fois pour combler le
gouffre.
L'ÉROSION DES CALCAIRES
Sans parler de phénomènes karstiques, car l'altitude est ici
insignifiante, on peut imaginer les résultats de l'action des eaux : infiltration par les fissures du calcaire,
circulation d'eau souterraine, érosion permanente, et, finalement, résurgence.
Non loin d'ici, la Loire elle-même,
disparaît en partie, vers Tigy ; les pertes de Bouteille sont célèbres. Après une circulation souterraine, les eaux
réapparaissent en sources bouillonnantes, donnant naissance à deux petites rivières : le Loiret et le Dhuy. Dans
cette région, le sol est formé du calcaire de Beauce. A Beaulieu, il s'agit d'un autre calcaire, un peu plus ancien
(paléocène), d'origine lacustre, et dénommé "calcaire de Briare et de Chateau-Landon". I1 constitue l'ossature même
du coteau qui borde le val et se prolonge sous les alluvions argilo-siliceux quaternaires des terrasses du lit majeur
de la Loire. La carte géologique nous le montre présent, en surface, des Médards à l'Étang, et surtout sur la rive
droite de la Loire, occupant une bonne partie du Gâtinais. Ce calcaire est une excellente pierre à bâtir; exploitée
dès le Moyen-Âge, utilisée pour la construction de l'église de Beaulieu, des maisons bourgeoises. De nouvelles
carrières ont été ouvertes au siècle dernier. Elles ont fourni les matériaux nécessaires aux ouvrages des deux
canaux : berges maçonnées, ponts, écluses, aqueducs ...
C'est donc dans ces calcaires que chemine une rivière souterraine qui donne naissance au Sordon, mais son origine
est sans aucun doute bien plus lointaine que les Médards, si l'on considère le débit abondant et constant de cette
source
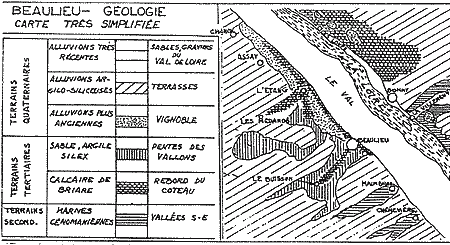
Remarquons qu'il existe deux autres sources, à quelques dizaines de mètres du Sordon ; elles se trouvent dans des propriétés privées, entourées de murs, et non visibles de la route. Le Sordon, propriété privée également, est visible du chemin, il est bien plus abondant aussi.
LE SORDON À L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
Beaulieu fut occupé à l'époque gallo-romaine et l'on verrait très bien
une villa à proximité du Sordon. II n'en fut rien. Le site choisi fut Gannes, à presque 2 km en aval. Pourquoi cette
préférence ?
A Gannes, tout comme à l'Étang on est à proximité de la Loire, et l'on sait l'importance des voies
fluviales autrefois, axes de communication du plus grand intérêt. Gannes, à 141 m, tout comme l'Étang (138 m) est à
l'abri des inondations ; le val est à 134 m.
Gannes présente une vue bien dégagée, mieux que l'Étang, et permet la
surveillance des environs, encore que la " pax Romana " ait apporté une sécurité de plusieurs siècles. D'autres
arguments furent décisifs pour le choix de Gannes. Il existe, à cet endroit, un gué sur la Loire, et ils sont rares !
Là aussi aboutit, sur la rive droite, la grande voie romaine qui vient d'Autun, et qui gagne Orléans en longeant le
fleuve.
Gannes n'a pas de source ; les eaux de ruissellement "du Bois de rivière" sont intermittentes, et non
potables. Aussi fallait-il capter le Sordon, assez fourni pour alimenter toute la villa (*), les humains, le bétail,
les bains des maisons, la piscine chauffée utilisée en toute saison.
On construisit donc un aqueduc.
Les
Gallo-romains connurent la prospérité, et le confort, jusqu'aux grandes invasions et à la chute de l'empire romain
(Ve siècle).
(*) la villa romaine est une grande exploitation agricole (villa = ferme). Elle peut couvrir une
centaine d'hectares. Elle comporte de nombreux bâtiments, non point groupés, mais en construction lâche ; habitation
des maîtres, en pierre, habitations des serviteurs, en bois et torchis, écurie, étable, bergerie, grange, cellier,
ateliers divers; forge, menuiserie, tissage, scierie, poterie, tuilerie... pour permettre une vie en autarcie
LES DÉCOUVERTES
La découverte de Gannes est relativement récente puisqu'elle ne date que du XIXe siècle. Sans
entrer dans le détail des étapes, disons seulement que la mise à jour des vestiges se fit par le creusement du canal
latéral à la Loire.
Les travaux durent de 1835 à 1838, et sont entrepris simultanément sur toute la longueur, de
Roanne à Briare. En 1836, on découvre la maison principale.
En 1892, on construit un autre canal parallèle au
premier, mais seulement de l'Étang à Briare. I1 s'agit d'éviter aux péniches de traverser la Loire, opération longue
et périlleuse.
Le passage du fleuve se fera par un pont-canal. En creusant ce "nouveau" canal, on découvre surtout
l'aqueduc et la piscine (1892).
L'AQUEDUC DU SORDON
|
Il part de la source et longe le coteau sur 1450 m. A vrai dire, il n'était pas visible, complètement enterré, bien
isolé thermiquement, évitant à l'eau fraîche de la source de geler, ou de s'échauffer. La canalisation tout à fait
fermée et étanche, est à l'abri des souillures. L'intérieur où passe l'eau, est enduit de ciment rose, on l'a retrouvé
intact après 16 siècles ! On a longtemps cru que les romains détenaient des secrets de fabrication. La découverte de
"traités" de maçonnerie n'a rien révélé, préconisant simplement un mélange de sable et ciment parfaitement homogène
obtenu par un long et minutieux pelletage. La teinte rosée était due à une adjonction de brique pilée, non point dans
un but esthétique, mais parce que l'expérience enseignait que ce mélange résiste bien à l'humidité. La canalisation était couverte de tuiles rondes. Le tout était noyé dans le béton. Le "coffrage" extérieur est constitué de grosses pierres entassées.
Il ne reste plus qu'à le recouvrir de terre et l'aqueduc disparaît sous la pente du coteau. La disposition des lieux ne permettait pas une forte pente. Elle est, en moyenne de 1%, puisque de la source, à 138,5 m, on arrive à Gannes à 137 m, pour une distance de 1450 m. L'EAU DU SORDON À GANNES : LA PISCINE |
 |
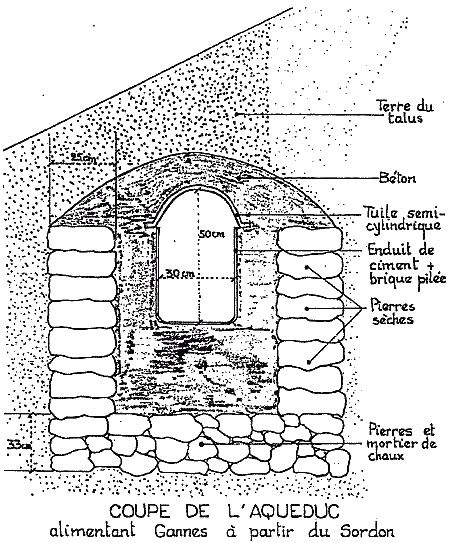 |
Les historiens témoins de cette découverte nous
l'ont décrite (la description de Boisvillette est la plus complète et la plus précise). Elle est circulaire, avec
trois mètres de diamètre intérieur, quatre mètres soixante quinze de diamètre extérieur. On y descend par deux
escaliers plutôt raides. Les murs et le sol sont recouverts de plaques de marbre blanc, veiné de rose. On a retrouvé
des morceaux de plafond ; ils sont peints de vert et de rouge. A l'intérieur du mur derrière le marbre montaient des
conduits d'air chaud, en briques creuses assemblées par des pitons de fer en T. L'eau était amenée et évacuée dans
des conduites en plomb. Le chauffage s'effectuait en sous-sol. Cette salle voûtée était soutenue par des pilettes (piliers de briques superposées) qui devaient supporter un poids énorme, le sol étant un béton de 25 cm d'épaisseur. De telles salles, dites hypocaustes, servaient à chauffer aussi bien les habitations que les thermes. On y brûlait du bois très sec, ou mieux encore, du charbon de bois. On évitait ainsi l'encrassement des conduits de fumée par la suie et les goudrons, inévitables avec du bois vert. Ces conduits était autant de cheminées qui débouchaient tout autour du toit. Les cendres étaient souvent évacuées mécaniquement, par un courant d'eau. Cette piscine se trouvait à l'emplacement du nouveau canal, recouverte de beaucoup de terre apportée par le ruissellement venu du coteau. Elle n'a pas été détruite, se trouvant en dessous du niveau inférieur du canal. |
On a coulé dessus une chape de béton pour la protéger des infiltrations. Elle n'est donc plus visible, et, pour longtemps, inaccessible. Par contre, ce qu'on peut voir quand le canal est vide, ce sont les fondations de la "villa", conservées en limite des berges.
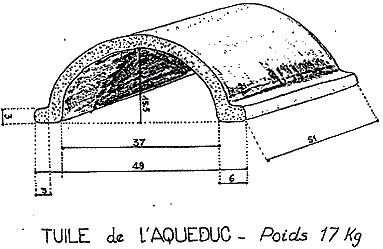
LA ROUE HYDRAULIQUE
L'eau du Sordon était aussi utilisée, à Gannes, pour actionner une roue. On ignore tout de
son usage précis : pompe, moulin, soufflet de forge ? Cette roue fut exhumée en 1836 (creusement du ler canal). Son
diamètre était de 2,34 m. Elle possédait 24 rayons. Le bois était entièrement pétrifié, ayant séjourné dans l'eau,
riche en calcaire à Beaulieu. Cette roue très fragile, a dû se briser lors de son transport ; il n'en reste rien
aujourd'hui.
LA FIN DE GANNES
Ainsi, le Sordon alimenta Gannes pendant plusieurs siècles, sans que les
dates soient faciles à établir. Il n'y a que les pièces de monnaie, découvertes lors des fouilles, qui nous
renseignent sur l'occupation gallo-romaine à Gannes. Elle semble durer du Ier au Ve siècle. La plus ancienne monnaie
est à l'effigie de Néron (54-68) ; la plus tardive représente Magnence (350-353). Ce Magnence était d'origine
franque, et non romain de race. Il fut proclamé empereur à Autun. C'est dire que les Germains avaient déjà pénétré
dans l'empire, invasion lente, pacifique, presque clandestine.
Mais au Ve siècle, ce sera un déferlement brutal
d'armées pillardes, et Gannes disparaîtra dans les flammes, en même temps que lEmpire romain.
LE SORDON
AU MOYEN-ÂGE À L'ÉTANG
C'est au milieu du XIIe siècle qu'on parle pour la première fois d'un hameau près du
Sordon : l'Étang. Il s'agit sans doute d'une dizaine de maisons édifiées au bord d'un étang. C'était chose facile
que d'établir un étang dans cette cuvette basse cernée de buttes, avec un bel exutoire vers le val. Il suffisait
d'une digue de terre pour fermer ce goulet et retenir les eaux des deux rivières : le Roussin (la rivière des
Trappes) et le Sordon. Ce fut l'œuvre du comte de Sancerre, seigneur du lieu. Le hameau s'appela dès lors
l'Étang-le-Comte.
Mais il est certain que la présence du Sordon, source pure et fraîche, intarissable, fut un
atout déterminant pour l'établissement des hommes.
UNE COMMUNE ÉMANCIPÉE
En ce XIIe siècle, l'Étang
devint une "Commune" et bénéficia de privilèges, peut-être par une surenchère des seigneurs en rivalité dans ce
hameau : le comte de Sancerre et les chanoines de Bourges. Elle profita de leur querelle pour obtenir une Charte
libérale, copiée sur celle de Lorris (accordée par le roi de France Louis VI le Gros (1081-1737) à cette ville du
Loiret; il pensait ainsi affaiblir le pouvoir des seigneurs locaux, qu'il jugeait trop puissants et ambitieux. Cette
charte servit de modèle dans tout le centre de la France, et, en particulier, dans le Gâtinais); les avantages sont
surtout personnels, avec la suppression totale du servage, et fiscaux : suppression de certains impôts et péages,
allégement des taxes.
UN MOULIN
Pourquoi ne pas utiliser la force motrice du Sordon ? On construisit un
moulin. Il existe encore aujourd'hui, entretenu et restauré au cours des siècles. Le bief, de près de 200m est
toujours visible ; il provoque une chute d'eau de près de 2 mètres.
Les actes officiels évoquent ce moulin à
nouveau au XVIIe siècle. II est alors propriété du seigneur d'Assay (le château féodal d'Assay se trouve à environ
un kilomètre de l'Etang. II était, et il est toujours, la propriété de la famille de Stutt, ou d'Estud, d'origine
écossaise qui le reçut du roi Charles VII, en récompense de leur aide militaire pendant la guerre de Cent Ans). En
1616, ce seigneur demande aux chanoines de Bourges, seigneurs de Beaulieu, le privilège d'inhumation et de litre,
pour lui et les siens, dans la chapelle Notre-Dame de l'église de Beaulieu. En échange, il proposa le versement d'une
rente annuelle de trois livres tournois. Cette rente est "assise et assignée" sur leurs biens et spécialement sur le
moulin de l'Étang (consistant en un bâtiment, meule, roue, rouet, cours, jardin, aisances et appartenances).
DYNASTIE DE MEUNIERS
Au XVIIIe siècle, le moulin a changé de propriétaire. On le retrouve aux mains de la
famille Botteloup, véritable dynastie de meuniers implantés à Beaulieu depuis Louis XIV, et exerçant leur métier à
l'Étang comme à Mainbray (moulin sur l'Avenelle). En ce siècle, de père en fils, on trouve Jean Botteloup, puis
Louis, puis Jean... Une fille Botteloup, Jeanne épouse François Buisson, autre meunier, le 2 ventôse an II. Les
Buisson succèdent aux Botteloup à l'Etang. Un siècle plus tard, le moulin passe aux mains des
Mollot. avec trois générations, tous prénommées Étienne. Le dernier meunier fut Étienne Albert Mollot (1897-1945),
car le moulin cessa son activité avec la guerre de 1914.
Aujourd'hui, cette famille est toujours propriétaire,
avec le bief, et la source même, car on ne dissocie jamais ces éléments.
AVANTAGES ET CONTRAINTES
On a
oublié, en cette fin de siècle, les avantages considérables d'un point d'eau permanent, puisque, depuis une trentaine
d'année, le réseau d'eau courante couvre toute la commune.
Mais, auparavant, aucune installation humaine ne pouvait
se faire sans eau. Les habitants du hameau allaient puiser, dans le Sordon, leur eau potable, deux ou trois fois par
jour ; le bétail se désaltérait dans la rivière, des lavoirs étaient installés sur les berges. De multiples rigoles
amenaient l'eau, en contrebas, pour irriguer les jardins. On immergeait, dans cette eau glacée, les bidons de lait,
jusqu'au ramassage de la coopérative laitière.
La présence d'un bief, plein à ras bords, présentait aussi quelques
inconvénients, pour les maisons construites tout à côté. Quelques fissures dans les berges, et les murs s'imprégnaient
d'humidité. Qu'une brèche s'ouvre, et les cours étaient inondées. Les querelles et les procès ne sont pas rares dans
ce voisinage. Le propriétaire se voit dans l'obligation de curer régulièrement le bief et de maçonner sa rive, énormes
dépenses, vite amorties quand le moulin fonctionnait, mais difficile à supporter aujourd'hui.
LE SORDON
EST-IL INUTILE AUJOURD'HUI ?
Le Sordon semble n'être qu'une curiosité touristique, réplique, en miniature, des
sources du Loiret, à Olivet. On n'a pas souvent l'occasion dans notre région, de voir de tels bouillonnements de
sable.
Si Gannes à disparu, et ses hommes, et l'aqueduc, leur évocation ne manque pas d'intérêt, auréolée du
mystère des civilisations révolues. Le bief est toujours là, lui, et le moulin, en bon état de marche, prêt à
fonctionner pour des visiteurs curieux.
Les canaux ont leur attrait, et leurs histoires aussi...
Ainsi, l'Étang
a de quoi satisfaire les nostalgiques du passé, qui reprennant pied dans le présent, pourront se consoler avec les
vins stimulants des coteaux du Giennois, dégustés dans les caves mêmes, et les fameux crottins de chèvre.
Bibliographie
- Archives départementales du Loiret
-
Archives municipales de Beaulieu
- Etude sur les
origines de la seigneurie de Beaulieu-sur-Loire, par Pierre PINSSEAU
- Dictionnaire de l'ancien Français, par A.J.
Greimas