![]()
N° 3 - 1996
LES SOURCES DU PAYS DE BEAULIEU EN HAUT BERRY
Pierre de BRETIZEL
IGAL/ REIG Malitourne 41270 VILLEBOUT
 |
Résumé Sur le territoire de la commune de BEAULIEU (Loiret), on recense actuellement onze sources. Pour huit d'entre elles, les eaux souterraines proviennent d'une formation calcaire très attaquée par l'érosion karstique : les calcaires de BRIARE d'âge Oligocène inférieur. Les trois autres sont les déversoirs de la partie supérieure de la nappe phréatique de la craie cénomanienne. Les points d'émergence sont contrôlés par des failles : la principale est la prolongation vers le nord de la grande faille de SANCERRE qui recoupe la bordure sud-est du BASSIN PARISIEN. |
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
Le pays de BEAULIEU domine la rive gauche de la LOIRE entre le SANCERROIS au sud et le GIENNOIS au nord. Il est situé géologiquement dans le BASSIN PARISIEN à la limite des auréoles des terrains crétacés et cénozoïques (fig.10).
DESCRIPTION GÉOLOGIQUE LOCALE
Stratigraphie - Lithologie
| Sur le territoire de BEAULIEU
affleurent les terrains suivants, dans l'ordre stratigraphique, de bas en haut : - Craie à silex grisâtres d'âge cénomanien moyen-supérieur. Elle affleure dans la vallée de la VENELLE, en amont de MAIMBRAY, ainsi qu'en limite ouest du territoire, au Château de COURCELLES. - Marnes blanchâtres, d'origine lacustre, d'âge Oligocène inférieur. Dans un sondage, situé à 2,5 km à l'ouest de BEAULIEU, leur épaisseur est de 8 m. - Calcaire crayeux blanchâtre, d'origine lacustre, d'âge oligocène inférieur. Cette formation est connue sous le nom de "calcaires de BRIARE". Elle affleure principalement le long de l'escarpement qui domine le VAL de la LOIRE à l'est de BEAULIEU. Elle affleure également dans les vallées des TRAPPES et des MÉDARDS qui rejoignent le VAL selon une direction sud-ouest - nord-est. Son épaisseur est d'une quinzaine de mètres. - Sables argileux (et argiles) d'origine détritique continentale, d'âge miocène. La partie inférieure est localement conglomératique à éléments de silex. Leur épaisseur maximum est de 20 m et diminue progressivement d'ouest en est. Des limons quaternaires recouvrent cette formation à la surface du plateau. - Alluvions de la LOIRE. On observe dans le secteur d'étude 3 périodes successives de dépôts alluvionaires, correspondant à des comblements suivis de surcreusements. |
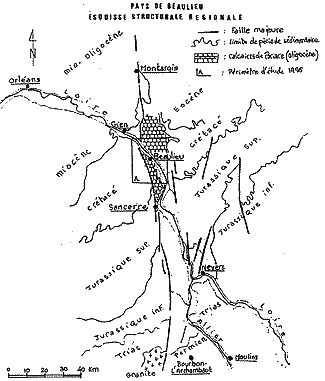 |
Le plus ancien de ces dépôts correspond au niveau de la terrasse supérieure à la cote +160 m. Son âge est celui de la glaciation de MINDEL, soit 500.000 ans avant notre ère. I1 affleure principalement sur l'escarpement de BEAULIEU, sur les sables argileux du Miocène.

Le
dépôt intermédiaire correspond à une ligne de terrasses à la cote +145 m : il est daté par rapport à la glaciation de
Riss, soit 200.000 ans avant notre ère. Il affleure principalement près du village de MAIMBRAY.
Le dépôt inférieur
est à la cote d'altitude de la LOIRE à +135 m. I1 correspond à l'alluvionnement actuel.
Tectonique
La figure 11 montre que BEAULIEU est construit sur le rebord oriental d'un plateau calcaire recouvert de
sables et argiles, incliné légèrement vers le nord-est.
Ce plateau calcaire (calcaires de BRIARE) est interrompu à
l'ouest par une faille importante dont le rejet vers le nord-est peut être estimé à une trentaine de mètres. Cette
faille n'est pas indiquée sur la carte géologique au 1/50.000. Cependant une analyse détaillée des caractères
géomorphologiques du secteur nous a permis d'en suivre le tracé.
En fait, elle apparaît comme la prolongation vers
le nord de la grande faille régionale de SANCERRE qui recoupe tous les terrains de la bordure sud-est du BASSIN
PARISIEN jusqu'à la région de BOURBON-L'ARCHABAULT vers le sud .Un réseau de fractures sécantes, orientées sud-ouest -
nord-est, décroche localement le tracé de cette grande faille et fragmente les calcaires de BRIARE jusqu'à
l'escarpement en bordure du VAL de la LOIRE.
|
|
HYDROGÉOLOGIE
Actuellement, 11 sources en roche sont répertoriées sur le territoire de la
commune de BEAULIEU (fig.12). Les aquifères qui les alimentent sont de 2 sortes :
-
Le calcaire de BRIARE qui forme
l'escarpement du VAL et affleure le long des ruisseaux des MÉDARDS, du GRATTECHIEN et des TRAPPES.
En suivant le
léger pendage de cette formation, les eaux souterraines y circulent librement du sud-ouest vers le nord-est et
émergent au pied de l'escarpement dominant le Canal. Les point d'émergence apparaissent contrôlés par un réseau de
fractures orientées N50 qui se marquent dans la morphologie du plateau sous forme de vallonnements linéaires.
Des
effondrements apparaissent dans l'axe de certains vallons (celui des MÉDARDS notamment) témoignant ainsi d'un régime
de dissolution karstique avancé.
On note également des pertes des eaux de surface des trois ruisseaux mentionnés
ci-dessus, ceux-ci pouvant par ailleurs être complètement secs en période d'étiage, alors que les sources en bordure
du VAL continuent de couler.
La source la plus importante issue des calcaires de BRIARE est la "Fontaine du
SORDON". C'est une émergence unique qui sort d'une vasque à fond de sable calcaire avec un bouillonnement
caractéristique : il s'agit d'une source "vauclusienne", c'est-à-dire où la pression hydrostatique au niveau du
griffon est supérieure à la pression atmosphérique.
Cette source a un grand intérêt archéologique et historique
(voir l'étude de Jean CAREL, de l'Association des Amis de BEAULIEU, publiée dans ce numéro).
Les autres sources
s'alignent en pied d'escarpement le long du Canal entre le hameau de L'ETANG et le sud du bourg de BEAULIEU. Elles
sont captées et canalisées pour passer sous le Canal de la LOIRE, dans le but d'éviter des affaissements ou des
sous-cavages des parois de cet ouvrage. Ce sont des sources "atmosphériques", c'est-à-dire où la pression
hydrostatique au niveau du griffon est égale à la pression atmosphérique.
Signalons enfin que, sur le plan
économique, l'aquifère des calcaires de BRIARE n'a pas beaucoup d'intérêt, du fait de la circulation libre des eaux
souterraines dans un réseau de cavités karstiques, éliminant ainsi des possibilités de pompage à grand débit pour
l'usage agricole ou industriel et qu'il est, de plus, soumis à des risques de pollution importants, par suite de
l'absence de filtration naturelle.
La craie du Cénomanien
Sauf dans les secteurs où il affleure
(Château de COURCELLES) et vallée de la VENELLE), c'est un aquifère captif, sous l'horizon marneux qui le sépare des
calcaires de BRIARE (Marnes de l'Oligocène inférieur).
La faible épaisseur de cet horizon (8 à 10 m) laisse
néanmoins entrevoir la possibilité d'échanges entre l'aquifère de la craie et l'aquifère karstique des calcaires de
BRIARE sus-jacents. Trois sources sont répertoriées, qui représentent des exutoires "atmosphériques" de cet aquifère :
la source de MAIMBRAY, dont le griffon est aménagé en bassin, en bordure du ruisseau des VENELLES; la source des
FORGES dans la partie amont du même ruisseau; la source du MARÉCHAL dont le déversoir est l'étang du Château de
COURCELLES.
L'altitude des points d'émergence de ces sources donne la cote du niveau phréatique de l'aquifère de
la craie, soit
- Source de MAIMBRAY = NGF +145 m
- Source des FORGES = NGF +175 m
- Source du MARÉCHAL =
NGF +175 m
D'un point de vue économique, l'aquifère de la craie apparaît comme une bonne ressource avec des
débits potentiels importants, à condition de placer les forages de production dans ou à proximité des couloirs de
faille où la perméabilité en grand est la meilleure. En effet, la perméabilité propre de la roche compacte, non
fracturée, est médiocre, due à la présence d'une fraction argileuse assez importante.