![]()
N° 3 - 1996
IMPACT D'UNE SOURCE
SUR UN ÉCOSYSTÈME FORESTIER
DANS LE PERCHE VENDÔMOIS
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
Le site étudié ici est situé sur la retombée Nord-Est du dôme de Fréteval sur le flanc sud de la vallée de l'Egvonne.
Il comprend une ligne de petites sources sourdant à mi-pente entre les communes de Villebout et de Fontaine-Raoul,
laquelle fait l'objet d'une description dans "Chronique des Sources et Fontaines" n° 2 - 1995, page 18.
II est
répertorié dans le fichier de la Société d'Histoire Naturelle du Loir-et-Cher : 277 VILLEBOUT - Bois de Malitourne 4.
|
|
OROGRAPHIE, CLIMATOLOGIE
* Versant à pente assez prononcée comportant un méplat à mi-hauteur, orienté
vers le Nord-Est.
* Climat océanique à flux d'air maritime venant de l'ouest.
* Pluviosité maximale en automne :
600 mm par an.
* Températures : + 10 ° en moyenne annuelle.
* Jours de gel : 57/an.
|
|
GÉOLOGIE
* Dans la partie supérieure du versant, le substratum géologique est constitué par des argiles sableuses à
sable de silex et des silexites conglomératiques (perrons), d'âge éocène inférieur.
* Dans la partie inférieure du
versant, ce sont des argiles plastiques à silex, d'âge crétacé.
* Le corps aquifère, qui subaffleure sous forme de
petites sources et suintements le long de la courbe de niveau +200 m NGF est un horizon mince et discontinu de silexite
cassée et fissurée qui repose sur les argiles plastiques imperméables du crétacé. Son "impluvium" (surface collectant
les eaux de pluie et les ruissellements) est extrêmement réduit, ne dépassant pas le sommet de la colline située à une
trentaine de mètres plus haut.
| * Sur le site proprement dit (fig. 9), le contact entre les argiles sableuses éocène
et les argiles plastiques crétacé sous-jacentes correspond au méplat cité plus haut. Il est recouvert par une couche
épaisse de quelques mètres de gros silex cassés et légèrement émoussés qui sont soit une accumulation secondaire en
pied de pente soit les vestiges d'une ancienne terrasse alluviale (cf. "Chronique des Sources et Fontaines" n° 2 -1995,
page 14).
En dehors des suintements diffus, on observe trois points bien définis d'émergence (fig.9) : |
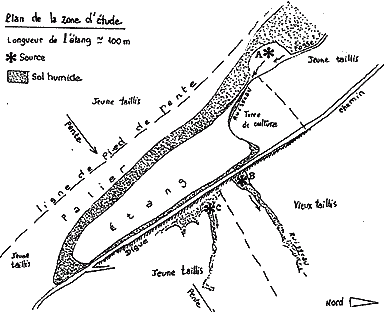 |
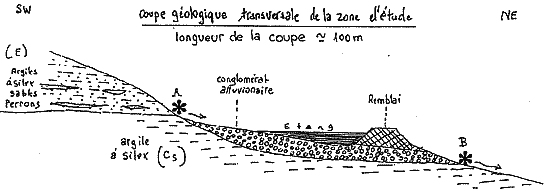 |
La zone
humide déterminée par ces émergences a une surface totale de l'ordre de 3.000 m2. Il est nécessaire de préciser que le mécanisme naturel décrit ci-dessus est perturbé par une levée de terre artificielle qui a pour objet de retenir les eaux issues de l'émergence A, sous forme d'un étang. Cependant son efficacité est faible du fait qu'elle est construite directement sur la couche perméable de galets de silex et ne neutralise donc pas les déversoirs secondaires B et C. |
|
|
PÉDOLOGIE
Environs immédiats du site (hors zone humide)
Les alentours de l'étang et de la source sont des
taillis jeunes (2 ans) à sol en pleine lumière. Au nord de l'étang, on a un taillis ancien (30 ans) à sol entièrement
à l'ombre. Dans le premier cas, on observe un humus du type mull mésotrophe (peu de feuilles sur un sol argilo-sableux
peu altéré). Dans le deuxième cas, on a un humus de type mull acide avec davantage de feuilles sur un sol identique.
Ce sol argilo-sableux a pour origine un matériau éluvionaire issu de l'altération et du transport des éléments
détritiques éocènes dominant le site et s'étendant vers le bas où il recouvre l'argile plastique à silex, non altérée
et en place.
Bien drainé par l'effet de pente, il ne présente pas de traces d'engorgement sauf sur le méplat au
nord-ouest de l'étang.
La zone humide du site
- L'écoulement vers l'étang des eaux de la source A se fait par
une pente très faible : le sol est un gley noir à gris bleuté indiquant un milieu biologiquement presque inerte et
chimiquement très réducteur.
A la source A, son épaisseur est de 20 à 30 cm et il repose directement sur le
substratum de galets de silex. I1 s'amincit et disparaît vers l'étang.
- Sur les berges autour de l'étang,
il n'y a pratiquement pas de couverture pédologique. La couche de galets de silex affleure presque partout : la
végétation s'enracine entre les galets dans les espaces interstitiels où s'infiltre une boue très fine : boue de
décantation du matériau éluvionaire provenant de la partie amont.
- Sous l'étang, autour et en aval des sources
B et C, le sol est argilo-sableux beige clair avec des taches de couleur rouille (Fer oxydé) indiquant des engorgements
modérés, temporaires selon les variations de débit des sources. Ces traces d'hydromorphisme disparaissent au-delà de
quelques mètres du fait du drainage par effet de pente.
L'humus aux points d'émergence est du type mull moder
(présence de matière organique noire) mais revient rapidement au type mull acide dès que l'on s'éloigne des points
d'émergence.
Cette couverture pédologique repose ici directement sur des argiles à silex sous-jacentes peu ou pas
altérées.
Lors de nos observations, début juin, une lame d'eau claire s'écoulait entre le toit des argiles à silex
et la couverture pédologique.
|
|
BOTANIQUE
Milieu environnant
* La forêt dans laquelle est enclavé le
site de la source est un taillis de charmes-châtaigniers sous futaie de chênes sessiles, essence dominante à l'étage
arboré.
* A l'étage arbustif, le houx est pratiquement seul représenté dans les parties de taillis ancien (30 ans).
Dans les parties de taillis récent (23 ans) se développent modérément aubépines, noisetiers. Les ronces ont tendance à
envahir certaines surfaces au détriment des semis naturels de chêne et des repousses de charme et de châtaignier.
*
A l'étage herbacé, le sol est colonisé en priorité dans les taillis jeunes (pleine lumière) par des graminées. La
digitale pourpre est également abondante sur certaines surfaces de taillis jeunes de la partie supérieure, au-dessus
de la source, mais a tendance à disparaître rapidement au fur et à mesure de la repousse des essences de taillis.
Dans les parties de taillis anciens (sol à l'ombre en permanence), seules de larges taches de pervenches se
développent localement. La violette des bois y est également présente ainsi que le lierre grimpant et des mousses de la
famille des hypnes.
Zone humide engendrée par la source
Elle est occupée sur 3.000 m2 environ par une saulaie
entourant un étang retenu par une digue.
* L'étage arboré est absent.
A l'étage arbustif, le saule Marsault est
dominant. Des essences telles que le saule cendré, le cornouiller sanguin et la bourdaine sont également présents mais
peu fréquents.
* L'étage herbacé est riche en espèces diverses : une quinzaine environ ont été observées, les plus
abondantes appartenant aux familles du jonc, du carex et des renoncules d'eau. Le gaillet gratteron est également
abondant.
Le tableau ci-joint donne l'inventaire botanique du secteur. Cet inventaire n'est qu'une simple
reconnaissance et ne saurait prétendre en aucun cas être exhaustif.
Les observations ont été effectuées en juin et
juillet 1996 par temps sec et ensoleillé.
|
RELEVE DES ESPÈCES VÉGÉTALES |
||||
|
ESPÈCES RECONNUES |
FRÉQUENCES OBSERVÉES |
HELIOPHILIE |
||
|
NOM FRANCAIS |
NOM LATIN |
SOL NORMAL |
SOL HUMIDE |
|
|
ÉTAGE ARBORÉ |
||||
|
CHÊNE SESSILE |
Quercus petraea |
++++ |
% |
|
|
CHÊNE PÉDONCULÉ |
Quercus robur |
++ |
+ |
|
|
CHÂTAIGNIER |
Castanea sativa |
+++ |
% |
|
|
CHARME |
Carpinus betulus |
+++ |
% |
|
|
MERISIER |
Prunus avium |
++ |
% |
|
|
FRÊNE COMMUN |
Fraxinus excelsior |
+ |
+++ |
% |
|
TREMBLE |
Populus tremula |
++ |
+++ |
+ |
|
CORMIER |
Sorbus domestica |
+ |
+ |
|
|
BOULEAU VERRUQUEUX |
Betula pendula |
+ |
+ |
+ |
|
POMMIER SAUVAGE |
Malus sylvestris |
+ |
+ |
|
|
ÉTAGE ARBUSTIF |
||||
|
HOUX |
Ilex aquifolium |
++ |
- |
|
|
AUBÉPINE MONOGYNE |
Crataegus monogyna+ |
++ |
+ |
+ |
|
SAULE CENDRÉ |
Salix cinerea |
+ |
+ |
|
|
SAULE MARSAULT |
Salix caprea |
++++ |
+ |
|
|
CORNOUILLER SANGUIN |
Cornus sanguinea |
++ |
+ |
|
|
NOISETIER |
Corylus avellana |
++ |
% |
|
|
RONCE DES BOIS |
Rubus fruticosus |
+++ |
++ |
+ |
|
GENET POILU |
Ginesta pilosa |
++ |
+ |
|
|
BOURDAINE |
Frangula alnus, |
+ |
+ |
|
|
ÉTAGE HERBACÉ |
||||
|
DIGITALE POURPRE |
Digitalis purpurea |
+++ |
+ |
|
|
PRIMEVÈRE ACAULE |
Primula acaulis |
++ |
% |
|
|
PRIMEVÈRE OFFICINALE |
Primula veris |
++ |
% |
|
|
,JONC ÉPARS |
Juncus effusus |
+ |
+++ |
% |
|
EUPHORBE DES BOIS |
Euphorbia amygdaloides |
++ |
% |
|
|
AGROSTIDE VULGAIRE |
Agrostis capillaris |
+++ |
+ |
|
|
CHIENDENT DES CHIENS |
Roegneria canina (Elymus caninus) |
++ |
% |
|
|
VIOLETTE DES BOIS |
Viola reichenbachiana |
++ |
- |
|
|
PERVENCHE |
Vinca minor |
+++ |
- |
|
|
VÉRONIQUE PETIT CHÊNE |
Veronica chamaedrys |
+ |
+ |
|
|
GAILLET GRATTERON |
Galium aparine |
+++ |
% |
|
|
RENONCULE FLAMMETTE |
Ranunculus flammula |
++ |
+ |
|
|
RENONCULE RAMPANTE |
Ranunculus repans |
++ |
% |
|
|
BUGLE RAMPANTE |
Ajuga repans |
++ |
% |
|
|
MYOSOTIS DES MARAIS |
Myosotis scorpioides (ssp. palustris) |
++ |
+ |
|
|
PÂTURIN DES BOIS |
Poa nemoralis |
++ |
++ |
% |
|
PÂTURIN COMMUN |
Poa trivialis |
+++ |
++ |
+ |
|
LAÎCHE PALE |
Carex pallescens |
++ |
+ |
|
|
LAÎCHE PENDANTE |
Carex pendula |
+++ |
% |
|
|
LOTIER DES FANGES |
Lotus pedunculatus |
++ |
+ |
|
|
CHANVRE D'EAU |
Lycopus europaeus |
++ |
+ |
|
|
MÉLAMPYRE DES PRÉS |
Melampyrum pratense |
++ |
++ |
% |
|
ORTIE DIOÏQUE |
Urtica dioica |
+ |
+ |
|
|
LIANES |
||||
|
LIERRE |
Hedera belix |
++ |
- |
|
|
DOUCE AMÈRE |
Solanum dulcainara |
+ |
+ |
|
|
ÉTAGE MUSCINAL |
||||
|
HYDNE SQUARREUX |
Rhytidiadelpbus squarrosus |
|||
FRÉQUENCES : ++++ dominant +++ très fréquent ++ fréquent + rare
HÉLIOPHILIE : + pleine lumière % demi-ombre - ombre
|
|
CONCLUSION
L'impact de la source étudiée ici porte sur un
écosystème forestier typique du Perche implanté sur un substratum d'argiles à silex plus ou moins sableuses.
Cet
impact est double. Il modifie :
- la qualité des sols,
- l'équilibre entre les espèces végétales, par voie de
conséquence.
Qualité des sols
Le changement de qualité des sols s'effectue sur une surface très réduite :
apparition sur quelques dizaines de mètres carrés, à partir du point d'émergence, d'un gley au milieu d'un sol
normalement argilo-sableux assez frais. Le faciès gley disparaît peu à peu vers l'aval, c'est-à-dire vers l'étang.
Il correspond en fait à un écoulement très lent dû au méplat topographique à l'amont duquel se trouve le point
d'émergence (point A). La résurgence de l'eau sous l'étang (points B et C) s'effectue sur une pente assez forte.
Le changement de qualité du sol y est très faible et porte surtout sur l'humus qui présente de faibles traces
d'accumulation de matière organique qui disparaissent rapidement vers l'aval (mull moder passant à un mull mésotrophe).
Modification du milieu végétal
Elle couvre une surface beaucoup plus importante que le changement de sol =
3.000 m2 environ. La limite supérieure de végétation spécifique du milieu humide est extrêmement nette au niveau du
point d'émergence. Elle est beaucoup plus progressive et diffuse vers l'aval. Cela est dû à la morphologie de pente
qui est celle du cas présenté ici.
Elle permettrait éventuellement, en reportant des mesures altimétriques,
d'effectuer une cartographie de l'horizon aquifère aussi précise qu'une prospection géophysique (résistivité),
au-delà du ou des points d'émergence.
Bibliographie
- FLORE FORESTIÈRE FRANÇAISE : Plaines et collines - J.G-Rameau, D. Mansion, G.Dumé – éd. Institut
pour le Développement Forestier (I.D.F.) 1989
- LES STATIONS FORESTIÊRES DU PERCHE. .Version sud – éd. Centre Régional
de la Propriété Forestière d'Ile de France et du Centre. (C.R.P.F)
Remerciements
Nous tenons à remercier M. BOIZET
de l'Association des Naturalistes de Nice et des A.M.
qui a bien voulu nous aider dans
la rédaction de cet article