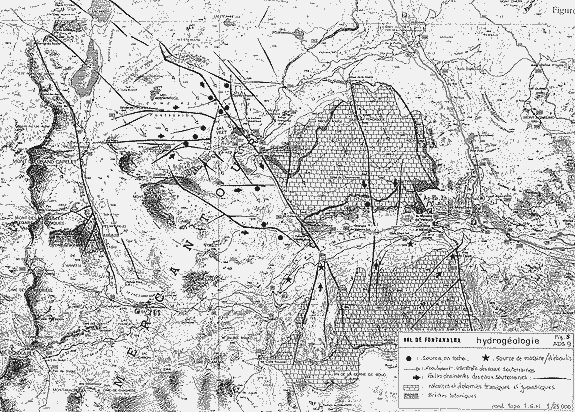![]()
N° 3 - 1996
LES SOURCES DE LA VALLÉE DE LA MINIÈRE DE VALAURIA
Hydrogéologie du massif du Mt. BEGO
(2ème partie)
COLLECTIF ASSOCIATION DES AMIS DES SOURCES
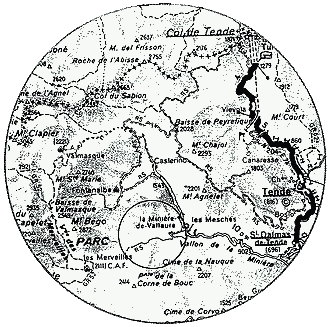 |
Résumé La vallée de la MINIÈRE DE VALAURIA est l'une des trois vallées qui drainent le massif du Mt. BEGO, au centre de la région des MERVEILLES, célèbre pour ses milliers de gravures rupestres datant de l'âge de Bronze. Au cours de l'été 1996, sept groupes de sources y ont été inventoriés sur le terrain - dans la Combe de VALLAURETTE, au pied des falaises orientales du Mt. BEGO, elles émergent des grès et arkoses du Permo-Trias et sont contrôlées par des failles drainantes de direction N90 et NI00, - au pied des falaises dolomitiques d'âge triasique qui forment une gouttière synclinale orientée ouest-est, dans l'axe de la vallée. Elles sont contrôlées par un réseau orienté nord-sud, - à l'aval d'anciennes moraines quaternaires et d'éboulis actuels qui jouent le rôle de réservoirs régulateurs des eaux de fonte des neiges au printemps et des eaux pluviales de l'été. |
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
Cette étude est la continuité de celle présentée dans le numéro 2 de la "Chronique" pp. 26 à 37 : "Les Sources du
Val de FONTANALBA". Le processus en est le même :
- Phase préparatoire : analyse géomorphologique détaillée des
photos aériennes et corrélation avec le fond topographique I.G.N. au 1/25.000.
-
Contrôles sur le terrain effectués
début septembre 1996.
CADRE GÉOGRAPHIQUE
La vallée de la MINIÈRE de VALAURIA est située sur le flanc
oriental du massif du BEGO. Longue de 5 km, elle conflue avec la vallée de CA$TERINO à la hauteur du lac des MESCHES
(alt. 1.390 m). Elle constitue le déversoir des lacs du Cirque des !MERVEILLES étagés entre 2.100 et 2.200 m
d'altitude. C'est une vallée d'origine glaciaire, à la morphologie typique, dont le fond est encore recouvert d'épais
dépôts morainiques. Ces derniers sont fortement érodés par le régime torrentiel actuel et sont localement remplacés
par des éboulis. Le point culminant du bassin versant est le sommet du Mt. BEGO à 2.872 m. Le flanc nord (ubac) est
le domaine des prairies d'alpage jusque vers 2.500 m d'altitude. Le flanc sud (adret) est recouvert par une belle
forêt de mélèzes qui monte jusqu'à 2.100 m d'altitude.
Occupation des sols
a) Cette vallée est
essentiellement le domaine de l'activité pastorale saisonnière (transhumance).
b) La forêt n'est actuellement pas
exploitée.
c) En amont, les lacs des MERVEILLES ainsi que le lac de la MINIÈRE situé plus bas sont d'anciens lacs
glaciaires dont le niveau a été relevé par des digues équipées de vannes : ils ont pour rôle de réguler l'arrivée des
eaux dans le lac de barrage des MESCHES où se trouve une usine hydroélectrique.
d) La MINIÈRE de VALAURIA est une
ancienne exploitation souterraine de plomb, argent et zinc qui s'est arrêtée en 1926. Son histoire remonte à près
d'un millénaire : il en reste des tas de déblais stériles au-dessus du lac des MESCHES et les ruines de l'ancienne
usine de traitement. Le réseau des anciennes galeries (actuellement inaccessible) se développe sur plusieurs
kilomètres sur 4 niveaux.
f) Signalons enfin que la partie amont de la vallée se trouve dans les limites du Parc
National du MERCANTOUR.
|
|
DONNÉES GÉOLOGIQUES
Lithologie - Stratigraphie
La série sédimentaire
présente dans la Vallée de la MINIÈRE est la même que celle que nous avons décrite dans le Val de FONTANALBA
(cf. n° 2 -1995 p. 29 et figure 7 p. 34).
Rappelons-la brièvement ici, de bas en haut :
- grès grossiers
arkosiques, conglomérats et pélites d'âge permien
- grès grossiers d'âge werfénien (Trias inférieur)
-
calcaires et dolomies du Muschelkalk (Trias moyen)
- moraines d'âge quaternaire et éboulis actuels
Cette
séquence repose sur le socle cristallin représenté ici par des gneiss migmatites dont quelques affleurements
pointent au fond de la vallée.
Tectonique
| L'ensemble morphologique en creux que constitue cette ancienne vallée glaciaire correspond à une dépression tectonique dont l'axe s'aligne sur le fond de la vallée : les calcaires et dolomies triasiques du versant nord ont un pendage de 30-35° en moyenne vers le sud tandis que sur le versant sud les pendages sont orientés vers le nord avec des valeurs équivalentes. Étant donné l'épaisseur des moraines et éboulis qui tapissent le fond de la vallée, il est difficile de dire si l'axe de cette dépression tectonique est un système faillé d'effondrement (graben) ou un pli souple (synclinal). | 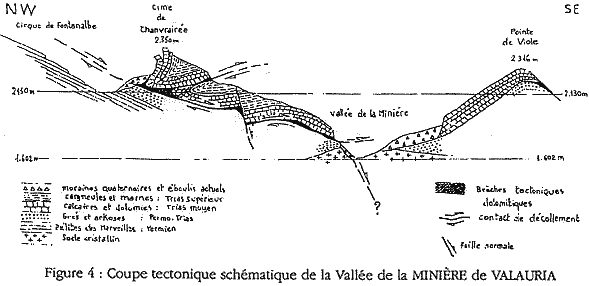 |
Nos observations effectuées sur le terrain, et
plus particulièrement dans la combe de VALLAURETTE, montrent que la masse des calcaires et dolomies du Trias apparaît
décollée et glissée vers le sud par rapport à son substratum de grès permo-triasiques (fig. 4). La cime de
CHANVRAIRÈE qui sépare le val de FON TANALBA de la vallée de la MINIÈRE se présente comme un reste disloqué de pli
couché résultant d'un glissement de l'ensemble triasique vers le sud.
Ce type de structure est à comparer avec celles décrites par P. BORDET sur le flanc sud du dôme de BARROT, au
sud-ouest du massif du MERCANTOUR. Il rappelle les idées de B. GÈZE sur la genèse de l'Arc de NICE, plus au sud, à
propos d'un vaste mouvement de glissement de la couverture sédimentaire post-triasique au sud du dôme du MERCANTOUR.
La carte géologique indique la présence, à la base des calcaires et dolorries du Trias, d'une couche de dolomie caverneuse d'épaisseur variable, baptisée "Cargneules inférieures". Nous avons pu observer sur place qu'il ne s'agit pas d'un terme sédimentaire mais d'une roche dolomitique écrasée et brèchifiée (mylonite). Elle suit étroitement la surface du décollement mentionné ci-dessus : cette mylonite dolomitique résulte très probablement du broyage de la base de la masse calcaire dolomitique triasique lors du mouvement de décollement et de glissement de celle-ci sur son substratum gréseux permo-triasique.
Du point de vue
pétrographique, il s'agit d'une brèche polyphasée composée d'éléments dolomitiques recristallisés dans un ciment
également dolomitique, gypseux et localement ankéritique. La texture est vacuolaire. La couleur est orangée ou
rougeâtre. Localement la limonite vacuolaire abonde, indiquant la présence de zones oxydées provenant de sulfures
primaires (faciès Gossan).
La structure décrite ci-dessus est disloquée par un système de failles normales
récentes, orientées plus ou moins nord-sud. La plus importante correspond à la continuation vers le sud de la ligne
VAL MASQUE - LAC VERT de FONTANALBA - Vallon de VALLAURE'ITE, que nous avons décrite dans le numéro 2 de la
"Chronique" (p. 31). Elle traverse la vallée de la MINIÈRE entre la baisse de VALLAURETTE au nord et la crête de la
CORNE DE BOUC au sud où elle s'atténue et disparaît. Son tracé s'infléchit vers l'est au passage du fond de la
vallée, indiquant ainsi son pendage vers l'est.
Le cirque de VALLAURETTE est parcouru par deux fractures
principales dans les grès du Permien. Orientées N90 et N100, elles recoupent la ligne de failles ci-dessus.
D'autres fractures méridiennes affectent les calcaires et dolomies des versants nord et sud de la vallée (cf. la
carte de la figure 5).
|
|
HYDROGÉOLOGIE
Les formations aquifères de la vallée de la MINIÈRE sont les
mêmes que celles du val de FONTANALBA (cf. Chronique n° 2-1995 p. 32) :
a) Les grès et conglomérats
permo-triasiques ne sont aquifères que dans les couloirs de fractures.
b) Les calcaires et dolomies du Trias
moyen sont soumis à l'érosion karstique qui les rend perméables en grand. Cette karstification est accentuée
par l'intense dislocation qu'ont subi ces formations (surtout sur le versant nord). La disposition générale en
synclinal conduit les eaux souterraines qui circulent librement dans le réseau karstique des deux versants, vers le
fond de la vallée où elles émergent dans les éboulis et les moraines qui recouvrent la base du Trias.
c)
Les moraines glaciaires d'âge quaternaire et les éboulis de pente qui encombrent le fond de la vallée et une partie
de ses flancs retiennent une partie des eaux souterraines et des eaux de surface, jouant ainsi le rôle de réservoirs
régulateurs.
Au printemps, au moment de la fonte des neiges, une partie des eaux s'infiltrent dans ces formation
s et y sont stockées en permanence. Des émergences situées dans les points bas jouent le rôle de déversoirs dont un
certain nombre sont actifs même en période d'étiage, ce qui était le cas lors de notre visite en septembre 1996.
Les émergences et sources répertoriées sur le terrain sont les suivantes :
| * Groupe du haut de la Combe de
VALLAÜRETTE -Altitude : 2.090 m. -Émergences : regroupées dans une zone de tourbières. -Strate aquifère : grès et arkoses fracturés (formation du BEGO). -Contrôle tectonique : faille N90. -Impluvium : versant sud-est de la crête du Mt BEGO * Groupe du bas de la Combe de VALLAURETTE |
* Source du PLAN TENDASQUE
-Altitude : 1.800. -Émergence : une.
-Strate aquifère : base des calcaires
triasiques.
-Contrôle tectonique : faille N 175.
-Impluvium: plateau kartsique du PLAN TENDASQUE
* Sources du Vallon de COLLE ROUSSE
-Altitude : 1.750 m.
-Émergences : diffuses.
-Strate aquifère :
moraine quaternaire.
-Contrôle tectonique
-Impluvium : vallon de COLLE ROUSSE
*
Sources du Vallon de la
CORNE DE BOUC
-Altitude : 1.730 m. -Émergences : diffuses.
-Strate aquifère : moraine quaternaire.
-Contrôle tectonique : double faillé N15 affectant les grès et arkoses permo-nasiques (formation du BEGO) et
les calcaires et dolomies du Trias moyen couronnant la crête ~de la CORNE DE BOUC.
-Impluvium :Vallon de la CORNE
DE BOUC.
* Source du GIAS VIORÉ INFÉRIEUR
-Altitude: 1.600 m.
-Émergences : diffuses.
-Strate aquifère : moraine quaternaire.
-Contrôle tectonique : ?
-Impluvium : plateau karstique du versant
nord de la POINTE DE VIOLE
* Source du TAUPÉ
-Altitude : 1.600 m.
-Émergence : une seule, abondante
(captage rudimentaire).
-Strate aquifère : moraine quaternaire.
-Contrôle tectonique : intersection entre une
grande faille N175 et une faille secondaire N45.
-Impluvium : plateau karstique du Vallon du TAUPÉ.
Bibliographie
- BORDET P. -.1950 : Le dôme permien de BARROT et son auréole de terrains secondaires.
Bull. service Carte Géologique n° 228 T. XLVIII
- GÈZE B. – 1960 : Evaluation du déplacement de la couverture
post-triasique de 1Arc de Nice (AM) - CR Acad. Sciences 7 mars 1960
- LOUGNON J. – 1963 : Étude géologique du
gisement de zinc et plomb de la Minière de Valauria – Bull. B.R.G.M. n° 4
Documents de référence
-
Carte
géologique au 1/50 000 Feuille XXXVII 40-41 - ST MARTIN VÉSUBIE (Levés géologiques effectués par P. FALLOT et A.
FAURE-MURET) 1947-1950
- Carte topographique I.G.N. au 1/25 000, n° 38410 (top 25) Vallée de la ROYA
- Photographies aériennes I.G.N. Vol 3741-3841/300 09-010-011