![]()
N° 3 - 1996
LES FONTAINES MORTES DE ROCASPAVIERA
LES EAUX SOUTERRAINES
DES CALCAIRES JURASSIQUES ET CRÉTACÉS DE L'ARC DE NICE
(3 ème PARTIE)
Pierre de BRETIZEL D. Sc
Institut Géolog que Albert de Lapparent - (IGAL-REIG) Malitourne 41270 VILLEBOUT
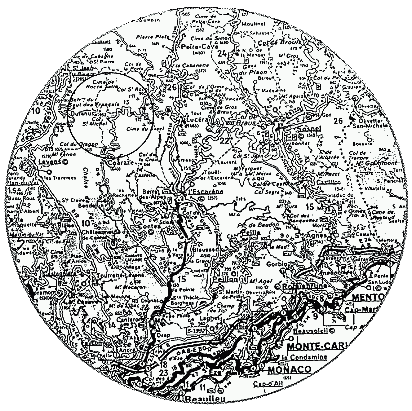 |
Résumé
Dans la partie nord de la chaîne du FÉRION, la crête de ROCASPARVIÉRA sépare les vallées de la VÉSUBIE et du PAILLON.
Son versant oriental est disloqué par une structure d'effondrement en arc de cercle, matérialisée sur le terrain par
de profonds ravins et crevasses.
|
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
Le terrain concerné couvre la partie nord du massif du FÉRION, longue crête orientée nord-sud, dominant la rive gauche du Var et les gorges de la basse VÉSUBIE à l'ouest et la vallée du PAILLON à l'est.
Il est situé sur le territoire de la commune de DURANUS.
ENVIRONNEMENT
Physiographie
La crête principale, qui fait l'objet de cette étude, se développe entre la
baisse de la MINIÈRE (ou bouche de MILON) au sud et le col de l'AUTARET au nord. Elle comprend les sommets suivants,
du sud au nord: la pointe de SERENA (alt. 1191 m), la tête de MIAMANDE (alt. 1.052 m), la cime de ROCASPARVIÉRA
(alt. 1.212 m), la cime de l'AUTARET (alt. 1.308 m). Le col St. MICHEL, situé entre la cime de MIAMANDE et
ROCASPARVIÉRA est le principal passage entre les vallées de la VÉSUBIE et du PAILLON.
Les pentes qui descendent
vers ces deux rivières sont généralement escarpées. La dénivellation entre ROCASPARVIÉRA et la VÉSUBIE est d'environ
1.000 m. Elle est de 700 m vers le Paillon.
Réseau hydrographique de surface
Sur le versant est, tous les
talwegs amont se rejoignent pour former en aval un seul vallon
qui rejoint le PAILLON en dessous du hameau de
l'ENGARVIN. L'ensemble de ce bassin versant ne comprend aucun cours d'eau permanent.
Sur le versant ouest, deux
vallons : le vallon de CAMPON et le vallon de RIMÉOTE écoulent leurs eaux vers les gorges de la VÉSUBIE. Ces cours
d'eau sontpermanents à partir du pied des barres calcaires de la crête principale.
Vegétation
La couverture
végtale est très différente entre les versants ouest et est.
Sur le versant est, l'étage herbacé seul couvre les
2/3 de la surface avec de rares bouquets d'arbres et d'arbustes dans les creux des ravins. Les nombreux éboulis et
affleurements rocheux y sont dépourvus de couverture pédologique. Le reste de la surface est occupé par une forêt
clairsemée de résineux (pins d'Alep).
Sur le versant ouest, au-dessous des barres calcaires et de leurs éboulis,
les flancs des talwegs et des vallons sont recouverts par des bois de feuillus assez denses (charmes, chênes,
érables champêtres, etc.).
Occupation des sols actuelle
Actuellement, le secteur étudié est inhabité.
Sur le versant est, on note une activité pastorale (ovins, caprins) durant la belle saison. Une bergerie est
aménagée sous la crête de ROCASPARVIÉRA sur l'emplacement de ruines. Les bois apparaissent inexploités actuellement.
Les travaux miniers de l'EGUISSE sont abandonnés depuis 1931. Les accès au secteur sont
- un sentier balisé de
l'ENGARVIN au col St. MICHEL,
- une route forestière reliant DURANUS au sommet du Mt. FÉRION,
- un sentier
balisé partant du col St. MICHEL et qui suit la crête vers le nord jusqu'au col de l'AUTARET
|
|
CONTEXTE GÉOLOGIQUE
Les données géologiques exposées ici proviennent d'une cartographie systématique du terrain effectuée
en 1995 par David AUDAIRE (I.G.A.L.) à l'échelle du 1/12.500, précisée et contrôlée par une analyse géomorphologique
à partir des photos aériennes IGN et d'un traitement de l'image satellite SPOT par logiciel OCAPI .
Stratigraphie des formations en affleurement
| De bas en haut, dans l'ordre stratigraphique, on observe :
a)
dolomies brunes, massives : Jurassique moyen probable. Epaisseur = 100 m |
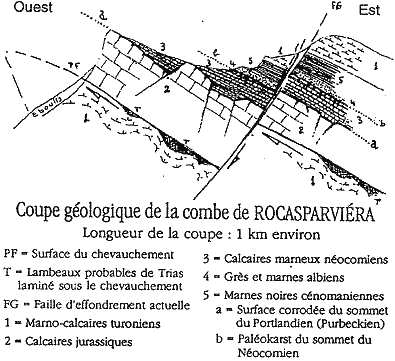 |
f) calcaires
marneux à interlits marneux, glauconieux à la partie supérieure : Néocomien-Barrémien. Epaisseur = 15 m
g) grès
glauconieux, calcaires et marnes gréseuses glauconieuses en alternance irrégulière. Abondance de bélemnites :
Albien. Epaisseur = jusqu'à 20 m (très variable).
Le contact de cette formation avec les calcaires marneux
sous-jacents (f) présente des figures de sédimentation remarquables : galets remaniés, galets de phosphates,
surfaces rubéfiées et corrodées. Également, on observe une infiltration des grès glauconieux dans les bancs de
calcaire marneux sous forme de remplissages de fentes perpendiculaires aux bancs et de vides dans les interlits
parallèles aux bancs. Des "nids" de bélemnites se concentrent localement dans ces cavités.
Ces phénomènes sont la conséquence d'une érosion karstique des calcaires marneux au cours d'une émersion au
Barrémien, suivie d'un remplissage des cavités dues à cette érosion par des sédiments terrigènes apportés par
la transgression marine de l'Albien.
h) marnes noires pyriteuses à épisodes marno-calcaires clairs (bancs
centimétriques ou miches isolées) : Cénomanien. Epaisseur = 70 m (variable)
i) calcaires marneux jaunâtres,
gréseux avec galets d'argile à la base, passant vers le haut à une alternance marno-calcaire jaunâtre monotone :
Turonien - Sénonien.
La séquence (f) (g) (h) (i) forme le versant oriental de la crête principale. Elle
donne des reliefs mous, arrondis, qui contrastent avec la morphologie anguleuse de la barre calcaire jurassique
qui arme la crête principale.
Seul le niveau de base du Turonien se marque en géomorphologie par une mince
ligne en relief.
Tectonique
a) Phase majeure pontienne
La crête de ROCASPARVIÉRA constitue l'extrémité nord de l'unité
tectonique du Mt. FÉRION, branche occidentale de l'Arc de NICE. L'ensemble Jurassique-Crétacé chevauche vers l'ouest
sur un substratum marneux Turonien-Sénonien avec des lambeaux laminés de Trias. Sauf à la baisse de la MINIÈRE où
apparaît le Trias, la ligne de contact entre l'ensemble chevauchant et son substratum n'est pas visible, cachée par
les éboulis continus du pied de la barre jurassique.
L'âge du chevauchement qui est l'expression d'une phase
tectonique de compression d'est en ouest est rapporté par B. GÈZE au Pontien (début du Pliocène). L'ensemble
chevauchant Jurassique-Crétacé à l'est de la crête de ROCASPARVIÉRA a un pendage moyen de 25° vers le sud-est.
La faille du col St. MICHEL est un accident de direction N65 qui décroche vers l'ouest la crête de MIAMANDE. Ce
décrochement dextre est une rupture résultant de la poussée vers l'ouest à l'origine du chevauchement. Il est donc
d'âge Pontien probable comme ce dernier. Des accidents similaires de part et d'autre de l'ancienne mine de l'EGUISSE,
mais moins importants que la faille du col St. MICHEL, décrochent également la barre des calcaires jurassiques au
sud de la cime de MIAMANDE. Ils appartiendraient à la même phase tectonique.
b) Phase ancienne (cénomanienne).
L'examen attentif des photos aériennes, appuyé sur nos observations de terrain, révèle la présence d'un réseau
de failles qui apparaît interrompu par les décrochements de la phase pontienne. Ces failles délimitent de petits
panneaux d'effondrement (grabens) dans la combe de ROCASPARVIÉRA et à la mine de l'EGUISSE.
Ces grabens sont
bien visibles en photo aérienne : leur direction est N10 à la mine de l'EGUISSE et N140 au nord de la faille du
col St. MICHEL. Sur le terrain, on observe des failles à jeu normal témoin d'une phase de distension. Ces failles
sont minéralisées principalement en calcite avec un peu de barytine et en sulfures oxydés (faciès gossan). Sous la
zone d'oxydation, à l'ancienne mine de l'EGUISSE, la paragénèse est représentée essentiellement par des sulfures
d'arsenic (orpiment, réalgar) et de l'arsenic natif présent tantôt dans un réseau serré de veinules de calcite
résultant d'un remplissage hydrothermal des failles bordant la zone, tantôt en imprégnation dans les marnes grises
à nodules pyriteux de la base du Cénomanien (cf. la thèse de J. FÉRAUD).
Le réseau de failles et de fractures
minéralisées décrit ci-dessus recoupe les dépôts gréseux-glauconieux à bélemnites de l'Albien (cf. ci-dessus
stratigraphie). Il est donc postérieur à l'Albien.
Il disparaît totalement sous les marnes grises de la partie
supérieure du Cénomanien. II serait donc antérieur à leur dépôt.
On peut donc admettre que l'âge de ces failles
et fractures et de leur minéralisation subséquente se situe au début du Cénomanien.
Remarque : Sur le plan de la
faille St. MICHEL (phase pontienne), on observe également quelques plaquages de calcite et d'oxydes de fer : ils
apparaissent cependant comme des remobilisations tardives de minéralisations plus anciennes.
c) Phase
récente (actuelle).
La photographie aérienne montre que la combe de ROCASPARVIÉRA qui forme le flanc oriental
de la crête du même nom est limitée à l'est par une grande faille dessinant un arc ouvert vers l'ouest, entre le col
de l'AUTARET au nord et la crête de la pointe de SERENA au sud. Par rapport à l'horizon-repère de la base du
Turonien, le rejet, normal vers l'ouest, atteint 50m à la hauteur des ruines de CONDAMINIA.
Sur le terrain, on
observe une profonde ravine localement diverticulée en relais. Les parois sont très instables. Elle fonctionne comme
un couloir d'avalanche de pierres lors de fortes pluies.
On note également que ce faisceau fracturé affecte même
les anciens éboulis consolidés. Cette morphologie de fissures ouvertes et le dessin général en arc de cercle de
cette structure indique une faille d'effondrement typique, fonctionnant encore à la période actuelle (éboulis
anciens fissurés) : il s'agit d'une faille vivante dont la progression est probablement déterminée par la forte
séismicité du secteur.
Cependant aucune indication sur la carte géologique au 1/50.000 ne mentionne son
existence. L'escarpement accentué du versant vers la VÉSUBIE et la forte dénivellée (1.000 m) sont à prendre en
considération pour expliquer le jeu de cet effondrement : il est possible qu'il résulte d'un tassement dû à la forte
érosion en aval du soubassement de marnes écrasées sur lequel repose l'ensemble chevauchant Jurassique-Crétacé de
ROCASPARVIÉRA. Le point d'amplitude maximum (épicentre de l'effondrement) se situe à 1 km environ à l'est de
l'ancien village, sous l'ancienne bergerie de CONDAMINIA. On note enfin que la faille du col St. MICHEL qui est à
l'origine un accident décrochant de la phase pontienne (voir plus haut) paraît avoir rejoué récemment en faille
normale avec un rejet vers le sud de plusieurs dizaines de mètres, matérialisé par une falaise au pied du contrefort
sud du piton de ROCASPARVIÉRA.
|
|
NOTES HYDROGÉOLOGIQUES
Dans le secteur, deux formations sont
susceptibles d'être de bons aquifères :
- les calcaires jurassiques: perméabilité fissurale karstique
(fractures et cavités de dissolution),
- les bancs gréseux de l Albien : perméabilité intergranulaire.
La séquence jurassique, épaisse de 350 m, a un pendage général vers l'Est. Les eaux pluviales collectées le long du
flanc est de la crête principale devraient normalement alimenter les nappes captives du synclinal de CONTES (bassin
versant du PAILLON).
Les bancs gréseux de l'Albien dessinent localement au nord de la bergerie de CONDAMINIA une
légère gouttière synclinale d'axe N20 plongeant vers le sud. Ce faible mouvement est scellé au toit par les marnes
noires imperméables du Cénomanien(contact discordant).
L'exutoire normal de cet aquifère peu étendu devrait
normalement se situer au sud, sous la bergerie de CONDAMINIA. Le mouvement d'effondrement de l'ensemble de la crête
de ROCASPARVIÉRA a bouleversé ces conditions hydrogéologiques, antérieures au 16ème siècle de notre ère, c'est-à-dire
avant les séismes majeurs de 1564, 1612 et 1618. L'ouverture des grandes fractures qui bordent l'effondrement à
l'est a pu entraîner la capture des eaux souterraines des calcaires jurassiques, lesquelles seraient probablement
drainées maintenant vers le bassin de la VÉSUBIE à l'ouest. De même, les bancs de grès albiens situés à proximité
immédiate du champ de fractures ont été probablement mis en communication directe avec celui-ci. Les eaux
souterraines circulant dans ces grès ont donc pu être capturées par les nouvelles failles à l'est, tarissant ainsi
leur exutoire normal dans le vallon au sud. L'examen attentif de la photo aérienne en couleurs montre au moins 3
points de végétation humide le long du contact entre les grès albiens et les calcaires marneux néocomiens
sous-jacents. II serait intéressant de vérifier si des vestiges de captages existent près de ces points, qui, vu
leur position structurale, ont de fortes chances de correspondre à d'anciennes sources.
|
|
VESTIGES D'OCCUPATION DES SOLS
L'examen attentif des photographies aériennes à des fins d'étude géologique nous a
de plus révélé des traces nombreuses d'une occupation des sols agricole et pastorale.
Pour interpréter ces traces,
il est nécessaire de se reporter aux événements historiques qui ont amené une communauté rurale à s'installer à cette
altitude, au-dessus de la limite des oliviers et des vergers, dans un paysage dénudé et dépourvu de cours d'eau de
surface permanents. Pour cela, nous nous référons à l'excellente étude historique de P.R. GARINO : DURANUS autrefois
ROCASPARVIÉRA (éditions SERRE, Nice, 1993). Résumons en quelques mots ce que dit P.R. GARINO :
La construction du
village sur son piton rocheux date probablement du 9ème siècle, date des premières incursions des Sarrasins. La
menace que représentaient ces pillards prédateurs était suffisamment sérieuse pour que les habitants de la région
se réfugient sur des points hauts escarpés, faciles à fortifier et à défendre. Mais cela impliquait forcément la
présence de l'eau indispensable pour la consommation mais également pour une activité agricole et pastorale
permettant de subvenir aux besoins de la communauté.
Quand on regarde l'implantation des "Villages perchés"
du Pays Niçois et de la Provence, on constate toujours la présence des eaux de source à proximité, au minimum à la
même altitude, sinon plus haut. On constate également la présence proche de sols favorables à la culture, même si
ceux-ci sont situés ailleurs que sur le piton sur lequel était construit le village.
Celui de ROCASPARVIÉRA a
été abandonné par ses habitants, non du fait d'événements militaires, mais à la suite d'une série de grands
tremblements de terre au début du 17éme siècle, qui ont gravement endommagé les constructions, détruit les
canalisations d'eau potable et "descendu" la source. Le dernier occupant du village fut le curé qui partit le
10 août 1723.
Depuis cette date, la combe de ROCASPARVIÉRA est déserte et n'abrite plus que des troupeaux de
moutons et de chèvres qui montent à la belle saison avec leurs bergers depuis les vallées de la VÉSUBIE ou du
PAILLON.
Les vestiges que nous révèle la photographie aérienne sont les suivants :
| a) Ruines du vil
lage fortifié dominant vers le sud le vallon de l'ENGARVIN. b) Ruines de bâtiments agricoles isolés (granges ou bergeries). Certaines sont portées sur la carte IGN au 1/25.000 : lieux-dits Les BOES, CONDAMINIA. D'autres existent sur le versant oriental de la crête de ROCASPARVIÉRA. c) Restes de bassins à eau pluviale sous la cime de l'AUTARET ou jouxtant les ruines isolées mentionnées ci-dessus. d) Restes d'anciens chemins empierrés et appareillés, dont certains sont encore utilisés. e) Terrasses soigneusement construites en petits gradins réguliers parallèles aux courbes de niveau : probablement terrasses irriguées destinées à la culture. Ce groupe de terrasses (D sur la carte de la figure 3) est exclusivement cantonné aux terrains d'âge néocomien situés sur le versant oriental de la crête principale (figure 2). Ces terrains donnent des sols argilo-calcaires avec un pouvoir de rétention d'humidité favorable à la culture des céréales. La présence de limonite résultant de l'oxydation de pyrite et de glauconie, minéraux bien représentés au Néocomien, apporte des oligo-éléments. Tout ceci donne un sol qui devait être très productif dès lors qu'un minimum d'irrigation était assuré. f) Terrasses grossièrement construites (groupe H sur la carte de la figure 3), souvent obliques, paraissant suivre les irrégularités du sol plutôt que les corriger comme c'est le cas pour le groupe D. Ces terrasses sont exclusivement cantonnées à la bande de marno-calcaires turoniens formant la "lèvre" ouest de la grande faille d'effondrement, entre Les BOES et CONDAMINIA. |
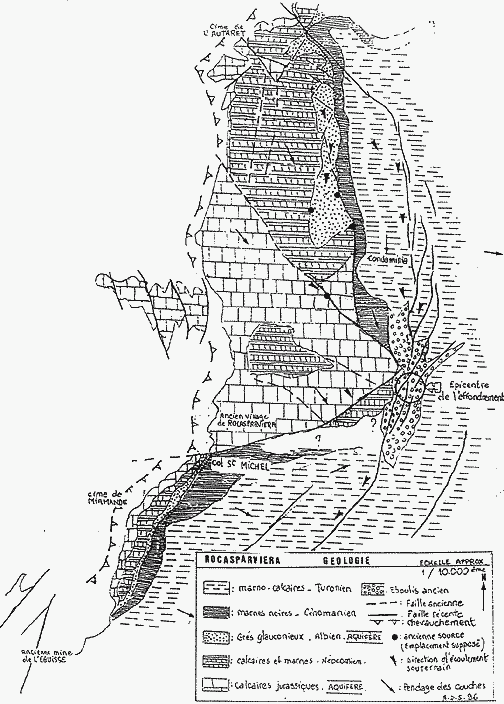 |
|
|
Bibliographie
- AUDAIRE D. (1996) : Étude géologique de l'unité septentrionale du chainon du FERION :
Mémoire cycle général I.G.A.L.
- FERAUD J. (1974) : Les gisements de sulfures d'arsenic du sud-est de la France.
Thèse université Paris VI.
- GARINO P.R. (1993) : Duranus autrefois Rocaspaviera, Ed. SERRE - Nice
-
GEZE B.
(1959) : Le diapir triasique du mont FÉRION (Alpes Maritimes) et son évolution tectonique C.R. Acad. Sc 9 décembre
1959.
Documents de référence
- Carte géologique au 1/50 000 Feuille Menton-Nice XXXVII – 42-43
- Carte
topographique IGN au 1/25 000 Feuille 3742 ouest
- Photographies aériennes IGN 83-09-170 P n° 0402 et 0403 1994
FD 06/200 n° 287
- Image satellitaire SPOT 1HRV1
