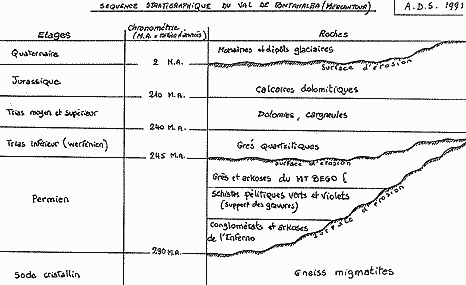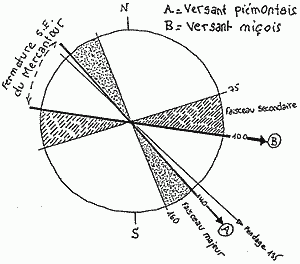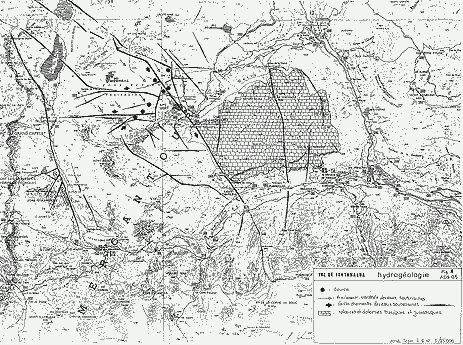![]()
N° 2 - 1995
LES SOURCES DU VAL DE FONTANALBA
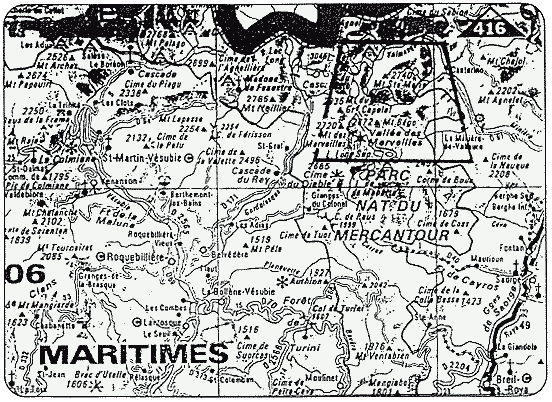 |
Résumé Le Val de FONTANALBA recèle la plus importante zone de gravures rupestres préhistoriques de la région des Merveilles. Son nom provient probablement des sources qui jaillissent au pied du Mont-Bego. Une reconnaissance sur le terrain en août 1995, appuyée par une analyse géomorphologique des photos aériennes, a permis de localiser 6 groupes d'émergences alimentant le Lac Vert d'où part le torrent de FONTANALBA. Ces groupes d'émergences se situent au point de convergence de fractures affectant les grés et pélites du Permien. En photo aérienne, elles sont révélées par des taches caractéristiques de tourbières qui se révèlent aussi comme de bons marqueurs des zones de sources en altitude. |
Une reconnaissance de la flore de ces tourbières a également été effectuée conjointement.
Une grande faille,
orientée Nord -Ouest Sud-Est traverse le haut de la vallée de FONTANALBA et recoupe au Sud-Est le vallon de la Minière
: elle pose l'hypothèse de l'écoulement possible d'une partie des eaux souterraines de FONTANALBA vers le vallon de la
Minière par la Baisse de Vallaurette.
|
|
|
Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |
|
|
HYDROGEOLOGIE DU MASSIF DU MT BEGO (ALPES-MARITIMES)
Le massif du MT BEGO fait partie de la région des "Merveilles", célèbre pour ses gravures rupestres remontant à l'âge
du Bronze.
II nous a paru intéréssant d'en étudier les sources, lesquelles ont certainement joué un rôle important
dans la vie des peuples de pasteurs qui ont gravé les signes et hanté ces lieux il y a 3.000 ans.
L'étude présentée
ici a été effectuée suivant la procédure suivante :
A) Phase préparatoire
Analyse géomorphologique
détaillée par examen stéréoscopique des photos aériennes et corrélations avec le fond topographique I.G.N. au 1 /25.000
par Pierre de BRETIZEL (Institut Géologique A. de Lapparent LG.A.L. / I.P.S.L., 13, bd. De l'Hautil F 95092 - CERGY
PONTOISE Cedex).
B) Observations et contrôles sur le terrain
Effectuées le 26 Août 1995 par un groupe de
chercheurs et d'amateurs appartenant aux Associations "Les Amis des Sources", "Les Naturalistes de Nice et des Alpes
Maritimes" et "Naturoya". Les participants étaient Gérard & Diane FOSSATI, Monsieur MOLINE, Patrick & Dianne DARCY,
Mireille BOUTHIER, Hervé de MOISSAC, Hubert & Marianne MAZZOLENI, Emmanuel de SAVIGNIES, Michel LAINE (et Madame),
Laurence LAINE, Alain DELAYE (et Madame), Estelle DELAYE, Aurélie DELAYE, Marie-Noëlle BERT, Didier BERT, Anne &
Pierre de BRETIZEL.
Documents de référence
- Carte Géologique au 1 /50.000°.
Feuille XXXVII-40-41 ST MARTIN - VÉSUBIE - LE BORÉON et sa notice. Dans le secteur du Val de FONTANALBA les levés
géologiques ont été faits entre 1947 et 1956 par P. FALLOT, professeur au Collège de France, et A. FAURE-MURET,
chargé de recherches au Collège de France.
- Carte topographique I.G.N. au 1 /25.000° N° 38410T (TOP 25)
Vallée de la Roya.
- Photographies aériennes I.G.N. Vol. 3841 /300 photos N° 005 à 007.
Cadre Géographique
Le Val de FONTANALBA est situé dans la partie sud-orientale des Alpes du MERCANTOUR,
à l'ouest du Col de TENDE. C'est un affluent de rive droite du torrent de CASTERINO, lui-même affluent de rive droite de
la rivière ROYA, avec laquelle il conflue à Saint DALMAS de TENDE. Dans sa partie haute, il forme un vaste cirque ouvert
vers l'Est, entouré de crêtes escarpées culminant à 2.872m au MT BEGO; le modelé y est de type glaciaire. Dans sa partie
basse, c'est une vallée encaissée descendant vers le Nord-Est, débouchant dans la grande vallée de CASTERINO; le modelé y
est de type torrentiel.
La limite entre forêt de mélèzes et alpages correspond à peu près à la limite entre modelé
glaciaire et modelé torrentiel, soit vers l'altitude de 1 700m environ. La zone des alpages disparaît en altitude, au
dessus de la cote 2.200m, laissant à nu le socle rocheux, les éboulis et les moraines. L'occupation des sols dans la zone
des alpages est représentée par l'activité pastorale estivale (bovins) tandis que, dans la partie basse, c'est
l'exploitation forestière qui domine. La transhumance des troupeaux provient à la fois du bassin de la ROYA et du versant
italien, notamment de LIMONE et de DEMONTE.
Sur le plan archéologique le Val de FONTANALBA est un monument classé qui
renferme, dans sa partie haute, environ 20.000 gravures rupestres remontant à l'âge du bronze. Les motifs de certaines
gravures témoignent de la permanence de l'activité pastorale dans la région depuis 4 000 ans au moins.
Signalons enfin
que le Val de FONTANALBA est une zone protégée faisant partie du Parc National du Mercantour.
Données
géologiques initiales
Elles proviennent essentiellement des travaux de P. FALLOT et A. FAURE-MURET,
entre 1947 et 1956.
| Lithologie et stratigraphie Dans le Val de Fontanalba, on observe les formations suivantes (de bas en haut, dans l'ordre stratigraphique) :
Au dessus de la
séquence permienne (a) (b) (c) on trouve des sédiments marins du Trias inférieur et moyen comprenant, de bas en haut |
Données nouvelles apportées par la présente étude
Basées essentiellement sur une analyse géomorphologique
détaillée, contrôlée sur le terrain, elles sont d'ordre tectonique et
hydrogéologique.
|
Tectonique L'ensemble permo-triasique affleurant dans le Val de Fontanalba apparaît comme un monoclinal dont le pendage moyen est de 30-35° pour une direction orientée N 135. Le monoclinal est perturbé par trois lignes de fractures majeures, plus ou moins sinueuses, orientées N160 à N140. II s'agit de failles normales, subverticales, à rejet Est, le compartiment le plus élevé structuralement correspondant à la chaîne du Grand Capelet et le plus bas au Plan de Tendasque (Ouest du Val de Casterino). Le rejet cumulé de ces trois accidents ne peut être estimé du fait des importantes variations d'épaisseur du permien. Sur le plan régional ils paraissent faire partie d'un système plus ou moins parallèle aux grandes directions structurales N140 du versant piémontais du massif du Mercantour (secteurs d'ENTRAQUE et de VALDIERI) lesquelles verrouillent la fermeture Sud-Est de ce massif par interférence avec les directions structurales N100 du versant niçois (Vallée de Cairos).
Hydrogéologie (fig 8 )
Cette cote correspond à l'intersection du profil topographique avec le sommet de la zone saturée des eaux souterraines dans la partie haute du Val. Le Lac Vert est donc également le réceptacle des eaux souterraines grâce à un réseau convergent de failles
drainantes. |
Conclusion
La présente étude a mis en évidence un réseau convergent de failles et de fractures encore peu connu auparavant et qui joue un rôle important dans la circulation des eaux souterraines de la partie haute du Val de Fontanalba.
Le réseau est composé de failles normales,, de direction N140-160, à rejet Est important, et de failles normales de direction N75-100, à rejet alterne faible. II correspond à une phase tectonique de distension récente. Le contrôle sur le terrain a permis de confirmer l'existence de ce réseau, préalablement repéré sur photos aériennes.
Six groupes d'émergences ont été localisés dans une zone triangulaire parsemée de tourbières. Le Lac Vert apparaît comme le réceptacle de ces émergences, au même titre que les eaux de surface.
Une grande ligne de fracturation, repérée depuis la Valmasque, au Nord-Ouest, jusqu'au Val de la Minière, au Sud-Est, en passant par le Lac Vert de Fontanalba pose la question d'une possible connexion souterraine (non vérifiée) entre la partie haute du Val de Fontanalba et le Val de la Minière, à la hauteur des rochers de Valaure.
Remerciements.
Nous remercions la Direction du Parc National du Mercantour de nous avoir permis de réaliser cette étude.
|
|
UN MILIEU HUMIDE PARTICULIER : LES TOURBIERES DU MONT BÉGO (ALPES-MARITIMES)
Par
Diane FOSSATI
L'observation des tourbières à sphaignes présente un intérêt considérable
pour l'étude de la pollution des eaux par les hydrocarbures
et permet de retracer l'histoire des variations climatiques et du milieu de vie.
Les tourbes conservent la mémoire de la vie.
On observe dans le Val de Fontanalba, en amont du Lac Vert, entre le Mont Bego et le Mont Sainte-Marie, la présence de tourbières. Elles se sont formées à partir des émergences de la nappe phréatique qui a gorgé d'eau le sol dans une configuration de bassin lacustre. Une tourbière est un milieu aquatique particulier dans lequel on trouve des espèces végétales dites "turfigènes", c'est-à-dire formatrices de tourbe.
| Ces espèces se développent dans un climat humide et froid, dans l'eau stagnante de cuvettes glaciaires. Les végétaux se développent d'abord sous le niveau aquifère et tirent leur substance nutritive du sous-sol : la tourbière est dite "topogène". Le milieu étant pauvre en oxygène, les plantes mortes et les racines ne se décomposent que très lentement tandis que de nouvelles plantes continuent à pousser et à mourir. Il en résulte un amoncellement de résidus formant un matelas végétal qui va s'épaissir et occuper toute la cuvette lacustre ou glaciaire. Puis les plantes, isolées peu à peu du sous-sol, vont s'élever au dessus du niveau des eaux souterraines, s'adapter à un état de famine, ne tirant plus leur nourriture que des eaux de pluies ou nivales, qu'elles emmagasinent dans leurs cellules à la manière d'une éponge. Vont alors pousser dans de telles conditions, des plantes frugales, comme les sphaignes, mousses sans racines qui se développent par leur pointe, soit à l'horizontale, soit à la verticale, pendant que leur base asphyxiée s'accumule sous elles. Les sphaignes poussent en coussins que séparent des ruisselets d'eau. Leur croissance étant plus rapide au centre que sur les bords, la tourbière prend alors une allure de dôme, elle est dite "ombrogène". Les tourbières à sphaignes rencontrées à Fontanalba sont fréquentes en montagne. Elles résultent du colmatage de cuvettes glaciaires par une végétation développée en milieu acide dans des eaux faiblement minéralisées. La végétation progresse des bords de la tourbière vers l'eau libre centrale. A une altitude d'environ 2200 m, ces tourbières se présentent sous forme de pelouses gorgées d'eau alimentées par les sources. On y trouve différents carex (Carex nigra, Carex fusca), des joncs, des scirpes (Scirpus caespitosus) qui poussent en touffes gazonnantes, des linaigrettes (Eriophorum scheuchzeri). |
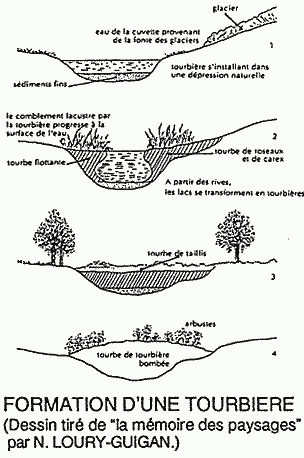 |
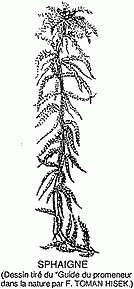 |
Parmi les sphaignes et les mousses constituant l'essentiel de ces tourbières, on rencontre des
Sphagnum acutifolium pour les premières, des Bryacées du type Aulacomnium
palustre, Philonotis fontana pour les secondes, et dans l'eau courante des ruisseaux, une mousse brunâtre à feuilles pointues disposées sur trois plans du type
Fontinalis (Hypnacées). On observe également des coussinets de mousses du type
Mnium sp. (Mniacées). Sur les bords de la tourbière, constituée en prairies humides, aux abords des sources et des bordures de ruisseaux, on a reconnu quelques spécimens de plantes à fleurs : la parnassie des marais (Parnassia palustris) le populage des marais (Caltha palustris) la bartsie des Alpes (Bartsia alpina) la primevère farineuse (Primula farinosa) trouvée près de la lère source identifiée. la saxifrage azoïde (Saxifraga aizoïdes) près de la même source. Plus loin, dans les zones asséchées, nous avons reconnu des parterres de myrtilles
(Vaccinum myrtillus, Ericacées). |
En effet la flore des tourbières est bien particulière, et il aurait fallu mentionner bien d'autres plantes que nous n'avons pas repérées,
comme par exemple la grassette des Alpes (Pinguicula alpina), plante carnivore qui englue les insectes, utilisant leur protéine animale pour survivre dans un milieu pauvre en azote.
L'étude d'une tourbière .à sphaignes, présente un intérêt considérable à divers points de vue. L'analyse chimique montre que les sphaignes ont un pouvoir acidifiant très important et sont responsables de la régénération de l'eau des tourbières, leur conférant leurs propriétés. L'exploitation de la tourbe trouve aussi diverses applications : combustible utilisé depuis très longtemps, substrat végétal pour les cultures, utilisation des propriétés chimiques dans l'industrie, la pharmacie, le traitement de la pollution des eaux par les hydrocarbures, etc...
Enfin, nous soulignerons l'intérêt archéologique de l'étude de la tourbe : en effet, l'évolution d'une tourbière se faisant sur plusieurs milliers d'années, débris végétaux, pollens fossilisés, débris animaux, permettent de retracer l'histoire des variations climatiques, géomorphologiques et du milieu de vie qui se sont produits au cours de sa formation.
Documentation consultée
-
La mémoire des paysages N. LOURY GUIGAN éd. GLENAT, 1992.
- Les végétaux dans la biosphère P. OZENDA. éd. DOIN
-
Nouvelle flore des mousses et hépatiques. I. DOUIN. éd. BELIN, 1986.
- Les quatre flores de France. P. FOURNIER. éd. LECHEVALIER, 1961.
-
Fleurs du Mercantour Brochure du Parc Nation du Mercantour. éd. DROMADAIRE, 1992.
-
Guide du promeneur dans la nature. F. TOMAN HISEK. éd. HATIER, 1988.
- La tourbière des Saisies. Article de J.M. GOURREAU Alpes magazine n°34 Juillet 1995.
-
Aperçu général sur la végétation du Mercantour (versant français) Article de A. LACOSTE Riviera scientifique 4ème trimestre 1969.
-
Contribution à l'étude de la végétation muscinale des hautes montagnes des Alpes-Maritimes Article de J.P. HEBRARD Riviera scientifique ler trimestre 1970.
-
Richesses naturelles de la Haute-Loire: les tourbières. Article de M. TORT, R.J. BOUTEVILLE, et E. LAURENT Petit journal n°5, Musée Crozatier.